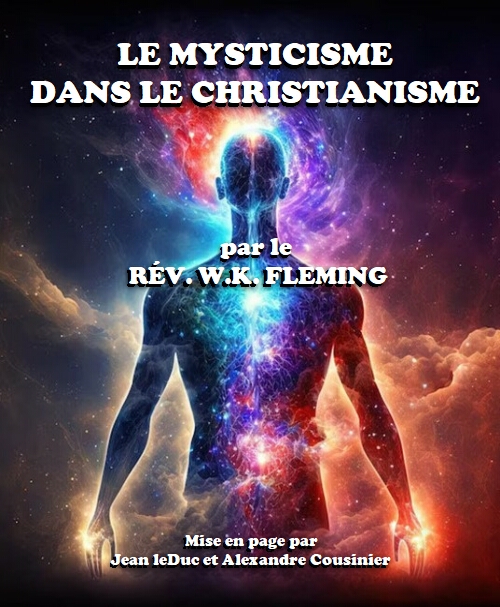
LE MYSTICISME
DANS
LE CHRISTIANISME
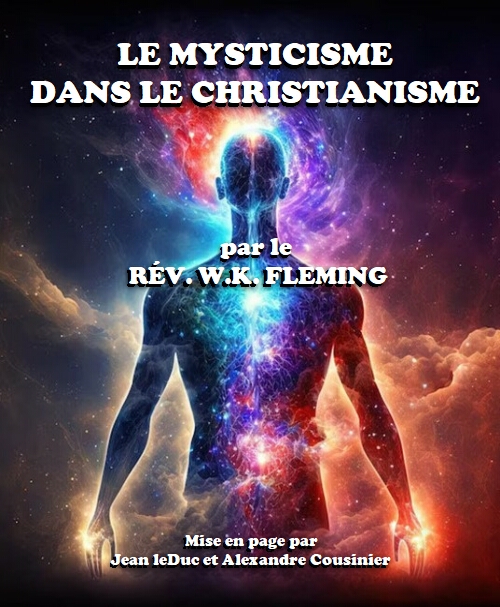
PAR LE RÉV.
***
Mise en page par Jean leDuc et Alexandre Cousinier
***
PRÉFACE GÉNÉRALE DU RÉDACTEUR EN CHEF
CHAPITRE I
CHAPITRE V
CHAPITRE VII
LES POÈTES CAROLINES ET LES PLATONISTES DE CAMBRIDGE
CHAPITRE XIII
Dans aucune branche du savoir humain, l’esprit de recherche n’a connu un essor plus vif au cours des dernières années que dans l’étude de la théologie.
De nombreux points de doctrine ont été réétudiés ; la « reformulation » est un cri populaire et, dans certaines directions, une véritable exigence de l’époque ; les ajouts à nos matériaux actuels, tant en ce qui concerne les manuscrits anciens que les découvertes archéologiques, n’ont jamais été aussi importants que ces dernières années ; les connaissances linguistiques ont progressé grâce aux possibilités plus complètes offertes par l’ajout constant de plus de données pour l’étude comparative ; des inscriptions cunéiformes ont été déchiffrées, et des peuples, des archives et même des langues oubliés ont été révélés à nouveau comme le résultat d’une étude diligente, habile et dévouée.
Les savants se sont spécialisés à un tel point que de nombreuses conclusions sont moins spéculatives qu'elles ne l'étaient, tandis que de nombreuses autres aides sont ainsi disponibles pour parvenir à un jugement général ; et, dans certaines directions au moins, le temps de tirer de telles conclusions générales, et donc de faire un usage pratique de telles recherches spécialisées, semble être venu, ou proche.
Beaucoup de gens, y compris la grande masse du clergé paroissial et des étudiants, désirent donc avoir sous une forme accessible un aperçu des résultats de ce flot de lumière nouvelle sur de nombreux sujets qui sont d'un intérêt vivant et vital pour la foi ; et, en même temps, les questions « pratiques » - par lesquelles on désigne en réalité simplement l'application de la foi à la vie et aux besoins du jour - n'ont certainement rien perdu de leur intérêt, mais occupent plutôt une place plus grande que jamais si l'Église veut remplir adéquatement sa mission.
Il semble donc opportun de publier une nouvelle série d’ouvrages théologiques, qui viseront à présenter un aperçu général de la situation actuelle de la pensée et des connaissances dans diverses branches du vaste domaine qu’inclut l’étude de la divinité.
La Bibliothèque de théologie historique est conçue pour fournir une telle série, écrite par des hommes de réputation connue en tant que penseurs et érudits, enseignants et théologiens, qui sont, tous et toutes, de fervents défenseurs de la foi.
Il ne s'agira pas seulement de sujets doctrinaux, bien qu'une place prépondérante leur soit accordée ; mais une grande importance sera également accordée à l'histoire — fondement sûr de toute connaissance progressive — et même les sujets les plus strictement doctrinaux seront largement traités de ce point de vue, point de vue dont la valeur par rapport aux sujets « pratiques » est trop évidente pour qu'il soit nécessaire de le souligner.
Il serait manifestement hors de propos dans cette série de traiter de livres individuels de la Bible ou d'écrits chrétiens ultérieurs, de cinq livres individuels ou de points mineurs (et souvent très controversés) de la gouvernance de l'Église, sauf dans la mesure où ils entrent dans le cadre d'une analyse générale de la situation. Cette étude détaillée, aussi précieuse soit-elle, est déjà abondante dans de nombreuses séries de commentaires, de textes, de biographies, de dictionnaires et de monographies, et surchargerait trop une série comme celle-ci.
L'éditeur tient à ce qu'il soit bien entendu que les différents contributeurs à la série ne sont aucunement responsables des conclusions ou des opinions particulières exprimées dans d'autres volumes que le leur et qu'il n'a lui-même pas estimé qu'il était du ressort d'un éditeur, dans une série de ce genre, d'intervenir dans les opinions personnelles des auteurs. Il doit donc leur laisser l'entière responsabilité de leurs propres conclusions.
Des nuances d’opinion et des différences de jugement doivent exister, si l’on ne veut pas que la pensée soit au point mort – pétrifiée en un fossile improductif ; mais bien que ni l’éditeur ni tous ses lecteurs ne puissent être attendus d’être d’accord avec chaque point de vue dans les détails des discussions dans tous ces volumes, il est convaincu que les grands principes qu’il a à l’origine de chaque volume sont tels qu’ils doivent contribuer au renforcement de la foi et à la gloire de Dieu.
Que cela soit ainsi est le seul souhait de l’éditeur et des contributeurs.
WCP
Londres 1911.
L' objet des pages qui suivent est de fournir une introduction à l'étude de la pensée mystique telle qu'elle s'est développée dans les limites de la foi chrétienne. L'intérêt pour le mysticisme est devenu ces derniers temps si prononcé et si répandu que l'on espère que, même parmi les divers et excellents ouvrages qui ont paru en réponse à cet intérêt, on trouvera peut-être place pour une tentative de présenter le sujet dans son ordre historique et sous une forme qui puisse répondre au mieux aux besoins du lecteur général. Je dois mes remerciements au doyen de Saint-Paul, qui m'a permis, avec son aimable permission, de citer, parmi les définitions du mysticisme données, plusieurs de celles qu'il a rassemblées dans l'appendice A de son « Mysticisme chrétien », ainsi que de profiter de l'aide que m'apportent ses précieux travaux sur le sujet ; et, parmi les autres ouvrages consultés, je souhaite exprimer ma reconnaissance particulière au baron von Hügel pour « Mystical Elements in Religion », au professeur Rufus Jones pour « Studies in Mystical Religion », à Miss Underhill pour « Mysticism » et au récent livre du père Sharpe, « Mysticism : Its True Nature and Value ».
W. K. FLEMING.
Janvier 1913.