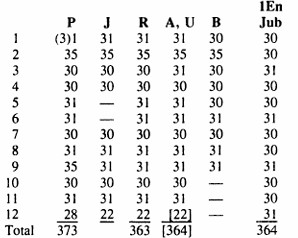[J]
Et ils volent
avec leurs ailes, et font le tour de toutes les planètes/
Et
là j'aperçus les trésors de neige et de glace, c 1
et les
anges qui gardent leurs terribles réserves, • 2
et le
trésor des nuées,
d'où elles sortent et d'où elles entrent.
6 |De
la rosée, de l’huile d’olive et de diverses fleurs. Mot «
5. » |
Et ils me
montrèrent des trésors de rosée, semblables à de l'huile.
Et
l'aspect de son image était comme toutes les espèces de fleurs terrestres,
seulement plus nombreuses ; et les anges qui gardent leurs trésors, comment ils
sont fermés et ouverts.
Et
ces hommes me soulevèrent et
me transportèrent au deuxième ciel. Ils me montrèrent, et je vis des ténèbres
plus grandes que les ténèbres de la terre. Et là, je vis des prisonniers sous bonne
garde, suspendus , attendant le jugement
sans mesure. Et ces anges avaient l'apparence des ténèbres elles-mêmes, plus que
les ténèbres de la terre. Et ils pleuraient sans cesse tout le jour. Et je vis
des anges qui me tenaient dans leurs mains, et ...
-
f.
L'interprétation de Vaillant (Secrets, p.
9) de cette phrase obscure, que l'on ne trouve que dans la recension la
plus longue, est une amélioration de la précédente « et venez autour de
tous ceux qui naviguent » (« nageurs », APOT, vol.
2, p. 432).
Il est
vrai que plavati décrit
principalement la natation ou la navigation maritime, mais je n’ai trouvé
aucune autre occurrence des planètes comme « nageuses » dans le ciel. Il
semble peu probable que ces anges aient juridiction sur les déplacements sur
le grand océan céleste qui vient d’être décrit. Le contexte immédiat, du
moins dans les manuscrits les plus longs, est le gouvernement des étoiles.
L’idée que les anges supervisent les mouvements des corps célestes est
prédominante dans 2En. Le verbe obükhoditi, «
faire le tour, entourer », correspond à l’image. Nous devons imaginer que
l’ obûkhodînikü
(= periodeutês, un
inspecteur itinérant) « fait le tour » des « étoiles » pour s’assurer
qu’elles fonctionnent correctement. La régularité n’est pas automatique ; il
n’existe pas de lois fixes de la nature identiques à la volonté de Dieu ou
aux vérités des mathématiques. Mais comme les planètes ont reçu leur nom
habituel d'« étoiles » dans le verset I, nous ne pouvons pas être sûrs que plavajuXtikhu signifie
précisément « planètes », mais seulement celles qui pourraient s'écarter du
droit chemin. Ici, nous pourrions avoir l'idée que tout est en ordre dans
le cosmos
supérieur, mais que dans l' ouranos inférieur, les
choses sont parfois irrégulières.
Notez
que tous les MSS contiennent « ils volent avec leurs ailes », mais dans la
courte tradition, cela se lit comme un fragment.
(sükroviJte). Les
deux se réunissent en 5:1 dans A U.
-
c.
A a khladnaa, U
essentiellement la même chose. Mais B a golotnaja et
VN aussi (qui, cependant, ont le v. 1 après le v. 2). D’où « froid »
dans APOT, vol.
2, p. 433. À l’origine * kholdû, la
forme dans A est slave. (Russe, kholodnyî [comme
dans B 2 ]), mais
elle n’est pas utilisée pour l’un des éléments des listes dans les
textes bibliques. Puisque A a golotnaja en
40:10 en accord avec d’autres MSS, sa variante en 5:1 doit être
secondaire־aire. Slave, golotnaja correspond
à « gel ». Cf. Ps 148:8.
-
d.
A et U ont une dittographie identique à ce stade.
-
e.
Le sujet est probablement la neige et le gel, et non les anges. Sur les
verbes de mouvement, voir note b du ch. 4. Une confusion similaire se
produit ici. Les variantes représentent deux manières différentes de
considérer le mouvement des nuages. Selon A, les éléments entrent
d'abord (vkhodjat) dans
les trésors, puis sortent (iskhodjat). Mais
l'adverbe relatif otnjuduie (ou otkuduie, la
lecture inférieure de P) s'applique à « sortir », mais pas à « sortir ».
Ainsi, la traduction « dans laquelle ils entrent » (APOT, vol.
2, p. 433) est incorrecte. La maladresse de l'idiome de A pourrait
expliquer l'inversion des verbes dans R P. J est allé un pas plus loin,
en lisant « monter et entrer ». Son premier verbe vuskodit correspond
également à VN (tout singulier). D’où le mot « monte » (APOT, vol.
2, p. 433). L’image de RP ressemble davantage à la façon dont nous
voyons le cycle de la pluie. Les nuages sortent d’abord, puis l’eau
revient. Dans J, l’eau monte et revient. Dans VN, apparemment, les
nuages montent et ressortent. Selon la Bible, la pluie et la neige
descendent du ciel et n’y retournent pas (Isa 55:10). Dans le schéma
d’AU, les anges préparent les nuages et les mettent dans le magasin,
prêts à partir dans
le monde.
5
1 Et
ils me montrèrent là les trésors de la neige et du froid, Job
38:22
2 anges
terribles gardent les trésors. ·Et ils me montrèrent là ceux qui gardaient les
trésors; {et ils me montrèrent là les trésors} des nuées, d'où ils entrent et
sortent.
6
1 Et ils me
montrèrent des trésors de rosée, semblables à de l'huile. Des anges gardaient
leurs trésors, et leur aspect était comme toutes les fleurs de la terre.
7 (2
ciel.)
1 Et
ces hommes me transportèrent au deuxième ciel, et me déposèrent sur le
deuxième ciel. Et ils me firent voir 2En
18:4
2 prisonniers
sous surveillance, dans un jugement sans mesure. ·Et là j'ai vu
les anges
condamnés,
b.
Littéralement « m'a pris ». Différents verbes sont utilisés pour décrire les
activités des « hommes » qui ont transporté Enoch d'un endroit à un autre.
On peut citer jusqu'à trois étapes : (1) « m'ont pris » ; (2) « m'ont porté
jusqu'à » ; (3) « m'ont déposé ». Au fur et à mesure que l'histoire avance,
on a tendance à raccourcir la formule, généralement en omettant le troisième
élément.
c.
Slave, uzniky (A,
comparer avec U) ou uziki (B),
c’est-à-dire uiînikü
= desmios : JP veryzniki, mieux veriini (R).
Ce dernier, attesté dans SRY (vol.
2, p. 89) mais pas dans SJS, est
probablement slave oriental. Cf. uziliSt,
uzilnicy uznici à
10:3. Le terme désigne les anges (desmophylaks). Il
ne semble pas s’agir du vocabulaire chrétien pour les esprits damnés au sens
eschatologique. Mais est-ce juif ? En tout cas, l’imagerie est celle des
chaînes, et non des « cachots » (APOT, vol.
2, p. 433).
d.
Slave, bljudomy, participe
passif de bljusti
(SJS, vol.
1, p. 117 ; SRY, vol.
I. p. 248 ; MSD, vol.
1, p. 121) = phylattein,
phylassein. Le
passage ressemble à 2Pi 2:4 et à Jude 6, mais la correspondance du
vocabulaire n’est pas assez complète pour soutenir l’hypothèse d’un emprunt.
Il faut également garder à l’esprit l’influence possible des Écritures
chrétiennes sur la transmission de 2En. Les manuscrits plus longs et plus
courts diffèrent. La source habituelle de tîma (J)
est skotos
(MSD sub tîma). Dans
J, l’adjectif « grand » modifie « jugement », et non « jour » comme dans
Jude ; « jour » manque dans 2En ; mais ailleurs on trouve « le jour du grand
jugement ». Les deux recensions ont plus en commun avec Jude qu’avec 2Pi. En
d’autres termes, ils n’ont rien de ce qui est dans 2P qui ne soit pas dans
Jude, et le siros de
2P n’a pas d’équivalent dans les autres textes. Et il n’y a rien dans les
manuscrits courts qui ne soit aussi dans les longs, sauf le mot différent
pour « prisonnier », qui introduit cependant l’idée d’entraves (cf. Jude).
Les preuves ne sont pas assez claires pour permettre d’expliquer que la
longue recension est une extension de la courte sous l’influence de Jude.
Car même la courte recension a déjà des affinités avec Jude. En fait, le
seul point sur lequel la longue recension et Jude s’accordent contre les
manuscrits courts est dans le mot « grand », et même là les idées ne sont
pas tout à fait les mêmes, car Jude a « grand jour », 2En J « grand jugement
». De plus, et plus sérieusement, « grand » ne se trouve que dans P – « sans
mesure » est la meilleure lecture (tous les manuscrits) ; et 2En a les anges
« en train de pleurer », J, en plus, « pendus » et « attendant ».
e.
Sans aucune modification, nous ne pouvons pas être certains de ce que signifie
ici visjasa
. Viséti signifie
soit « dépendre de » soit « être suspendu ». (Sur le lien de « sagesse »
possible entre ces deux significations, voir WF Arndt et FW Gingrich, A
Greek English Lexicon of the New Testament [Chicago,
1952] p. 451.) Ce verbe est utilisé pour la pendaison (= crucifixion) dans
Lc 23, 39 ; Actes 5, 30 ; 10, 39, et décrit ainsi la suspension d’un
criminel exécuté (soit en punition, soit en exposition), et non pas d’un
criminel en attente de sentence, comme ici. L’idée vient-elle d’ApPet (7,
22), qui contient également des choses telles que « ténèbres » et le fleuve
de feu ? Au moins la tradition est similaire – mais il s’agit de pécheurs
humains. Les blasphémateurs sont pendus par la langue (ek
tes glôssës kremamenoï), les
femmes débauchées par les cheveux, les fornicateurs par le pénis (sûrement !
— pas « les cuisses » comme dans HSW, vol. 2, p. 673 — car il s’agit d’un
hébraïsme issu
de raglayim, «
organes génitaux »).
f.
Cette caractéristique est curieuse car zidati décrit
généralement une attente pleine d’espoir et un désir ardent ; mais le mot «
espoir » ne conviendrait pas. Pour savoir si une telle réévaluation d’ elpis est
typiquement chrétienne, voir Zimmerli, Man
and His Hope, et
Bultmann sur elpis dans TDNT.
11 J'ai dit
aux hommes qui étaient avec moi : « Pourquoi ces hommes sont-ils sans cesse
tourmentés ? » Ces hommes m'ont répondu : « Ce sont ceux qui se sont détournés du Seigneur,
qui n'ont pas écouté les commandements du Seigneur, mais qui, de leur propre
volonté, se sont concertés et se sont détournés avec leur chef et avec les
oppresseurs du cinquième
ciel. » 2 J'ai été saisi de compassion pour eux, et ces anges se sont prosternés
devant moi et m'ont dit : « Homme de Dieu, prie le
Seigneur pour nous ! »
Et je leur
répondis : « Qui suis-je, moi, un homme mortel, pour prier pour cinq anges
? Qui sait où je vais et à
quoi je vais m’attendre ? Ou bien, qui priera pour moi ? »
8 |
À propos de l'enlèvement d'Enoch au 3ème ciel. Mot « 7. » | a
Et ces hommes
m'ont pris de là, et ils m'ont fait monter au troisième ciel, 1 et m'ont déposé
là. Alors j'ai regardé en bas ? et j'ai vu le Paradis / Et cet endroit est
inconcevablement agréable.
Et je
vis les arbres en pleine floraison, et leurs fruits étaient mûrs et parfumés,
2 riches de toute sorte de nourriture, et répandant une odeur agréable.
Et au milieu
d'eux se trouvait l'arbre de vie, à l'endroit où le Seigneur se
repose lorsqu'il entre au paradis.
Et cet arbre est indescriptible pour son charme et son parfum délicat, et plus
beau que tout autre.
chose créée
qui existe. ·Et de toutes les directions, elle a une apparence qui est 4 dorée
et cramoisie, et avec la forme du feu. Et elle couvre tout le Paradis. » Et elle
a quelque chose de chaque arbre fruitier et de chaque fruit. Et son
g. La
rébellion de Satanail et de ses partisans est décrite au chapitre 29
(uniquement pour les longs manuscrits). Ce sont des « apostats », donc
littéralement otùstupïnikû
(= apos-contes). Je
n’ai trouvé nulle part ailleurs la
lecture de AU, zlostupnicy
. Le préstupiïnikü
intensifié est
familier, mais l’orthographe pointe vers le préfixe zûlo-, «
mauvais », plutôt que dzèlo, «
très ». Le premier suit l’analogie des mots intensifiés par blago-, «
bon ». Par conséquent, « mauvais » est un adjectif ; le composé ne signifie
pas « ceux qui se sont détournés vers le mal ».
h. La
nuance de utvrûideni est
difficile à établir (« confiné », Morfill, The
Book of the Secrets of Enoch, p.
6 ; « attaché », APOT. vol.
2, p. 433), car
utviriati signifie
« soutenir », « renforcer ».
-
i.
Ce détail manque dans les manuscrits courts, bien que l'information
pertinente y soit présente au chapitre 18. En 2 En 18:7, toutes les
traditions déclarent que ces anges déchus sont « sous la terre », un
détail que l'on retrouve également en 1 En 10. (Le deuxième ciel de 2 En
est comme le troisième ciel d'ApPaul.) Le schéma peut être harmonisé si
la situation actuelle des anges déchus dans le deuxième ciel est
temporaire. Après le jugement du « grand jour du Seigneur », ils seront
consignés dans un enfer souterrain, anticipé en 2 En 18:7. Cf. l'enfer
conventionnel de 2 En 40:13-42:2, occupé par des humains damnés.
En
2En, il semble y avoir quatre degrés d’anges mauvais : (1) leur prince.
Satanail, apparemment dans le cinquième ciel avec (2) les Veilleurs, qui
fréquentaient les femmes à Ermon ; (3) les anges apostats du deuxième ciel ;
et (peut-être) (4) ceux qui sont condamnés à être « sous la terre ». Le NT
connaît aussi des armées de méchants dans les lieux célestes. Origène
lui-même n’a pas réussi à catégoriser les différentes espèces d’anges
déchus. Deux principes fonctionnent en sens opposé. D’une part, puisque le
pire est la corruption du meilleur, la profondeur de tous est
proportionnelle au rang originel. Satan était l’un des archanges les plus
élevés ; les Veilleurs, qui commettent les péchés ignobles de Gen 6,
deviennent des diables ; les anges mineurs, qui ne font que suivre,
deviennent des démons. Mais en 2En, les cieux sont dans une échelle
ascendante, et les anges méchants du cinquième ciel sont pires que ceux du
deuxième.
La
caractérisation de ces derniers est vague. Ils espèrent évidemment le salut
; ils suscitent la compassion d'Enoch. Ils lui demandent de prier pour eux.
Il ne considère pas cela comme impossible parce que leur sort est
inévitable. Il s'excuse plutôt par des réponses évasives : c'est un homme ;
il ne sait pas où il va ; il n'a personne pour prier pour lui. La visite
d'Enoch au deuxième ciel se termine sur cette note vague.
-
j.
JP a la variante Mee pour mtdu d'autres
MSS. VU dit « à Dieu », sans doute sous l'influence du titre précédent.
-
k.
P est d'accord avec AU etc., contre les autres courts manuscrits, qui
ont « et . . . ou » plutôt que « ou ... ou ». P a Hi
. . . albo, ce
dernier en vieil ukrainien (Slovnik
staroukrains'koî movi xiv-xv st. (Kiev,
1977) vol. 1, p. 69).
8 a.
A comporte G NBO, « 3 Ciel » en grandes lettres dans le texte ; U dans la
marge.
b. Ce
détail n'est présent que dans J P. R. et est d'accord avec les courts
manuscrits. Cette traduction littérale suggère qu'il vole lentement
sûgljadavû krugûmî = periblepsamenos. Dans
2En 42, le paradis d'Edem est situé à l'est comme dans la Bible, du moins
dans la recension la plus longue. En fait, il est à l'est de l'endroit où le
soleil se lève (42:4). Il semble être au même niveau que la terre, car
[A]
en pleurs. Et
je dis aux hommes qui étaient avec moi :
3 Pourquoi
sont-ils tourmentés ? Les hommes me répondirent : Ce sont de méchants rebelles à
l’Éternel, ils n’ont pas écouté la voix de l’Éternel, mais ils ont consulté leur
propre volonté.
4 Et j'eus
pitié d'eux. Les anges se prosternèrent devant moi. Dem 33:1 Et ils dirent:
Homme de Dieu, prie le Seigneur pour nous!
5 Je leur
répondis : « Qui suis-je, moi, un homme, pour prier pour les anges ? Et qui sait
où je vais, et ce qui m’attend ? Et qui priera pour moi ? »
8
1 Et ces
hommes m'ont enlevé de là, et m'ont fait monter au troisième ciel. 2Cor 12:2,4
Et ils m'ont placé au milieu du paradis. Et ce lieu a une
apparence
d'agrément qui n'a jamais été vue .
2 Tous
les arbres étaient en fleurs, tous les fruits étaient mûrs, toute nourriture
donnait de bons fruits, et toute odeur était agréable. Les quatre fleuves
coulaient avec douceur, et toute espèce de jardin produisait toute espèce de bien .
3
nourriture. ·Et l'arbre de vie est dans ce lieu, sous lequel le Seigneur se
repose 15:4; 22:2.14; quand le Seigneur se promène 1 dans
le Paradis. Et cet arbre est indescriptible pour 7 C |ï3 ; 8:5f zra une
douceur de parfum. a p Mos 22:4
elle
est ouverte jusqu'au troisième ciel (42:3).
Les
traditions sur le Paradis dans 1 En 1 sont également mélangées. Il y a le «
jardin de vie » (60:23 ; 61:12), « le jardin où vivent les élus et les
justes » (60:8), « le jardin de justice » (77:3). Il se trouve de l’autre
côté de l’océan (77:3) « aux extrémités de la terre » (106:7-8). Cela
ressemble plus à l’endroit où Gilgamesh va consulter Utnapishtim. C’est là
qu’Hénoc lui-même finit par se rendre (1 En 60:8), et probablement le
paradis où Michel a emmené Melkisédec dans 2 En 72:9. C’est là que
Mathusalem et Noé vont consulter Hénoc (1 En 65:2).
Dans
d’autres parties de l’En, le Paradis est situé différemment. Aux chapitres
37-71, il se dirige vers l’ouest (52,1), « jusqu’à l’extrémité des cieux »
(39,3). Mais au chapitre 70,1-4, il se dirige vers le nord-ouest. Dans le
voyage mythologique d’Enoch, en lEn 17s., 23-25, le Paradis est un
merveilleux jardin au nord-ouest, près de la montagne divine. Il abrite
l’arbre de vie, et les rivières en jaillissent.
c. Le
mot d'emprunt persan est passé dans de nombreuses langues comme nom propre,
Paradis. À l'origine, Éden était l'emplacement du jardin, et le sumérien Edin signifie
« steppe ». La domestication en hébreu a donné l'étymologie « agréable ».
D'où jannât
*an-na'îm ou jannât
'adn dans
le Coran, et l'adjectif blag- en
2En.
La
désignation du paradis céleste (jannâ
'àliyâ) comme
« jardin d'Eden » est une tradition juive plutôt que chrétienne (Palache
1920). D'autre part, la transformation en Edem est
LXX, tandis qu'Edom est le
terme éth.
2En
n’utilise le terme « jardin » (= gari) qu’occasionnellement
; mais le lien est toujours là, notamment dans l’accent mis sur les arbres
et les parfums.
-
d.
AU est lu nevidimo. D'autres
manuscrits (de plusieurs familles) sont d'accord en nesûvédimo. La
lecture de AU pourrait être une erreur, influencée par la vidènija
suivante (tous
les manuscrits de la recension plus courte), alors que
J etc.
ont vidékhü, «
j’ai vu ». Cette insistance sur le fait de voir jette un doute sur
l’affirmation d’A U selon laquelle le Paradis n’a jamais été vu, à moins que
cela ne signifie qu’il ne ressemble à rien de ce qui a été vu sur terre (3:3
; 7:2). SJS donne
une gamme de significations pour nesüvé-domü, y
compris « indescriptible ».
-
e.
P seul donne zrékhü, «
j’ai vu », contre zrélü (A
et le reste), « mûr ».
-
f.
La tradition de Genèse 3:8. Mais ici, cela ressemble à une pratique
continue, puisque ce Paradis fait partie du complexe céleste. Ézéchiel
28:13 appelle Éden « le jardin de Dieu » et Genèse 13:10 parle du «
jardin de Yahweh », qui est le summum de la fertilité et de la
prospérité.
g. La
lecture vuskhoditï de
JPRVN contraste avec vkhoditï de
BB 2 et est plus
difficile. U lit par erreur khvoditï. A
lit khoditü, une
simplification secondaire (?). Il y a une difficulté similaire dans la
description du mouvement des nuages en 5:2. L'idée du Seigneur « montant »
au Paradis est incongrue avec sa position habituelle au septième ciel. Vûskhoditi est
la traduction standard de anabainein·,
voskhoidenije, «
le lever (du soleil) » est un dérivé caractéristique. L'idée de retour aux
origines ou de retour périodique pourrait être présente.
-
h.
L’orthographe « paradis » correspond à rai, le
mot natif.
-
i.
La teinte exacte de l'érüvenno est
difficile à établir. Elle peut être rouge foncé, cramoisie ou violette.
-
j.
Slave, ves
porod ,
sur lequel JPR est d’accord. Comme Vaillant l’a souligné (Secrets, pp.
xvii et 88), il s’agit d’une erreur grammaticale. Il faudrait plutôt
dire vsu
poradu, comme
si un scribe avait remplacé rai par poroda sans
ajuster le genre. Le passage correspondant dans la version de 1384 de
la Disputatio est pokryvajetî
vest rai. Il
n’y a donc aucun doute que porod est
secondaire dans 2En à ce stade.
la
racine est au Paradis à la sortie k qui
mène à la terre.
Et le paradis
est entre le corruptible et l'incorruptible. Et deux ruisseaux sortent, l'un
source de miel et de lait, et l'autre source qui produit de l'huile et du vin.
Et il se divise en quatre parties, et elles circulent avec un mouvement
silencieux.
Et ils
sortent dans le paradis d'Edem, entre le corruptible et l'incorruptible. Et de
là, ils passent et se divisent en 40 parties. n Et
cela procède en descente le long de la terre, et ils ont une révolution dans
leur cycle, tout comme les autres éléments atmosphériques.
Et il n'y a
là aucun arbre stérile, tout arbre porte du fruit, et tout lieu est béni.
Et il y a 300
anges, très brillants, qui veillent sur le Paradis ; et avec une voix incessante
et un chant agréable, ils adorent le Seigneur chaque jour et à toute heure. Et
je dis : « Comme cet endroit est agréable ! » Et ces hommes me dirent :
9 |La
révélation à Enoch de la place de ceux qui sont justes et bons. Parole « 8. »| ״
« Ce
lieu ? Enoch/ a été préparé 0 pour
les justes, 1
qui souffrent
toute sorte de calamités dans leur vie, qui affligent leurs âmes, qui détournent
les yeux de l'injustice, qui pratiquent la justice, qui donnent du pain à celui
qui a faim, qui couvrent de vêtements celui qui est nu, et qui relèvent celui
qui est tombé,
k.
Il est difficile de se faire une idée précise de la situation. Peut-être
que le mot « extrémité » est utilisé comme dans 1 En 106,7s.
Normalement, iskhodit
(= exode) signifie
« sortir » au sens verbal plutôt qu’au sens substantiel. Je n’ai pas pu
trouver d’équivalent à l’expression « l’exode de la terre ». Il y a
cependant un indice. Par une série d’associations, iskhodit peut
se référer au lieu où le soleil se lève (môsa). Dans
Ps 75,7 (= 74,7), par exemple, les manuscrits varient entre iskhodit
\iiskodit vistaka (=
est). Cela concorde avec 2En 42,4 (J).
Ces détails manquent dans A etc., tant au ch. 8 qu'au ch. 42. Soit un
scribe les a ajoutés à un original ressemblant à A, sans se soucier de
l'incohérence de l'emplacement ; soit un scribe les a supprimés d'un
manuscrit comme J afin de pallier l'incohérence. La position de la
référence aux quatre fleuves en 8:2 (A) semble maladroite, car elle
interrompt la description de la fécondité des arbres. La description du
Paradis au ch. 42 dans A etc. semble plutôt vague en comparaison des
détails des manuscrits plus longs. La remarque sur l'olivier (8:5, A
etc.) semble inutile après la remarque selon laquelle le jardin contient
toutes sortes d'arbres fruitiers. Elle semble être un débris du récit
plus complet de J sur les quatre fleuves.
I.
Bien que cela puisse suggérer que le Paradis se situe dans une zone
entre le ciel (incorruptible) et la terre (corruptible), une autre
explication est possible. L'astronomie antique faisait une distinction
entre le
kosmos, où
régnait l'ordre, et l'ouranos, où
les choses étaient plus irrégulières, ou, du moins, où le changement
était possible. Si, dans la cosmologie de 2En, les cieux 1 et 2 sont la
région du changement, et les cieux 4- Ί sont
immuables, le Paradis, dans le troisième ciel, est entre les deux. Mais
comme il y a des anges déchus dans le deuxième et le cinquième ciel, et
des êtres humains bons et mauvais dans le troisième ciel, ce Paradis ne
se situe pas entre deux niveaux clairement définis de bien et de mal. Le
concept de « corruptible » ne semble pas être moral.
Les mots tîlénije et netlênije se
traduisent par
phtharton et aphtharsia dans
1Co 15,53. L'apôtre passe du concret à l'abstrait, un point subtil mais
important. Le corruptible ne devient pas incorruptible, il revêt
l'incorruptibilité.
m.
La lecture de P niskhodjalii, «
descendre », est secondaire et inférieure. P a également perdu par
homéotel-euton les mots « et ils se divisent en 40 parties et continuent
». Dans le vers suivant, il a perdu les mots « et chaque arbre est bien
fructifié et chaque lieu » par le même procédé. Il a également perdu
l'adjectif « atmosphérique ».
n.
En tant que glose, cette affirmation ne semble pas motivée. S'agit-il
d'une réminiscence de la « Source des 40 », Nebael'Arbain, entre
Byblos et Baalbek, un centre de culte notoire dans l'Antiquité ? La
source de Pella en Décapole est appelée 'Um
'Arbain, «
mère des quarante (sorties ?) ».
o.
« Dieu ». A U. Tous les autres manuscrits contiennent « Seigneur ».
p.
Pluriel ; c'est-à-dire tous les jours, mais aussi pour la totalité de
chaque jour.
9 a.
J est d'accord avec P pour qu'un nouveau ch. commence à ce point
inapproprié. Il n'y a pas de rupture dans A.
b.
Ce chapitre présente des affinités notables avec Mt 25, 31-46 : (1) la
désignation de « juste » ; (2) l'idée d'un lieu « préparé » ; (3) les
mesures éthiques ; (4) la disposition des actions vertueuses par paires.
Il existe également des différences substantielles, en dehors de
Et près de
lui se trouve un autre arbre, un olivier, d'où coule continuellement une huile
ruisselante.
6
7 ·Et
chaque arbre porte du fruit.
Il n’y a pas
d’arbre sans fruit, et chaque lieu est béni.
8 Et
les anges qui gardent le Paradis sont très splendides.
Avec
une voix sans fin et un chant agréable, ils adorent Dieu° tout au long du jour. p Et
je dis : « Que ce lieu est agréable ! » Les hommes me répondirent :
9
« Ce
lieu a été préparé, Énoch, pour les justes,
qui
souffrent toute espèce de tribulations dans cette vie et qui affligent leur
âme, qui détournent les yeux de l'injustice et qui pratiquent la justice,
pour
donner du pain à celui qui a faim, et pour couvrir de vêtements celui qui
est nu.
Ha
33:15; Ps 119:37
et
pour relever ceux qui sont tombés,
Ézéchiel 18 : 7 ; Ésaïe 58:7 ; Mt 25:35.
V; 4
Esdras 2:20;
Baignoire 4:16
Esaïe
1:17; Jcr 22:3
Le
point capital est que le Fils de l'homme est le juge : (1) le contexte
est tout à fait différent ; (2) les bonnes actions de Mt sont
exclusivement humanitaires, alors que 2En a des devoirs religieux et
l'endurance de la persécution ; (3) en fait, il n'y en a que deux en
commun : soulager la faim et la nudité. La communauté qui utilisait 2En
9 comme code était plus consciemment pieuse que la communauté de Mt 25.
Son monothéisme éthique simple conviendrait à tous les « craignant Dieu
» ; et il souligne le thème constant de 2En : l'adoration exclusive du
Seigneur comme seul Dieu.
c.
La version longue est plus ordonnée que la version courte ; mais la
plupart des différences semblent être dues à une simplification de la
rhétorique originale ou à l’ajout de gloses homilétiques. Ainsi, le bloc
d’actes humanitaires du milieu est énoncé avec des infinitifs dans A.
Ceux-ci ont été étendus aux injonctions suivantes dans V, mais dans J,
tous sauf le premier ont été normalisés en propositions relatives. Ce
processus est complet dans P ; mais R conserve le modèle de A U.
L’importance de cet arrangement sans doute plus authentique est que ces
quatre pratiques définissent ce que l’on entend par « jugement juste ».
L’absence de « et » dans AUVN le confirme.
D’autres changements stylistiques incluent :
I.
Mouvement de « Enoch », puisque le vocatif est retardé (VN est d'accord
avec RJP pour le mettre plus tôt). En B, il apparaît même deux fois : mêsto
ce.junose, predivnymû i enokhu ugotovanno esti. La
variante « jeunesse » apparaît à nouveau en B dans l'énoncé
correspondant en 10:4. Notez également l'erreur d'inattention de B en
lisant pravednikomù (
* * juste ”) comme predivnymu (
' ' merveilleux ”) ; et le datif enokhu conduit
à un résultat incongru : « Ce lieu a été préparé pour
le
juste (et pour) Enoch. » Mais AU a aussi le datif apparent.
2.
Réorganiser les clauses de façon à ce que le verbe vienne en premier :
ainsi, toutes les clauses RJP ont « devant la face du Seigneur » après «
marcher » ; mais seule P s’est déplacée « nue » pour suivre « vêtir ».
Notez que la construction « a été préparée », derrière laquelle se
trouve probablement un participe parfait grec, a dérangé les scribes.
Les gloses incluent l’ajout de « toute sorte » à « calamité » (RJP),
l’ajout des mots « et [pas P, d’où la traduction (A) dans APOT, vol.
2, p. 434 ! orphelins » à « blessés » (JR) ; l’ajout de « sans défaut »
à « marcher » (RJP). VN a élargi « et nu se couvrir d’un vêtement » (où
AU est d’accord avec RJ) à « et le nu s’habiller et se couvrir d’un
vêtement » (d’où la traduction [B] dans APOT, vol.
2, p. 434). On peut voir à partir de cela que les deux manuscrits
utilisés dans APOT représentent
des déviations extrêmes par rapport à la ligne principale. Des
variations mineures incluent le changement de « cette vie » (iitii
semü [A])
en « leur vie » (svoemi —
V aussi bien que JR ; la phrase manque dans P). V se lit également zivotè. Dans
AU, le mot « lieu » n’est pas présent à la fin, mais comme il est
présent dans VN, il s’agit d’une imperfection dans A U. P donne une
tournure théologique unique au deuxième point en lisant « de ceux qui
affligent » au lieu de « et qui affligent » (cf. APOT, vol.
2, p. 434). Cela s’éloigne de l’idée, présente dans tous les autres
manuscrits, selon laquelle les souffrances auto-infligées sont
méritoires.
d.
Le même mot est utilisé pour le lieu de tourment (10:4) et aussi pour le
lieu de jugement (49:2).
e.
Slave, napasii =
Gk. épeireia, «
abus ».
[J]
et qui aident
les blessés et les orphelins,
et qui
marchent sans défaut devant la face du Seigneur,
et qui
l’adorent lui seul,
même pour
eux, ce lieu a été préparé comme un héritage éternel.
10 |
Ici, ils montrèrent à Enoch le lieu effrayant et diverses tortures. Parole
''9.''|
Et ces hommes
m'ont porté 1
dans la
région du nord ; et
ils m'ont montré là un endroit très effrayant;
et
toutes sortes de tortures et de tourments sont dans ce lieu, de cruelles
ténèbres et une obscurité sans lumière ? Et il n'y a pas de lumière là-bas, et
un feu noir brûle c perpétuellement
? avec une rivière de feu c qui
sort sur tout le lieu, du feu ici / de la glace glaciale g là-bas,
et il sèche et il gèle ?
et des lieux
de détention très cruels et des anges sombres et impitoyables, portant 3
instruments d'atrocités torturant sans pitié.
Et je
dis : Malheur, malheur ! que ce lieu est affreux ! Et ces hommes me dirent : Ce
lieu, Énoch, a été préparé pour ceux qui ne
glorifient pas Dieu, qui commettent sur la terre le péché contre nature, qui est
la corruption anale des enfants, à la manière de Sodome, la sorcellerie, les
enchantements, les divinations,
le trafic avec les démons, qui se vantent de leurs mauvaises actions, de vols,
de mensonges, d’insultes, de convoitises, de ressentiments, d’impudicité, de
meurtres , et
qui dérobent en secret les âmes des hommes, saisissant les pauvres à la gorge,
leur enlevant leurs biens, s’enrichissant avec les biens des autres, les
escroquant ; qui, quand ils peuvent fournir de la nourriture, font mourir de
faim les affamés ; et,
quand ils peuvent fournir des vêtements, leur enlèvent le dernier vêtement.
f. Cf.
Mt 25,34. 2En semble être un traitement indépendant de ce thème qui, dans
l'Évangile, a été radicalement christianisé. Il est peu probable que 2En 9
soit une version déchristianisée de Mt 25. Si l'auteur de 2En connaissait Mt
25, nous nous serions attendus à des ressemblances plus spécifiques.
10 a.
Les Esséniens croyaient que le Paradis se trouvait au nord. La lecture en
JPR (stranu
= storonu) a
la même ambivalence que l'héb. gèbûl, «
frontière » ou « région ». En russe moderne, ce terme a été différencié en strana, «
pays », et storona, «
côté », d'où « côté » (APOT,
vol. 2, p. 435). Mais auparavant, il s'agissait de simples variantes, toutes
deux recouvrant toutes ces significations. Khôra (?) d'origine
·
-
b.
JPR est d’accord avec les autres manuscrits sur les adjectifs ajoutés à
« obscurité » et « tristesse ».
-
c.
Au lieu de « un feu noir… avec une rivière de feu », comme le disent les
manuscrits longs et courts, VN a écrit « feu et flammes et noirceur ».
-
d.
La variante prisno
de P n'est
qu'un synonyme.
-
e.
Le « fleuve de feu » est mentionné pour la première fois en Dn 7.10.
L’image d’un volcan est présente sous la forme du « lac de feu » en Ap
19.20 : 20.10, I4s. ; 21.8. 1En 14.19 ressemble encore à Dn 1.1, tandis
qu’en 2En le fleuve de feu n’est pas encore le lieu et le moyen de
punition comme dans Ap 1.1. Comparer SibOr 2.196-200 : 252s. : 286 :
3.84 ; 8.411 ; ApPet 8 ; ApPaul. Philippe prie avant son martyre pour
être délivré des « eaux de feu » (ANT, p.
450), mais cela pourrait venir de l’Apocalypse.
-
f.
Dans 1 En 14:3, la maison de Dieu est « brûlante comme le feu et froide
comme la glace ». Dans 2 En, Dieu est comparé à un feu ardent. L’idée
que « l’âme est un élément froid » se trouve chez Aristote (De
anima 1.2.405b).
Origène (Des
premiers principes 2.8.3),
s’efforçant d’établir le sens du mot « âme » par étymologie, spécule
qu’une chute de la vertu est un refroidissement de l’ardeur pour Dieu,
tant l’état naturel des choses mauvaises est froid. Le deuxième concile
de Constantinople a condamné l’opinion (attribuée à Origène) selon
laquelle les démons ont « des corps froids et troubles » en raison du
péché.
-
g.
D’autres manuscrits ne confirment pas le « et » dans P qui a donné « gel
et glace » dans APOT, vol.
2, p. 435.
h.
Pour les noms de P (« soif et frissons » [APOT, vol.
2, p. 435]), J et R s'accordent dans l'utilisation des verbes. En raison de
son accord avec P, nous avons adopté l'ordre de R plutôt que celui de J. La
rime zebet
(zjabti), iezet (zazdati) explique
l'orthographe, dans laquelle J et R s'accordent. Cette chaleur froide dans
une action dessèche et glace.
i.
Nous préférons d’autres manuscrits courts, par exemple i
muceste (V),
à AU imuste, «
ayant », ce qui est clairement une erreur.
j. La
remarquable lecture yunose, clairement
lisible dans A, confirme le témoignage de V, qui contient cette variante
quatre fois (pas ici), et d'autres manuscrits, selon lesquels il existait
une tradition dans laquelle Enoch était adressé de cette manière. La
similitude avec le vocatif enote pourrait
expliquer la variante comme une simple erreur de copiste. Mais il est
surprenant que ce ne soit que dans l'adresse, jamais dans la description,
que le terme soit utilisé. La variante jenokhü est
rare. Il n'y a aucune raison phonétique
et pour aider
les blessés qui marchent devant la face du Seigneur,
et qui
l'adorent lui seul. Lc
1:6
pour eux ce
(|lieu|) a été préparé comme un héritage éternel.
10
-
1 Et
les hommes m'emportèrent de là, et me firent monter au ciel du nord ; et ils
me montrèrent là un lieu très effrayant ;
-
2 Il y a dans ce lieu toute espèce de tourments et de supplices, et il n'y a
que ténèbres et obscurité. Dan 7:10; Rev Il n'y a là point de lumière, mais
un feu noir brûle continuellement, et un fleuve de feu sort par tout
le lieu, comme de la glace froide;
-
3 ·et
lieux de détention
et des anges
cruels et porteurs d'instruments de torture, tourmentant sans pitié.
qui
pratiquent la sorcellerie et les |enchantements|,”'
et qui se
vantent de leurs actes.
qui délie le
joug qui a été serré ;
qui
s’enrichissent frauduleusement des biens d’autrui et provoquent la mort des
affamés ;
ne pas être
en mesure de subvenir à ses besoins ; et ne pas être en mesure
pourquoi la première voyelle devrait changer en ju
: *junokhu n'est
jamais trouvé. Mais ce ne peut pas être une coïncidence si ce titre est
identique à celui d'Enoch ( = Meta-fer) dans 3En. [Voir la discussion sur «
Metatron » par P. Alexander dans 3 Enoch. —JHC]
-
k.
Les vices pour lesquels les méchants sont torturés ne sont pas
simplement l’opposé des vertus du chapitre 9, ni des péchés d’omission
correspondants, à l’exception de l’inanition des affamés, du dénuement
des démunis et de l’idolâtrie. Même ainsi, les schémas sont compatibles,
du moins lorsque les gloses sont supprimées ; mais ici les arts noirs
sont interdits. Les devoirs juifs plus spécifiques – la circoncision,
l’observance du sabbat, les tabous alimentaires, les tabous sexuels (par
opposition à la fornication et aux pratiques déviantes) – ne sont pas
énumérés. Il n’y a rien ici qu’un craignant Dieu, juif ou chrétien,
n’affirmerait.
-
I.
La référence à la sodomie ne se trouve que dans P, qui comporte des
ajouts similaires au ch. 34. Sur prokhodù
= otverstie («
ouverture »), voir MSD, vol.
2, p. 1604. Slave, zadneprokhodnoeotverstie =
« anus ».
-
m.
VN est d'accord avec JPR pour lire obajanije, qui
signifie « magie » ou plus précisément « calomnie ». La lecture de AU (obaienija, «
calomnies ») est inférieure.
n. La
liste des vices à la fin du v. 4 ne se trouve que dans P.
o. La
référence est assez obscure, et JPR ne l'a pas. Ailleurs, le joug est un
symbole d'acceptation de l'autorité de Dieu. Voir le n. sur 34:1. Dans un
contexte qui parle de fraude, le péché pourrait être de manipuler la
balance. Voir 44:5 ; zugos pourrait
être mèrilo.
Il
pourrait y avoir une confusion dans les verbes. S’agit-il de
réfati ou de
réSitï ? Ce
dernier, indiqué par résetï (V) (MSD. vol.
3, p. 227), signifie « délier, délier ». Mais réSatû (AU)
peut se référer à certains des pires sacrilèges, comme le fait de retirer au
nouveau baptisé sa robe baptismale et de laver la partie du corps qui a été
ointe avec l’huile sainte. Le mot est utilisé ainsi dans le Sermon sur la
Croix du Dubensky Sbomik. Il décrit en termes de la plus grande horreur
quelque chose d’« inconcevablement mauvais » qui est fait à la croix. Si le
« joug » ne désigne pas la malhonnêteté dans l’utilisation de la balance,
mais plutôt la violation d’une obligation morale sacrée, alors nous n’avons
aucune idée de ce à quoi il peut se référer.
p. Il
y a une divergence entre les deux recensions et une différence considérable
dans l'ordre des mots. JPR dit qu'ils sont « capables de fournir de la
nourriture » ; mais AUB lit « pas capables » (deux fois dans AU, une seule
fois dans B). Ici, V et N concordent avec des manuscrits plus longs, bien
que V lise nakrimity (un
synonyme de nasytiti,
dans lequel d'autres manuscrits concordent). La lecture solitaire gladnija de
P fait
de « le vide » l'objet de « satisfaire », mais gladom, «
faim », de JR, ainsi que l'ordre différent des mots d'autres manuscrits,
montrent que cela est instrumental avec « tuer ». Deux mots distincts sont
utilisés ici, chacun pouvant rendre limos
— gladü ou alùéi (f. alûéa). Aléuftija ou gladnija peuvent
signifier « famine ». La coexistence des synonymes dans tous les manuscrits
montre que de telles paires ne contractent pas nécessairement les dialectes
ou les traditions .
6 qui n'ont
pas d'âme, qui ne peuvent ni voir ni entendre, dieux vains, qui construisent des
images et se prosternent devant des choses viles faites de main d'homme. Pour
tous ceux-là, ce lieu a été préparé comme une récompense éternelle.
11 |Ici,
ils emmenèrent Enoch au 4e ciel, où se trouvent les traces solaires et lunaires.
Mot « 10. » | a
Et ces hommes
me prirent et me transportèrent jusqu'au quatrième ciel. Et là, ils
me montrèrent tous les mouvements et toutes les séquences, et tous les rayons de
lumière solaire et lunaire. Et je mesurai leurs mouvements et je comparai leur
lumière. 2 Et je vis que le soleil a une lumière sept fois plus grande que la
lune. Et je vis son cercle et ses roues sur lesquelles il marche toujours,
passant toujours comme le vent avec une vitesse tout à fait merveilleuse. Et son
aller et son retour ne lui laissent aucun repos, jour et
nuit.
Et 4 grandes étoiles,
chacune ayant 1000 étoiles sous elle, à droite du char du
soleil, et 4 à gauche, chacune ayant 1000 étoiles sous elle, en tout 8000,
marchant perpétuellement avec le soleil.
Et 150 000
|anges| l'accompagnent le jour, et 1000 la nuit. Et 4 1100| anges marchent
devant le char du soleil, à six ailes, dans un feu flamboyant ;
et le
soleil brille et enflamme les 100 anges.
q.
Le mot « idoles » n’est présent que dans J. RP et dans d’autres
manuscrits, il s’accorde avec le mot « dieux ». La glose « qui ne
peuvent ni voir ni entendre » n’est présente que dans J. P. L’épithète istukanny
(glypioi) n’est
présente que dans P.
r.
slave, dostoanie. Contraste
avec nasléde, «
héritage » (9,1). Les deux mots sont utilisés dans les Évangiles pour
traduire klêronomia.
11 a.
A cet endroit, A porte en
marge D (=4) NBO (=
ciel) en grosses lettres. Dans le texte, les manuscrits varient entre le
chiffre (par exemple A) et le mot (par exemple U).
-
b. L'introduction illustre le type de variation qui se produit
continuellement dans ces manuscrits. La plupart des manuscrits ont
deux verbes (en V, ce sont vuzdvy-gnusta et vùznesosta, cf.
NB etc. ; en J, vuzjasta et vozvedoSu, cf.
PR), mais les AU n'ont que vozdvigosta, un
cas simple de perte par homoioarkton.
-
c. On ne sait pas exactement quelles réalités astronomiques sont
entendues par prèkhoidenia, «
transitions ». C’est probablement pour cette raison que nous avons
simplifié le texte. En omettant « et », P arrive à « allers-retours
successifs », mais cela se lit predkhodnaja. Peut-être
l’original était-il un hendiadys.
-
d. L’hésitation des scribes à utiliser des synonymes est illustrée
ici. Le grec est particulièrement riche en mots pour « lumière ». Le
slave a luca (le
meilleur aktis) ou svétû (le
meilleur phds, opposé
à « obscurité »). Mais ce dernier a aussi le sens plus large de «
monde », « vie », « âge » (Côlâm,
aiôn). Ici,
les deux sont utilisés dans les manuscrits de plusieurs familles,
mais la question est de savoir si « rayons de lumière » est glose ou
si « rayons » (AUB) représente une simplification. Dans ce qui
suit, svëtü est
utilisé par tous. Une autre confusion surgit dans le mot pour « lune
». Les manuscrits courts ont des noms, « soleil et lune » ; les
longs sont passés aux adjectifs, « solaire et lunaire ». Le mca
(mesjaci) apparemment original a
évolué en « mois », tandis que le synonyme luna reste
« lune ». R a toujours mésjaënago mais
JP a lunnago. Le
caractère secondaire des lectures avec lun- est
prouvé par l'erreur dans AU au v. 2 — « plus grand que le soleil (!)
» — il devrait être « lune » ; et mia, comme lu par R et par tous
les manuscrits courts sauf
5
AU
explique les autres lectures. Dans le JP, il a été remplacé par son
synonyme luny
; tandis
que slnca (AU)
est une mauvaise lecture de la terminaison identique, une erreur qui
n'est pas si facile à commettre avec luny. L'idée
semble être une déduction exégétique d'Isa 30,26 ; voir aussi 2En 66,7s.
Un
kru
ea et une kolesnica
R
krugï
eju et école de commerce eju
g JP kru
emu et la fac d'émeu
g
L’image semble être celle d’un circuit (krugü
= kyklos) autour
duquel le soleil et la lune conduisent leurs chars. Que les deux corps
célestes soient en vue est démontré par kozdo
eju, «
chacun des deux », qui suit, et dont l’accord de RVA prouve la
supériorité. JP lit « toujours ». De la même manière, RV, qui lit « leur
cercle (duel) », est meilleur que AUB 2 («
elle ») ou JPB Chr (« son »). Le regroupement des manuscrits longs et
courts des deux côtés suggère que des erreurs similaires se sont
développées indépendamment. Le pronom féminin de AU est inexplicable, à
moins qu’il ne s’agisse d’une simple erreur de duel, puisque sülnce est
neutre en slav. Mais « lune » est féminin ; voir ch. 16. En tout cas, le
singulier montre que JP ne parle déjà que du soleil à ce stade. Français
Le remplacement de « char » par « roues » par J (kolo,
koleso signifie
aussi « cercle » et est donc un quasi-synonyme de krugü) pourrait
être une démythologisation délibérée, car cela apparaît à nouveau au ch.
14 ; mais la plus grande partie de l'image est toujours intacte. En
11:2, 4, JP lit kolo contre kolesnica d'autres
MSS, et c'est probablement destiné à être un synonyme, puisque kola peut
aussi traduire hamaksa. Dans
2En 16, krugü semble
signifier « cycle » (du jour et de la nuit), mais là, AU (et non les
longs MSS) conservent la discussion du char de la lune. En 12:2, les
courts MSS et R (mais pas JP) décrivent les anges « qui tirent le char
du soleil », ce qui est plus concret que J P. Voir la note suivante.
6 pour
fournir des vêtements, enlever le dernier vêtement à ceux qui sont nus ; ·qui ne
reconnaissent pas leur Créateur, mais se prosternent devant de vains dieux,
construisant
des images et se prosternant devant quelque chose fait de main d’homme. Et pour
tous ceux-là, ce lieu a été préparé comme une récompense éternelle.
11
1 Et <|les
hommes|) m'ont soulevé de là (|et ils m'ont porté|> jusqu'au 4e ciel. Et ils
m'ont montré là tous les mouvements (|et déplacements !), et
2 tous
les rayons <|de lumière|) d du
soleil et de la lune. · J'ai mesuré leurs mouvements. J'ai comparé leur lumière.
Et j'ai vu que le soleil a une lumière sept fois plus grande que le soleil(!).
Leur cercle et leurs chars sur lesquels chacun d'eux monte, passant comme le
vent. Et il n'y a pas de repos pour eux de jour et de nuit, quand ils partent et
reviennent.
3 Et
quatre grandes étoiles, tenant le côté droit du char du soleil, 4 du côté
gauche,
4 (allant)
perpétuellement avec le soleil, ·
et
allant devant le char du soleil,
5
f.
En remplaçant le mot original ezditii, «
conduit », par sestvueti, «
se déplace », les JP ont diminué le contenu mythologique. À la fin du v.
2, les JP ont des noms là où d’autres manuscrits ont des verbes. Un
ajustement similaire a été effectué dans 12:2, où le verbe muéet
(vehunf) —
original comme le montre l’accord de R avec les manuscrits courts — est
devenu « accompagner et courir » dans les JP, qui ne font pas non plus
référence au char. C’est d’autant plus remarquable que les manuscrits
longs ont (conservent ?) des détails mythologiques qui manquent
(censurés ?) dans les manuscrits courts.
g.
Une fois de plus, le singulier emu, «
à lui » (de JP), contraste avec le meilleur duel (ima) de
tous les autres manuscrits. Cela semble contredire l’affirmation de 24:5
selon laquelle « le soleil se repose ». Cela ne pourrait signifier rien
de plus que le Soleil ne cesse jamais de bouger ; mais compte tenu de
l’intérêt gnostique pour le « repos », quelque chose de plus
significatif pourrait être impliqué. Cela suggère que « le Soleil » est
un être conscient de lui-même.
Il
est difficile de déterminer, à partir des descriptions du soleil, de la
lune et des étoiles dans ces sections, s’il s’agit ou non d’êtres
célestes vivants. Les descriptions dramatiques et vivantes de leurs
mouvements ne peuvent être qu’une personnification à des fins
littéraires. Le calendrier strictement mécanique ne suggère pas des
êtres libres et rationnels (Origène assimile liberté et rationalité).
Les anges qui les accompagnent servent de causes rationnelles aux
mouvements réguliers, équivalents théologiques des « lois naturelles ».
Origène, qui admet que toutes les créatures sont capables de
développement, et donc de bien et de mal, n'exempte pas les corps
célestes de cette règle. Presque tout le livre Des
premiers principes 1.7
est consacré à l'idée que les étoiles célestes sont des âmes dans des
corps de feu. Il cite Job 25:5 comme preuve que les étoiles peuvent être
entachées de péché (Des
premiers principes 1.7.2).
La
croyance selon laquelle les étoiles sont des êtres vivants remonte à
l’ancien polythéisme et conserve l’expression sophistiquée de Platon,
qui qualifiait les étoiles de « divines » (Timée 30b).
Philon (De
mundi opif.) enseignait
que les étoiles, étant des êtres célestes, étaient incapables de
défection (voir notre discussion sur « incorruptible » dans la note sur
8:5 ci-dessus). L’autre opinion d’Origène (cf. Jude 13) découle de notions
a priori et
d’un désir irrésistible des
anges de
systématiser. Il ne fait aucun doute qu’il pensait que le soleil, la
lune et les étoiles étaient des êtres rationnels (cf. Contre
Celse 5.11).
Son argument principal est le simple fait de leur mouvement en tant que
tel. Cela est confirmé par les Écritures dans lesquelles les ordres sont
adressés aux étoiles comme s’il s’agissait d’êtres responsables. Mais il
avait les deux choses en main : la précision même de leurs mouvements
est considérée comme la preuve de la raison la plus élevée (Des
premiers principes 1.7.3).
2En se situe à un niveau de sophistication bien inférieur. Il se
contente de décrire le mouvement du soleil et de la lune en termes de
faits calendaires, avec un peu de cosmologie, ou plutôt d'astronomie, à
propos des portes. Les anges en sont les causes. Le mécanisme de
locomotion, que ce soit sur roues, dans un char ou sur une orbite
circulaire, n'est pas clair. Mais en tout cas, il est assez grossier
dans sa conceptualisation.
Les vues d'Origène sur ce sujet furent vivement attaquées par Jérôme et
Justinien, et la croyance selon laquelle le soleil, la lune et les
étoiles étaient des êtres vivants devint peu orthodoxe. Puisque 2En
décrit le Soleil et la Lune au moins d'une manière mythologique, son
utilisation dans les cercles chrétiens pourrait signifier soit (1) un
accord avec Origène contre Jérôme sur ce point ; soit (2) l'acceptation
de 2En à une époque où la controverse était oubliée ; soit (3)
l'utilisation inoffensive de manières de contes de fées pour parler du
soleil et de la lune.
h.
L'image ne convient pas à un quadrige, traditionnel pour les divinités
solaires, car ici il y a quatre étoiles de chaque côté du char, soit
huit en tout. Tous les longs manuscrits ont la particularité d'avoir
mille anges pour chacun de ces huit.
Dans les manuscrits courts, ces versets ont été condensés de façon
drastique en supprimant les figures extravagantes, ou bien JP a été
embelli. R est encore différent. Il s’accorde au v. 3 que chacune des
huit étoiles a mille étoiles sous elle. Il continue : « Et quinze
myriades d’anges le conduisent pendant le jour, mais la nuit mille
anges, chaque ange ayant six ailes, qui vont devant le char, et cent
anges lui donnent du feu. » Dans JP, les verbes semblent être au
singulier, avec le soleil comme sujet. Le soleil allume et enflamme (les
mots sont synonymes) les cent anges. Mais dans R, les anges attisent le
soleil.
12 |À
propos des merveilleux éléments solaires. Mot « ll. » | a
Et je
regardai et vis des esprits volants, les éléments solaires, appelés phénix et khalkédras ,
étranges et merveilleux. Car leur forme était celle
d'un lion, leur queue celle d'un ... et leur tête celle d'un crocodile. Leur
apparence était multicolore, comme un arc-en-ciel. Leur taille était de 900 g .
Leurs ailes étaient celles des anges, mais ils ont 12 ailes chacun. Ils
accompagnent et courent avec le soleil, transportant la chaleur et la rosée,
(et) tout ce qui leur est commandé par Dieu.
Ainsi
il traverse un cycle, et il descend et il monte 3 à travers le ciel et sous la
terre h avec
la lumière de ses rayons. Et il était là, sur la voie, sans cesse.
13 |Les
anges prirent Hénoc et le déposèrent à l'Orient, aux portes solaires. Parole «
12. » | a
Et ces
hommes m'emportèrent vers l'est
(de ce ciel).
(I Et
ils m'ont montré|) les portes solaires par lesquelles le soleil sort selon le
rendez-vous des saisons et selon les phases de la lune ? pour toute l'année, et
selon
les
chiffres sur l'horloge, jour et nuit. ·Et je vis 6 portes ouvertes , chaque
porte 2 ayant
61 stades et un quart de stade. Et j'ai mesuré soigneusement et j'ai
12 a.
Les divergences entre les manuscrits de ce chapitre ne peuvent être décrites
simplement par référence à des recensions longues et courtes, car il existe
des différences substantielles entre ces deux principaux types de textes.
Les manuscrits courts sont brefs et décousus au point d'être incohérents.
Ils laissent sans réponse des questions telles que :
-
(1) Leur relation avec les « étoiles » qui accompagnent le soleil au
chapitre 11 (la continuité des courts manuscrits à ce stade suggère
qu'ils sont les mêmes, en fait ils sont appelés « anges », et le
discours contraire dans les longs manuscrits, qui ne parlent que des
phénix et des khalkédras, fait défaut).
-
(2) Leur nombre (la répétition du
chiffre dans VNB 2 suggère
qu'il y en a douze, tandis que R |short| a le détail unique qu'il y en a
deux).
-
(3) Leur anatomie (les manuscrits courts ne contiennent que le détail de
douze ailes chacun |tous sont d'accord sur ce point| alors que les
manuscrits longs entrent dans des détails considérables ; R dit
simplement que l'un ressemblait à un phénix,
l'autre à un
khalkèdre, alors que JP les identifie comme ces créatures).
-
(4) Leur fonction (ils « tirent » le char ; l’affaiblissement de ce
terme à « accompagner » en JP seulement est clairement secondaire).
-
(5) Leur tâche de transmettre la chaleur et la rosée à la terre (obscure
dans tous les textes).
-
(6) Leur parcours (ils descendent vers la terre en MSS courts, ils font
le tour sous la terre en MSS longs, et c'est probablement l'image
originale).
-
b.
Cette terminologie est une particularité de JP dans la longue recension.
Voir la, nn
-
c.
Le pluriel (également dans 19:6 — les deux recensions) n'est présent
dans aucune littérature et suggère une ignorance des traditions
anciennes et largement répandues sur cet oiseau qui est partout
ailleurs sui
generis. De
plus, le rôle du ou des phénix en tant qu'oiseau du soleil est ici assez
général. Charles (APOT, vol.
2, p. 436) a affirmé que la connaissance du phénix par Lactance
dépendait de 2En. Van den Broek (Le
mythe du phénix, trad.
I. Seeger [Leyde, 1972] p. 285, n. 1) le nie, avec raison. Parmi de
nombreux détails, 2En ne connaît évidemment pas l'immersion
rajeunissante du phénix au lever du soleil. Dans le même temps, van den
Broek (Myth, p.
260) est d'accord avec Charles dans la mesure où il reconnaît que les
idées de 2En sur le phénix doivent avoir leur origine à Alexandrie.
-
d.
Ce sont des serpents d'airain ; ils sont associés aux chérubins dans 1En
20:7, comparer 2En 19. Dans la description qui suit, les phénix et les
khal-kedras semblent être la même chose.
-
e.
P se lit éudni, J studnyi, et
non pas « froid » (stu-denyi), ni
« honteux » (studinyi). Le
mot de la préface de P, preiudnykh, est
encore plus secondaire.
f. La
connaissance de l’anatomie du phénix ou du khalkèdre acquise ailleurs ne
peut pas être utilisée en toute sécurité ici, car rien n’indique que
l’auteur de 2En en savait plus que les noms de ces créatures. Ézéchiel
1:5-11 ne résout pas non plus le problème. RJP est d’accord sur les détails,
mais chacun des trois utilise la conjonction « et » différemment. P (APOT, vol.
2, p. 436) suggère que les pieds et la queue étaient léonins ; mais R
(Vaillant, Secrets, p.
91) suggère que les pieds, la queue et la tête sont crocodiliens, de sorte
que le corps est celui d’un lion. Ce n’est pas strictement le sens de obrazii, «
forme ».
g. R
utilise les mots « neuf » et « cent » ; J a le nombre 900 ; P a 900 et «
cent ». La valeur de la « mesure », méra, n’est
pas définie. Dans la littérature de traduction, il s’agit soit de
metron ,
soit de
batos («
volume ») ; ou bien de
*êpâh ou de
bath dans
les textes de l’Ancien Testament (tous deux « volume »). L’unité la plus
évidente est la coudée, l’unité de la Disputatio
(hôs apo pêkhôn ennea).
12
!... esprits
volants,
2 Psaume
110:3
avec 12 ailes
comme celles des anges, qui tirent le char du soleil, transportant la rosée et
la chaleur, lorsque le Seigneur donne l'ordre de descendre sur la terre,
3
avec les
rayons du soleil.
13
Et ils m'ont
montré les portes par lesquelles le soleil sort selon les saisons fixées et
selon le cycle des mois, pour toute l'année, et selon
h. P
et R ont chacun nivelé les prépositions ; P se lit pod
nbsi i pod zemlju, «
sous le ciel et sous la terre ». R se lit po
nbsi i po zemli, «
le long du ciel et le long de la terre ». J est le meilleur, avec po
nbsi i pod zemleju. La
confusion pourrait être due à un conflit de modèles de l’univers, soit une
série de niveaux horizontaux, soit un ensemble de sphères concentriques
autour de la terre. Peut-être les deux peuvent-ils être combinés, avec les
sept « cercles » entre une zone supérieure de lumière et une zone inférieure
d’obscurité. Au chapitre 14, le soleil se déplace d’ouest en est sous la
terre dans l’obscurité chaque nuit.
i. Cf.
le titre du ch. 12 dans P. En akkadien, le mouvement vers l'ouest est
appelé harrân
samsi (ANET, p.
89, n. 152).
13 a.
Ce chapitre est une version très condensée de l'En 72.
-
b.
JP ajoute la préposition ot-, «
de », au verbe.
-
c.
Le mot slave vrata n'a
pas de singulier. Dans les plus anciennes traditions mésopotamiennes,
SamaS sort par une porte à l'est. Dans le poème de Parménide Sur
la nature, les
portes du soleil, qui sont décrites de manière tout à fait littérale,
sont ouvertes par la Justice, détentrice des clés de la rétribution.
L'adjectif « solaire » modifiant « portes » ne se trouve que dans J P. 3Bar
qui compte 365 portes dans le ciel par lesquelles le soleil se lève.
-
d.
Les manuscrits utilisent une variété de verbes pour décrire la sortie du
soleil à son lever.
-
e.
Les manuscrits avec l'adjectif sont meilleurs. En tant que modificateur
de vrèmja,
ustavinyi a
l'idée d'un ordre divin. Il traduit horismenos, qui
dans IClem 20:3 décrit les parcours déterminés le long desquels les
corps célestes « roulent ».
-
f.
Puisque 2En ne s'intéresse pas spécifiquement aux phases de la lune en
tant que phénomène astronomique, ce qui est entendu ici est probablement
le cycle annuel des mois (cf. ch. 16, n. e). Les MSS concordent en
général, mais fluctuent entre le singulier (qui suggère la lune
[Vaillant, Secrets, p.
13|) et le pluriel (qui suggère les mois). Qu'un cycle annuel soit en
vue est démontré par les remarques suivantes sur le raccourcissement des
jours (MSS courts). et par l'expression « l'année entière ». Mais cette
dernière n'est pas présente dans V, qui se lit i
po obikhozdenietni mca vcego, «
selon le cycle de chaque mois ». V est également supérieur à A dans ce
qui suit — « et après raccourcissement à (!) allongement des jours et
des nuits ». L' udlîzeniju
correct de
V est devenu prikhozdeniju, qui
signifie en réalité « arrivée ». Il a été influencé par l' obkhozdeniemi
mésjaca précédent. B
Chr lit ulozeniju, «
diminution ». Les longs MSS soutiennent « jour et nuit ». Avant de
rejeter la référence au cadran solaire (tous les longs MSS), notez son
apparition dans les courts MSS à 15:3.
g. R
dit que les portes étaient « grandes », ce qui concorde encore une fois avec
V et N. Tous les manuscrits concordent sur son apparition en 14:1. Il
pourrait signifier « large » ou « haut ». Il en va de même pour le nom velikota, «
grandeur », qui suit. À ce stade, tous les manuscrits semblent corrompus ;
du moins, il n’est pas possible de déterminer quelles étaient les dimensions
des portes dans les documents sources. Il est plus probable que la mesure
soit la largeur, et non la distance (Vaillant). Nous devons imaginer six
ouvertures le long de l’horizon oriental (peut-être une structure réelle),
qui, lorsqu’elles sont vues du bon point, font que le lieu du lever du
soleil se déplace d’un stade (ou deux) chaque jour.
Les
manuscrits ne sont pas d’accord sur le fait qu’Enoch ait ou non saisi la
taille de ces portes.
j'ai
calculé que leur taille était telle qu'elle permettait au soleil de sortir et de
s'éloigner vers l'ouest.
Et cela
devient régulier et se poursuit pendant tous les mois .
(Et la 1ère
porte il sort pendant 42 jours, j
les 35
deuxièmes jours,
les 35
troisièmes jours,
les 35
quatrième jours,
les
cinquièmes 35 jours,
le sixième 42
jours.)
Et puis il
fait encore une fois demi-tour et revient dans l'autre sens à partir de la 4e porte
sixième, selon le cycle des saisons :
(Et il entre
par la cinquième porte 35 jours, la 4ème 35 jours,
les 35 jours
3,
les 35
deuxièmes jours).
Et ainsi
s'accomplissent les jours de toute l'année, selon le cycle des cinq quatre
saisons.
14 |Ils
transportèrent Énoch vers l’ouest. Parole « 13. »|
Et puis ces
hommes m'emportèrent à l'ouest du ciel/ et ils me montrèrent six grandes portes ouvertes,
correspondant au circuit des portes orientales, en face d'elles, où le soleil se
couche selon le nombre des jours/ 365 et 1/4. d
Ainsi
il retourne encore une fois aux portes de l'est, sous la terre. c (Et
quand 2 il
sort par les portes de l'ouest), il enlève sa lumière, la splendeur qui est son
rayonnement, (et quatre cents anges prennent sa
|
sort (vss. 3, 4) |
s'éteint (vs. 3) |
entre (vss. 3, 5) |
|
JP Ishhodit |
idée |
vuskodit |
|
R iskhodit |
idée |
vükhodit |
|
AU vkhodit (3) |
idée |
vkhodit |
|
ischodie (4) |
|
|
S.
Novakovic (« Apokrif o Enohu », Stdrine
XVI [Zagrele
(Agram)] pp. 65-81) rapporte vïskhoditï comme
premier verbe dans le manuscrit de Belgrade ; mais V se lit vîkhôdytî. Il
est facile de voir comment vûskhodil, «
monter », s’est glissé. La même scission se produit au v. 5 entre R et J
P. C’est-à-dire que AU sont erronés au v. 3 ; JP sont erronés au v. 3
(ils sont défectueux au v. 5). Les scribes considéraient le lever du
soleil du point de vue humain ; mais les originaux le décrivent du point
de vue du soleil. Il « sort » le matin et « rentre » la nuit. Au ch. 14,
un verbe différent encore, zakhodit, décrit
le coucher du soleil.
Son retour à travers eux suggère le déplacement du point du lever du
soleil à travers l'horizon d'un solstice à l'autre.
-
j. La plupart des manuscrits ne contiennent pas tous les détails des
dix périodes passées dans les six portes chaque année. Mais la
concordance parfaite de R (long) avec AU (court), non seulement dans
la liste complète, mais aussi dans le nombre de jours, prouve leur
authenticité. Leur corrélation avec un calendrier de travail ou avec
des faits astronomiques est une autre affaire. Un schéma de ce genre
n'est connu nulle part ailleurs ; mais le système des portes est
connu depuis l'En, y compris les sections astronomiques de l'Aram,
des fragments de Qumrân. L'année de 364 jours est un lien certain
avec ces anciens traités. 2En 13 est soit un autre schéma solaire
qui a survécu, soit une relique brouillée.
14 a.
Dans 2En 10:1, tous les manuscrits courts lisent « région septentrionale
» au lieu de « ciel septentrional ». Ici, seul P contient la variante «
régions occidentales » (mais seulement « ouest » dans son titre de
chapitre).
b.
AU lit testera, et
P a le chiffre Z = 6. Mais R lit petora, ce
que J confirme avec ê, apparemment « 5 ». L'explication est que la
lettre e est le chiffre 6 en glagolitique. Il est remarquable
La 1ère porte
il sort pour 42 jours,
les 35
deuxièmes jours,
les 35
troisièmes jours,
les 35
quatrième jours,
les
cinquièmes 35 jours,
les sixième
42 jours.
à la sixième
porte, selon le cycle des saisons :
Et il entre
par la cinquième porte 35 jours, la quatrième porte 35 jours, la troisième porte
35 jours, la deuxième porte 35 jours.
14
ils m'ont
montré six grandes portes ouvertes, correspondant au circuit du ciel oriental,
opposé, par lequel le soleil se couche, correspondant à son lever par l'orient
couronne f et
la porte au Seigneur). ·Car, puisque sa couronne brillante est avec Dieu/ 3 avec
400 anges qui la gardent, le soleil (fait tourner son char) et retourne sous la
terre h sur
des roues, sans la grande lumière qui est son grand rayonnement et son ornement.
|Et il reste| pendant sept grandes heures dans la nuit. Et le char passe la
moitié de son temps sous la terre. Et quand il arrive aux approches de l'est, à
la 8e heure de la nuit, (les anges, les 400 anges, ramènent la couronne et le
couronnent). Et sa splendeur et l'éclat de sa couronne sont vus avant le lever
du soleil. Et le soleil brille plus que le feu.
15 |Les
éléments solaires, les phénix et les khalkédras, éclatent en chants.| a
Et
alors les éléments solaires, appelés phénix et khalkédras,
éclatent en chants. 1 C'est pourquoi tout oiseau bat des ailes, se réjouissant
de la présence du dispensateur de lumière. Et ils éclatent en chants sur l'ordre
du Seigneur :
Le donneur de
lumière arrive, 2
pour donner
de l’éclat au monde entier ;
et la veille
du matin apparaît, qui sont les rayons du soleil.
Et le soleil
paraît sur la face de la terre, et reprend sa splendeur pour éclairer toute la
face de la terre.
Et ils m'ont
montré ce calcul du mouvement du soleil et les portes par lesquelles il entre et
sort ; car ce sont les grandes portes que Dieu a créées pour être une horloge
annuelle.
C'est
pourquoi le soleil a la plus grande chaleur ; et le cycle pour lui dure 28 4
ans, et recommence une fois de plus depuis le début/
16 |Ils
reprirent Énoch et le placèrent une fois de plus à l’est, sur l’orbite de la
lune. Mot « 15. »|
Et un autre
calcul que ces hommes m'ont montré, celui de la lune, et de tous les mouvements
et phases ;
-
f. Traditionnellement, les représentations d'Hélios montrent une
couronne ou un nimbe à sept rayons. Ceci est également vrai pour les
figures associées au soleil, comme le phénix. Rien n'indique que
l'utilisation du chiffre 7 soit autre chose qu'une autre occurrence
de ce nombre mystique ou magique sacré. Il n'est pas non plus
invariant en tant que symbole solaire, du moins en ce qui concerne
les rayons coronaux. On trouve également les nombres 4, 5, 6, 9 et
12.
-
g. P se lit « au ciel avec le Seigneur ». La brièveté et l'obscurité
de AU suggèrent que le texte a été abrégé en supprimant certaines
des caractéristiques les plus fantastiques. R diffère
considérablement de JP dans ce ch. ; mais l'un ou l'autre ou les
deux pourraient bien préserver des lectures avec une prétention à
l'authenticité. Puisque même AU décrit le retrait de la couronne du
soleil au coucher du soleil, son remplacement avant le lever du
soleil est à prévoir. Nous avons présenté toutes les preuves en
confondant les lectures particulières de R avec le texte de J. Cela
ne signifie pas que les problèmes textuels doivent être résolus par
une telle procédure de maximisation. En particulier, notre
interprétation de la fourniture
unique de J est
douteuse. Voir ni
-
h. Le soleil a des points de retournement quotidiens (tropai) si
l'on considère que le mouvement est en va-et-vient. Il existe
également des
tropai saisonniers correspondant
aux solstices.
-
b. La lecture supérieure de R évite le pluriel.
-
c. Les manuscrits varient considérablement quant au mot utilisé ici
et dans 16:1, 8. Notez ce qui suit :
15:3 16:1 16:8
|
UN
Tu |
raiténie |
ou raStee
ou raStinie |
avec . rastinenie
z . rasitnente |
|
B |
razftnenie |
razéinenie |
razéinenie |
|
V |
razftnjenie |
rastynjenie |
raséinjenie |
|
Chr |
razliéenie |
razliéenie |
razluéenija |
|
JPR |
rascitanie |
raséiténie |
raséeténie |
|
Vaillant |
(Secrets, p. |
14) conjectures un original |
|
raftitenie à
15:3, mais préfère les R |
razéîtenie à |
|
16:1. Il y a trois ou quatre termes, diversement |
|
orthographié. Les manuscrits plus longs lisent raséitanie tout
au long, |
|
sauf que P seul dévie vers la
rastetenie au
ch. |
16
— d’où le terme « cours » (APOT, vol.
2, p. 438).
3 et porte-le
au Seigneur.
Mais le
soleil fait tourner son char et voyage sans lumière ;
et ils lui
mirent là la couronne.
15
1
2
3 Et ils me
montrèrent cette augmentation du soleil et les portes par lesquelles il entre et
sort ; car ces portes, le Seigneur les a créées pour être une horloge annuelle.
16
1 Mais
la lune a une augmentation différente. Ils m'ont montré tous ses mouvements et
toutes ses phases. Les hommes m'ont montré les portes, et ils m'ont montré 12
portes
Rascitanie («
calcul » [APOT, vol.
2, p. 438]), qu’il s’agisse d’un processus ou d’un résultat, ne convient
pas, car les données de ce chapitre ne sont pas calculées. De même, V n’a
qu’un seul mot dans tout le texte, razftnjenie, et
d’autres manuscrits (NB) concordent. C’est la source de « disposition »
dans APOT (vol.
2, p. 438), mais « ordre » ou « routine » seraient mieux et conviennent. Le
fait que diataksis ou diatage puisse
se trouver derrière ce mot rend la comparaison avec Actes 7:53 intéressante.
La variante rastinenije est
attestée, et tous les mots de AU pourraient être les mêmes. Mais rastenie
(auksesis), «
augmentation », convient également dans un traité d’astronomie. La
correction de Vaillant à « déduction » ne semble pas nécessaire. La variante
de Chr – « différence » ou « séparation », qui suppose que la razludenija de
16:8 n’est pas simplement une erreur du copiste – n’a guère de prétention à
l’authenticité, mais elle suggère que le texte n’a pas été compris.
d. Le
mouvement annuel du soleil sert en quelque sorte d'horloge cosmique. Depuis
l'époque d'Hésiode, un almanach de paysan tirait sa date du mouvement annuel
du soleil à travers l'écliptique. Cela est dû au fait que le jour sidéral
est légèrement plus court (d'environ quatre minutes) que le jour solaire.
Cela signifie que les étoiles rattrapent et dépassent progressivement le
soleil. Cela permet grosso modo de diviser l'année en intervalles, selon les
étoiles proches du soleil. Le système le plus grossier divise la zone en
douze zodiaques. Les Égyptiens reconnaissaient trente-six constellations ou
décans de dix jours chacun. Une observation précise des levers (héliaques ou
acronyques) et des couchers (cosmiques ou héliaques) des étoiles
individuelles permet d'obtenir des indications plus précises. Dans 2En,
toutes les recensions s'accordent sur l'idée que les portes par lesquelles
le soleil se lève et se couche enregistrent les jours de l'année de la même
manière qu'un cadran solaire enregistre les heures de la journée. J, R et P
continuent en affirmant que c'est la raison pour laquelle le soleil est la
plus grande chose créée. Cette affirmation manque dans AU, à l'exception des
mots depuis
skazaeti, «
le soleil dit », qui sont inintelligibles. Pourtant, on trouve quelque chose
de semblable dans d'autres manuscrits. Même ainsi, la divergence entre les
trois manuscrits de la recension la plus longue à ce stade laisse toute la
question obscure. La « chaleur » de J, vari, est
clairement une corruption de tvar, «
créature » (P). Cette déclaration forte sur le soleil est destinée à
renforcer l'adhésion de ce groupe au calendrier solaire.
e. AU
partage à ce stade les mots errants depuis
skazaeti. D'autres
manuscrits ont les mêmes mots dans l'ordre inversé, comme avec skazuetû
solnce (B).
La corruption est irréparable.
16 a.
Voir ch. 15, nc
(et) 12 grandes portes, couronnées de l'ouest
à l'est, par lesquelles la lune entre et sort, selon les saisons régulières.
Elle
entre par la première porte occidentale, à la place du soleil—
2
par la 1ère porte 0
pendant 31 jours exactement, 0
|
par la 1ère porte 0 |
pendant 31 jours exactement, 0 |
|
la 2ème porte |
pendant 35 jours exactement, |
|
la 3ème porte |
pendant 30 jours exactement, |
|
la 4ème porte |
pendant 30 jours exactement, |
|
(|la 5ème porte |
pendant 31 jours|) (extraordinairement) / |exactement|, |
|
(|la 6ème porte |
pendant 31 jours exactement,|) |
|
la 7ème porte |
pendant 30 jours exactement, |
|
la 8ème porte |
pendant 31 jours extraordinairement, |
|
la 9ème porte |
pendant 31 |35| jours (précisément), |
|
la 10ème porte |
pendant 30 jours exactement, |
|
la 11ème porte |
pendant 31 jours exactement, |
|
la 12ème porte |
pendant 22 |28| jours exactement. |
De
même pour les portes occidentales selon le cycle, et selon le nombre 3 des
portes orientales.
b.
Le tableau est loin d’être clair. Il y a douze portes, chacune
correspondant à un mois de l’année solaire (mais ces mois ne sont ceux
d’aucun calendrier connu). La disposition des portes n’est pas claire,
qu’il s’agisse de « l’est » (A) ou « de l’ouest vers l’est » (JP). Le
mouvement de la lune « entre et sort » par ces portes. Ces portes ne
sont pas les mêmes que celles du soleil – six à l’est, six à l’ouest –
et les mois liés à ces portes sont très différents dans leur division de
l’année. Un autre problème est la description apparente de ces portes
comme une « couronne ». Parménide concevait l’univers comme un système
d’anneaux concentriques de feu (cf. 2En 27:3), appelés stefanai. Ce
mot est-il une intrusion du mot « couronne » de la description du soleil
? Le mot a de bonnes prétentions à l’authenticité puisque AU se lit vënca. Les
manuscrits japonais ont le participe vënëan(n)a, à
partir duquel le
vëënaa de R, «
éternel », s’explique au mieux par une corruption. Pourtant, certains
manuscrits courts ont aussi cette variante, par exemple V,
identiquement vëënaa. Vaillant (Secrets, pp.
15f.) soupçonne que Ps 24 (Slav. 23):7, 9 avec vrata
vëë'naja a
contaminé le texte. Vaillant corrige largement le texte pour arriver à
douze portes « couronnées » à l’est et douze portes similaires à
l’ouest. Mais la préposition ko, «
à », qui persiste dans tous les manuscrits, est maladroite, sauf en
japonais – « de l’ouest à l’est ».
Si
nous devons imaginer un cercle complet (« couronne ») de portes « de
l’ouest à l’est », peut-être avons-nous à l’esprit quelque chose comme «
les maisons du zodiaque ». Mais le langage du verset 3 suggère qu’il y a
deux séries de portes, une à l’est, une à l’ouest, et que la lune se
comporte de la même manière dans chaque série. C’est l’image de l’En 72.
JP identifie clairement la première porte comme « occidentale », « à la
place du soleil », cette dernière expression se trouvant également dans
R. C’est l’un des nombreux détails dans lesquels l’on peut encore
reconnaître l’En derrière 2En (par exemple lEn 73:4). Mais lEn (72:3)
utilise les mêmes portes (six à l’est, six à l’ouest) pour décrire les
mouvements du soleil et de la lune. L’En 75, cependant, décrit un
système de douze portes dans un autre contexte, et cela pourrait être la
source du récit confus de 2En. La présence de fragments d'idées de lEn
dans les manuscrits plus longs, et leur absence dans les manuscrits plus
courts, contredit la théorie selon laquelle les manuscrits plus longs
ont été interpolés. De nombreuses différences ne peuvent s'expliquer que
si les manuscrits plus courts ont été abrégés.
c.
La désignation d'un mois par un numéro plutôt que par un nom correspond
à la pratique de Qumrân. De même, l'En et Jub n'utilisent jamais de noms
de mois. Les noms de mois apparaissent dans 2En 48:2 et dans les
chapitres 68 et 73.
d.
Un autre problème est le nombre de jours à attribuer à chacun des douze
mois. R est le seul manuscrit à avoir douze nombres intacts et leur
somme donne 363. Ces nombres concordent assez bien avec ceux d'autres
manuscrits où ils ont ces nombres, notamment avec A U. En fait, si nous
préférons A à R au point où ils ne sont pas d'accord (31 jours pour le
troisième mois), et si nous fournissons à A le chiffre de R pour le
douzième mois (22 jours, chiffre confirmé par J), le total est de 364,
ce qui est probablement original. Mais la longueur des mois ne
correspond à aucun calendrier connu.
Le
calendrier en 16:2 selon les différents MSS est le suivant :
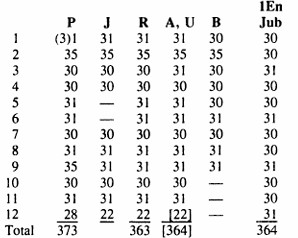
Les
chiffres de Vaillant (Secrets, pp. 15f.) correspondent à U, sauf que le
mois 12 manque, et il l'a rétabli (22 jours) d'après R. APOT (vol. 2, p.
438), suivant Morfill (Secrets of Enoch, p. 18), "corrigé" le
[A]
à l'est, une
couronne par laquelle la lune entre et sort, selon les saisons régulières.
Par la
première porte à l'est 31 jours exactement,
et dans les
35 jours exactement,
et
exceptionnellement au cours du troisième 31 jours,
et au bout de
30 jours exactement,
et au
cinquième 31 jours extraordinairement,
et au sixième
31 jours exactement,
d'ici le 7ème
30ème jour exactement,
au huitième
31 jours extraordinairement,
et au 9ème
31ème jour exactement,
et au dixième
30 jours exactement,
d'ici le
11ème 31 jours exceptionnellement,
à la 12ème
porte elle va 22 jours exactement.
3 De même
pour les portes occidentales, selon le cycle, et selon le nombre des portes
orientales.
Français chiffres dans P. Outre la correction évidente du premier mois
de 1 à 31. ils ont changé les deux mois de 35 jours de P en 31 jours
chacun, assurant ainsi un total de 365 jours. Mais même ainsi, la série
*31 *31 30 30 31 31 30 31 *31 30 31 28 ne correspond pas au calendrier
julien, et 2En n'utilise pas une année de 365 jours dans tous les cas. J
concorde avec R dans une certaine mesure, et tous deux préservent
l'information vitale sur le douzième mois. Lorsque cela est fourni à AU,
le total correct est obtenu. R est le seul manuscrit avec des chiffres
pour douze mois mais son total est faux. R concorde avec U en tout point
sauf au troisième mois, où sa valeur (30 jours) explique pourquoi il
manque un jour. AU sont donc les meilleurs témoins. B n'a que neuf mois
et seulement six d'entre eux concordent avec A U. Mais son accord sur le
fait que le deuxième mois a 35 jours est une preuve importante. En fait,
tous les MSS sont d’accord avec cette information.
e.
La signification des adverbes utilisés pour caractériser le comportement
de la lune au cours de chaque mois est obscure. La découverte du modèle
est rendue plus difficile par le large désaccord entre les manuscrits.
Quatre adverbes différents sont utilisés. Notez les traductions
suivantes : invésîno, «
exactement » ; ispy{
no, «
accu-rately » (« parfaitement » ?) ; izjasienii, «
exceptionnellement » ; izrjadenü, «
extraordinairement ».
Les adverbes sont totalement absents dans B. Seul AU utilise les quatre.
R en a trois ; JP seulement deux, avec une tendance marquée à étiqueter
la plupart des mois « exactement ». Cela explique les deux mois (3 et
11) pour lesquels RJP s'accordent contre A U. Notez ce qui suit :
|
10 |
exactement |
exactement |
|
11 |
exceptionnellement |
exactement |
|
12 |
exactement |
exactement |
|
Mois |
J |
P |
|
1 |
exactement |
exactement |
|
2 |
exactement |
exactement |
|
3 |
exactement |
exactement |
|
4 |
exactement |
exactement |
|
5 |
— |
exactement |
|
6 |
— |
exactement |
|
7 |
exactement |
exactement |
|
8 |
extraordinairement |
extraordinairement |
|
9 |
exactement |
exactement |
|
10 |
exactement |
extraordinairement |
|
11 |
exactement |
exactement |
|
12 |
exactement |
exactement |
|
Mois |
AU |
R |
|
1 |
exactement |
exactement |
|
2 |
exactement |
exactement |
|
3 |
exceptionnellement |
exactement |
|
4 |
exactement |
exactement |
|
5 |
extraordinairement |
extraordinairement |
|
6 |
exactement |
exactement |
|
7 |
exactement |
exactement |
|
8 |
extraordinairement |
extraordinairement |
|
9 |
avec précision |
avec précision |
Autrement, R est d’accord avec AU (contre JP) là où ce nivellement n’a
pas eu lieu (5, 9). Tous s’accordent à qualifier le huitième mois d’«
extraordinaire ». Les preuves textuelles indiquent que AU a les
meilleures lectures. On trouve probablement un indice dans 16:6, qui dit
qu’il y a quatre mois « extraordinaires » chaque année. Cela a quelque
chose à voir avec la croissance et la décroissance de la lune par
rapport aux mois du calendrier, bien qu’il soit possible que la «
diminution » et l’« augmentation » mentionnées ici se réfèrent aux
périodes de l’année où les jours deviennent plus courts et plus longs.
AU a perdu une partie du texte à ce stade par homoioarkton, mais une
restauration peut être faite à partir de B. Dans JPR, les scribes
semblent avoir confondu la question avec le cycle des années bisextiles.
Le
calendrier de 1 En commence l'année à l'équinoxe de printemps, lorsque
le jour et la nuit sont égaux et que les jours s'allongent. Cela
signifie que pendant environ six mois (10, 11, 12, 1, 2, 3) les jours
s'allongent, et cette période comprend les deux mois « exceptionnels ».
Dans les autres mois, les jours raccourcissent, et cette période
comprend les deux mois « extraordinaires ». Lors d'une nuit très courte,
il est possible que la lune ne soit pas visible du tout. Lors d'une nuit
très longue, elle peut être vue, se coucher et se lever à nouveau avant
le soleil.
1
a. En slave, diriati signifie
normalement « garder » dans le sens de « retenir ». Mais MSD, vol.
1, p. 775 donne comme
significations vladétî,
pravitî . Cf. SJS, vol.
1, p. 521.
b. Le mot «
entrepôts » utilisé dans le titre (khraniliJte) n’est
pas le même que celui utilisé dans le texte