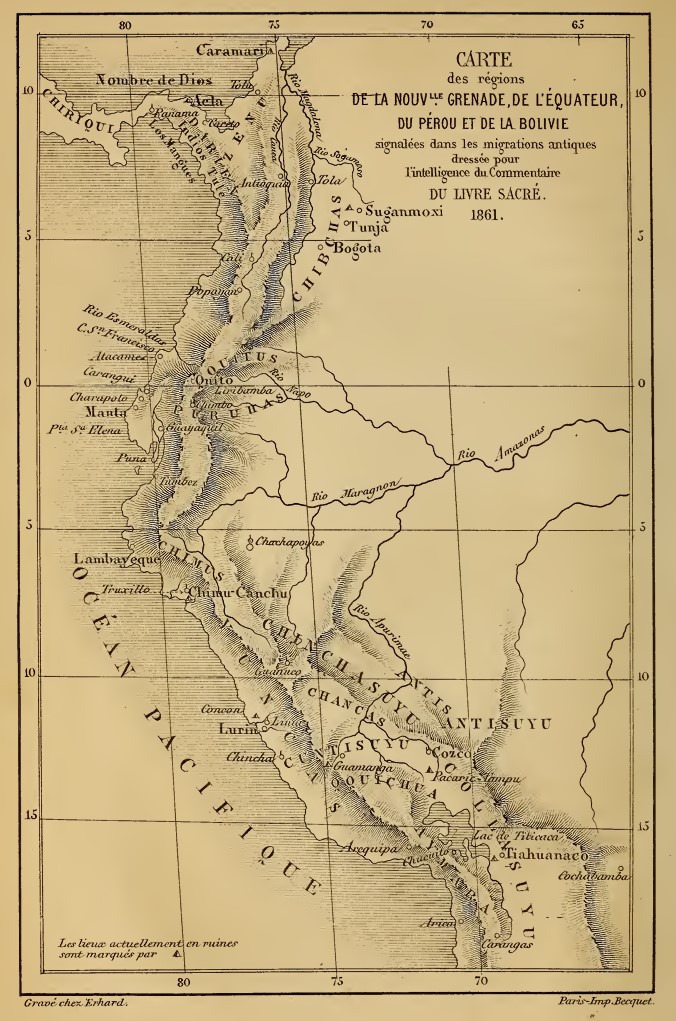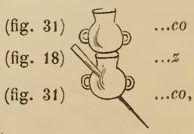§ XII.
Décadence universelle des races américaines au temps de la conquête. Classement de celles de l’Amérique méridionale. Migrations centro-américaines au sud-est, sur l’isthme de Panama et au Darien. Les Caraïbes issus de la race nahuatl. Etat social des nations caraïbes du Darien aux bords de l’Orénoque. Caractère de la race caraïbe. Son influence sur les populations de
l'Amérique méridionale. Anthropophagie religieuse. Déchéance des nations anthropophages.
Les races qui portèrent la civilisation dans l’Amérique centrale, ou dont les institutions se modifièrent dans cette contrée au contact de ses habitants, avaient, dans leur caractère, dans leur organisation et dans leurs coutumes, des éléments de force et de durée dont les traces se distinguent encore jusque chez les nations les plus éloignées de leur berceau, sans que le cours des siècles, ni le mélange des Européens aient réussi à les effacer entièrement : on les retrouve chez les peuples les plus divers de mœurs et de langage, chez les hordes incultes comme chez les nations policées, jusqu’à l’extrémité même de l’Amérique méridionale; Rien en apparence n’est plus capricieux que le développement inégal de cette antique civilisation et dont le hasard seul paraît avoir produit le contraste : mais en y regardant de près, on découvre bientôt dans ce chaos où se mêlent les vestiges de tant d’institutions différentes, qu’ils représentent des nations sinon d’une origine tout à fait diverse, dont l’arrivée date au moins d’une époque distincte, et lorsque déjà le temps avait sensiblement modifié leurs symboles et leurs usages : c’est donc à un mélange de races ou de tribus, envahissant successivement les ־ mêmes contrées, qu’on doit attribuer les transformations des cultes et des sociétés, ainsi que les différences qu’on observe entre les populations lointaines et le berceau d’où émanèrent les idées primitives. Remarquons, en passant, toutefois, que partout ailleurs que sur les points où cette fusion s’opéra, les peuples conquérants nous apparaissent dans un étal plus ou moins voisin de la barbarie, quoique chacun conservât encore quelque débris d’une organisation antérieure, mais mutilée.
Ces données premières se trouvent en partie confirmées par les traditions et les
usages des populations de l’Amérique méridionale. Ce que nous ne pouvons nous arrêter à établir ici, quoique la preuve en soit partout écrite, c’est la perte que toutes firent d’une partie de leurs vieilles institutions, dont les restes n’apparaissent plus qu’à leur déclin : elles avaient eu des croyances religieuses uniformes ; et, quoique les traces en soient partout visibles, on ne les saisit nulle part, si ce n’est défigurées et mourantes. Toutes les fois, cependant, qu’il est possible d’interroger leurs annales, et qu’on parvient à s’éloigner de l’âge où ces contrées furent conquises par les armes espagnoles, les sociétés, aujourd’hui même les plus barbares, se montrent plus fortes, leur existence plus stable et leurs idées morales moins confuses. Dans celles qui avaient possédé une organisation politique où le sacerdoce, et l’aristocratie avaient eu un rôle fixe, on ne voit plus d’ordinaire que des devins et des chefs électifs, les premiers sans culte intelligent, les seconds sans pouvoir durable. Ce phénomène d’une décadence universelle éclate à des degrés divers sur tous les points de l’Amérique civilisée aussi bien que barbare. Sans chercher ici à en découvrir toutes les causes, nous tenons à en constater le fait si important dans l’histoire des peuples, et à indiquer celles qui nous ont le plus frappé ; nous voulons parler des jalousies individuelles de clans et de foyers, où l’indépendance de la tribu prévalant sur la grandeur de l’unité nationale, rompit le nœud qui unissait les monarchies, en les fractionnant en une multitude de petits Etats incohérents. C’est cet esprit mesquin, encore aujourd’hui si commun entre les aborigènes de l’Amérique, qui contribua certainement à précipiter le déclin de la
civilisation et qui livra ensuite avec tant de facilité la plupart de ces nations entre les mains des Espagnols.
Lorsqu’on embrasse dans leur ensemble les races diverses qui peuplent la partie méridionale du continent américain, on les groupe ordinairement en trois familles principales, la
Guarani-Brésilienne, à laquelle se rattachent les
Caraïbes, du côté de l’est ; la
Pampéenne, ainsi nommée des
pampas ou plaines centrales qu’elle possède, et la
Péruvienne dont les rameaux s’étendent sur la croupe des Andes et le long de
l'Océan Pacifique (1). Si l’on jette avec cela ses regards sur la carte où leur situation est tracée, on voit qu’elles s’étendent toutes les trois, sans interruption, du nord au sud, comme des masses qu’un même mouvement aurait poussées dans une direction uniforme. Ainsi l’emplacement qu’elles occupent atteste encore le
sens dans lequel s’accomplit leur marche (2) : car, sorties de l’Amérique centrale, ainsi que l’attestent presque universellement les traditions, tontes auraient cheminé vers le midi, en passant par l’isthme de Panama. Quoique confuses chez un grand nombre de nations ou de tribus, ces traditions s’éclaircissent et deviennent plus distinctes, lorsqu’on les compare à Celles que nous avons relatées dans les chapitres précédents, et toutes uniformément paraissent se relier aux théories fondamentales du
Livre Sacré, dont elles sont encore un commentaire. Pour le moment, laissons les différents Etals guatémaliens, groupés autour de ce berceau primitif, et voyons de. quelle manière, en partant de là, nous pouvons suivre et y rattacher l’échelle des migrations méridionales. C’est Torquemada qui nous offre leur premier point de départ (3).
(1) Alcide d’Orbigny,
L’homme Américain, passim.
(2) Moke,
Hist, des peuples
américains, pag. 70.
(3)
Monarq .Ind.,
lib.iii, cap.40.
Dans un chapitre antérieur, nous avons parlé de l’origine des Chiapanèques qui
formaient, au nord-ouest des montagnes de Soconusco, un groupe si différent de mœurs et de langage des populations environnantes : établis par la force des armes sur les bords du fleuve de Chiapas, à peu de distance de Ciudad-Real, ils donnaient, au nord, fa main aux
Zoqui, à l’ouest aux
Mijes
ou
Mixi, aux
Mixtèques et aux
Wabi de Tehuantepec avec lesquels ils paraissent avoir eu quelque affinité (4׳). Qu’ils fussent de la souche des Vitznahuas (Chanes ou Quinamés), comme semble l’indiquer le culte antique de l’Ara, personnifié dans Vukub-Cakix, ou issus des premiers Nahuas, symbolisés dans Hun-Batz (1), il n’est pas moins certain que la tradition les distingue de toutes les autres tribus et qu’ils n’avouent eux-mêmes de parenté qu’avec les Dirias et les Chorotecas du Nicaragua. Ceux-ci racontaient que leurs ancêtres, bien des siècles avant l’arrivée des Espagnols, avaient occupé les régions aujourd’hui à peu près désertes qui s’étendent entre le territoire de Tehuantepec et celui de Soconusco, sur les bords de
l'Océan Pacifique, aux mêmes lieux où les Nahuas, chassés de Tulan à la suite de la révolution, descendirent pour chercher un asile. Les Chorotecas donnent à ces derniers le nom
d'Olmecas ; ils ajoutaient qu’ils avaient été tout à coup envahis par eux et réduits au plus cruel esclavage. Pour finir cette odieuse tyrannie, dont on comprend, du reste, la rigueur, ils s’entendirent avec leurs prêtres et leurs chefs qui, se mettant à leur tête, les guidèrent par les rivages de la mer jusqu’au golfe de Nicoya ; de là, ils retournèrent ensuite, en passant les monts, jusqu’au lac de Nicaragua et se fixèrent sur ses bords.
(4) Cette affinité paraîtrait même s’étendre, suivant Burgoa, a la plupart (des populations de
l'Etat d’Oaxaca, dont les langues, dit-il, sont sœurs, et jusqu’aux tribus du nord-ouest, comme chez les Tarasques du Michoacan.
(1) Le nom de la forteresse qui dominait la cité de Chiapas s’appelait, dans la langue chiapanèque,
Chapa-Nanduimé, Ara-Couleur-de-Feu, et la ville elle-même
Nambi-hina-Yaca ,
Cité Grande du Singe.
Par la même tradition, nous apprenons que les Olmecas, leurs ennemis, refoulés à leur tour par une puissance supérieure, prirent bientôt après la même route, cherchant comme eux une patrie nouvelle. Les détails que nous donne à ce sujet l’historien, sont suffisants pour faire connaître parfaitement dans ces Olmecas les tribus de la race nahuatl, proscrites de Tulan et dont nous reparlerons un peu plus loin, à propos de leurs
établissements au Guatémala. Ce qu’il importe, toutefois, de signaler ici, ce sont les stations diverses qu’une partie de ces tribus fondent en passant par l’Amérique centrale : ce sont eux encore qui, après avoir suivi une partie du littoral du Pacifique, donnent naissance à la plupart des colonies de la langue mexicaine qu’on retrouve aujourd’hui même sur la côte jusqu’au delà d’Ezcuintla
et de Sonzonate (1); on peut observer leur marche à l’intérieur du pays où . ils fondent !avilie sacerdotale de Mictlan, près du lac Guixa, à la frontière de San-Salvador, et le royaume de
Cuzcatlan, le plus florissant et le plus riche des Etats dé la langue nahuatl, dans ces contrées (2). Puis, continuant aux flancs de la Cordillère de Lépatérique et de Segovia, elles gagnent
l'Océan Atlantique à l’est de l’Etat de Nicaragua vers l’embouchure du fleuve San-Juan ; là elles fondèrent une ville qui avait conservé de
l'importance au temps de la conquête,' et où l’on parlait un dialecte nahuatl alors fort corrompu.
(1)
Itzcuintlan, aujourd’hui
Ezcuintla, la Ville des Chiens, connue des Cakchiquels sous le nom de
Panatacat, cité riche el populeuse de plus de 40,000 âmes au temps de la conquête, renaît aujourd’hui, grâce au commerce du calé, et compte environ 10,000 âmes; elle est à 12 lieues sud de Guatémala, et ses eaux sont les plus belles du pays. —
Sonzonate,
autrefois
Centzon-atl,
les 400 eaux ou sources, jolie ville de 12 à 15,000 âmes, à 4 lieues de la nier et du port d’Acajutla, dans l’Etat de San-Salvador.
(2)
Mictlan, aujourd’hui
Mita, village encore important de l’Etat de Guatémala. On voit près de là des ruines qui attestent son antique importance; il ne faut pas confondre cette ville avec une autre du même nom dans l’Etat d’Oaxaca, au Mexique.—
Guzcatlan, Terre des richesses, ancienne capitale du royaume du même nom, remplacé depuis par la ville de San-Salvador.
On les suit encore jusqu’à l’isthme de Panama, s’arrêtant dans les territoires voisins du
Darien, entre
Nombre-de-Dios et
Porto-Belo (3) : récemment on a découvert les traces de leur séjour dans cette contrée, et lés îles du golfe de
Chiriqui nous ont révélé des monuments, couverts de sculptures et d’inscriptions, qui rivalisent avec les palais du Yucatan (4). Dès lors Torquemada cesse de suivre les Nahuas qui passèrent plus avant : mais il ramène un des groupes de cette race à travers l’isthme jusqu’au bord de
l'Océan Pacifique, puis par les Etats de
Veragua et de
Costa-Rica, où l’on trouve encore tant de traces de leur langue et de leur passage, jusqu’au bord du lac de Nicaragua. Là ils se rencontrent
de nouveau avec le peuple qu’ils avaient obligé naguère à fuir son pays : mais les Chorotecas, oubliant leurs anciennes injures, les accueillent comme autrefois leurs ancêtres avaient reçu les premiers Nahuas. Ceux-ci, cependant, avaient gardé rancune de leur dernière proscription : payant l’hospitalité par la perfidie la plus noire, ils attaquent leurs hôtes au milieu de la nuit et les poursuivent ensuite avec cruauté jusqu’aux limites de leur territoire. Les Chorotecas (Vitznahuas) épouvantés prennent la fuite devant leurs ennemis : les uns, se dirigeant au nord-ouest, vont fonder
Nagarando, au bord du lac de Managua (1), tandis que les autres contournaient les rivages du golfe de Nicoya, que l’on trouve encore aujourd’hui habités par leurs descendants (2). C’est de cette manière que la race nahuatl resta en possession des bords méridionaux du lac de Nicaragua, où la trouva la conquête espagnole (3).
(3) Torquemada, Monarq.
Ind.,
lib. iii,cap. 40.
(4) « At the
Isla del Muerto, Whiting and Shuman also found monuments and columns, covered with hieroglyphics, similar to those discovered in Yucatan by Mr Stephens
>י
(Cullen’s
'Isthmus of Darien Ship canal,
etc. Note, pag.38)
-
(1) De
Nagarando ou
Nagrando,
eu nahuatl,
Xolotlan, vient le nom des
Nagarandas; cette ville était à peu de distance de la première cité espagnole de Léon, au bord occidental du lac de Managua, à trois lieues de la capitale actuelle. ·
-
(2) Sous le nom commun de
choroteca, Squier réunit les trois dialectes, nagranda, diria et choroteca ; ces deux derniers, qui n’ont presque aucune différence, sont fort éloignés du premier; ils se parlent entre Managua et le golfe de Nicoya, et ont beaucoup d’analogie avec le chiapanèque propre. Les Chorotecas passaient pour la plus ancienne race du pays.
-
(3) On donnait aux descendants de la race nahuatl de Nicaragua le nom־ de
Niquira, qu’on trouve énoncé dans Oviedo. Dans un des interrogatoires rapportés par cet auteur, on lit cette réponse d’un chef niquira de Nicaragua: a Quand les enfants viennent au » monde, ils ont la tête tendre, et on » la leur pétrit pour la rendre telle » que nous l’avons, avec deux bosses » de chaque côté et un creux au milieu, car nos dieux ont dit à nos » ancêtres qu’ainsi nous aurions l’air » beau et noble ; cela rend aussi
la » tête plus dure pour porter des fardeaux » (Oviedo,
Relation de Nicaragua, coll.Ternaux, pag.71).
Ce qu’on ne saurait trop remarquer dans les émigrations subséquentes qui eurent lieu dans cette direction, c’est que les deux races ennemies (4) descendirent simultanément vers le sud-est par l’isthme de Panama. Ce furent, d’un côté, les Chorotecas (Vitznahuas) qui fuyaient devant les hôtes perfides qui les avaient obligés d’abandonner de nouveau leurs foyers : la tradition nous les montre d’abord sur les côtes et dans les îles du golfe de Nicoya : mais on continue à suivre les traces de leur langue et de leurs coutumes dans les provinces de
Costa-Rica et de Veragua, et au delà du Darien, jusque dans les régions de la Nouvelle-Grenade qui longent le littoral de la mer Pacifique. Du côté opposé, le même fait se répète exactement pour les Nahuas, que Torquemada nous montre s’arrêtant sur l’Atlantique, aux environs de Porto-Belo, et l’on continue à reconnaître leurs traces sur la plus grande partie des territoires du Darien, quoique mêlées parfois à celles de leurs adversaires (1). Les siècles n’ont pas encore achevé de les effacer: c’est ainsi qu’aujourd’hui on distingue les indigènes du Darien sous deux noms, les
Mandingas et les
Tulé, dont la différence rappelle peut-être encore leur origine distincte.
-
(4) a Ceux qui parlent la langue » chorotega et qui sont leurs ennemis » (des Niquiras), ont aussi la même » religion; mais leur langue, leurs » mœurs, leurs coutumes et leurs cérémonies sont si différentes, qu’ils
מ
ne s’entendent même pas » (Oviedo,
ibid., pag.8).
(1)
Citons pour exemple quelques noms encore existant aujourd’hui, soit de localités, soit de rivières, et dont nous chercherons à rétablir l’orlhogra-phe : Cuiti
(cuitic ou
cuiltic), Putri-gandi, Navagandi (de
nahua, etc.), Sasardi, Carreto, Gandi, Tutumate (de
totoma), Aclatomate, nom de la rivière à l’embouchure de laquelle était située la célèbre ville d’Acla
(Atlatomate et
Atlan, auprès des eaux, sur l’Atlantique), Urraba
(Ullahuan),
Atrato (Atlaton), Chucunaqna
(Choconacuan), Artuganti
(Atlacantin),
Tapanaca
(Tlapanecan), Uztacapanti
(Oztocapan), etc. Presque tous ces noms sont d’origine nahuatl, et ont un sens parfaitement approprié aux localités où on les trouve ; il faut remarquer encore l’analogie éloignée qu’il y a entre les mots terminant en
andi, anti, ando, qui paraissent encore être une corruption du nahuatl. Ex.:
Navagandi, lisez
Nahuacantli. Ces noms appartiennent aux Indiens du Darien, qu’on appelle encore aujourd’hui
Tule
(Voir Cullen’s
Isthmus of Darien, appendix, pag. 99). Cet appendice, qui renferme un vocabulaire de mots de leur langue, semble appartenir à la race choroteca. Ajoutons encore ici les noms, conservés au temps des Espagnols, de plusieurs princes de cette contrée :
Dobayba, Abi-Beiba, Aben-Amechey, Abrayba, etc., qui nous paraissent avoir une tournure tout à fait moresque ou biblique (Herrera,
Hist, gen., decad. 1, lib. 1x, cap.6).
Dans les tumuli qui furent ouverts, il y a deux ou trois ans, auprès de la ville de David, dans la province de
Chiriqui (2), on ’ trouva un grand nombre d’objets travaillés en or d’une grande perfection, et les forêts de Veragua continuent à révéler les restes imposants d’une civilisation antique ; tombeaux, palais, colonnes colossales, couvertes, de sculptures fantastiques, mais qui n’ont rien de commun avec les nobles débris de Palenqué et de l’Yucatan (1). Les
Dorackos, considérés comme les plus policés des habitants de cette contrée, au temps de la conquête, ne paraissaient pas en avoir été les auteurs. D’autres peuples avaient-ils donc passé par là, ou bien faut-il attribuer ces monuments aux
Chorotecas proscrits à Nicaragua ou à leurs ancêtres plus anciens, les Vitznahuas, adorateurs de l’Ara
Vukub-Cakix, ou bien à ceux du singe Hun-Batz, symbole des premiers Nahuas? Ce qui est certain c’est que lorsque les Espagnols arrivèrent dans ces contrées, cette civilisation était déchue, sinon éteinte : les populations du Darien, quoique policées jusqu’à un certain point, participaient à la fois des institutions alors existantes à Cuba, à Haïti et parmi les Nahuas, et des écrivains ont cru y retrouver même des analogies avec celles des Japonais. On n’y voyait guère d’édifices en pierre; les maisons des chefs, quoique grandes et commodes et d’une structure fort remarquable, étaient généralement en bois et assises sur pilotis, précaution jugée nécessaire pour les mettre à l’abri des inondations sur les côtes marécageuses de Darien. Le palais du prince Comagre avait cent cinquante pas de long sur quatre-vingts de largeur, et les pilotis qui en formaient la substruction étaient environnés d’un mur de pierre solidement bâti : l’intérieur en était distribué avec beaucoup de goût, et les parois comme les planchers étaient tendus de nattes admirablement tissées. Dans une des salles de sa maison, le chef gardait avec piété les corps de ses ancêtres, desséchés au feu ou embaumés et enveloppés d’étoffes de prix. Cette installation était celle de la plupart des villes du littoral du Honduras et de Nicaragua jusqu’aux embouchures de l’Orénoque sur l’Atlantique. Il en était de même de la plupart des nations qui occupaient le vaste territoire renfermé entre la mer et ce fleuve : d’origine caraïbe ou alliées à cette race puissante, elles se partageaient en une foule de tribus, classées d’ordinaire au dernier degré de l’échelle sociale, mais à qui les relations, tout à fait contemporaines de la découverte, accordent des institutions bien plus policées qu’on ne saurait se
l'imaginer aujourd’hui.
(2) La province de
Chiriqui,
située entre les deux océans, est disputée par les Etats de Costa-Rica
el de Veragua (Nouvelle-Grenade), entre lesquels : elle se trouve, et la ville de David est ' du côté du Pacifique.
-
(1) Sreinan’s
Voyages, etc.
Trans. Amer, rfhnol., 1853, pag. 175.
En effet, les relations subséquentes les représentent comme des sauvages, dont le nom seul suffisait pour jeter l’épouvante dans les Antilles : leur énergie, leur impétuosité guerrière et surtout l’usage abominable où plusieurs de leurs tribus étaient de manger de la chair humaine, leur avait valu cette renommée. Mais , ainsi qu’on l’a déjà vu chez les Nahuas, cette coutume, liée à des rites mystérieux, était loin d’exclure les arts et les notions sociales, et quoique à cette époque la civilisation parût à son déclin parmi ces peuples, que l’invasion européenne achevait de précipiter dans la barbarie, il existait encore un état de culture assez avancé. Outre les maisons dont nous venons de parler et dont aujourd’hui les descendants des conquérants seraient incapables de reproduire les modèles, il s’y fabriquait des étoffes de la plus grande finesse et des ouvrages en plume aussi beaux qu’au Mexique (1). Si les hommes en quelques endroits allaient presque nus (2), les femmes s’y distinguaient par la recherche de leurs vêtements, par la beauté artistique de leurs bijoux d’or et d’argent, et surtout la taille admirable des émeraudes et des autres pierres fines dont toutes aimaient à se parer également. Herrera (3), sans entrer dans beaucoup de détails sur leur gouvernement et leurs institutions, en dit cependant suffisamment sur
Acla,
Comagre, Cureta et les autres Etats de la côte jusqu’à
Cumana
י pour donner à entendre qu’ils étaient au niveau des na-lions de Nicaragua et du Cundinamarca. Il loue la perfection de leurs peintures, sans dire toutefois s’il s’agit de caractères à l’aide desquels ils auraient conservé leurs annales : mais on sait que chez les
Caramari de Carthagène, qui s׳é vantaient également d’appartenir à la puissante nation des Caraïbes, on trouvait, comme parmi les indigènes
d'Urraba, les traces d’une culture considérable, importée anciennement, ainsi que des notions de livres et de l’art graphique (1).
(1) Herrera,
Hist. gen., decad. 1, lib.ix, cap.2, 6, etc.,
passim.
-
(2) Les relations sont fort contradictoires à ce sujet: parfois on représente les hommes comme très-bien vêtus; ailleurs, comme allant à peu près nus; il est probable que les classes inférieures se couvraient beaucoup moins, surtout dans un climat si chaud. Au Japon, les femmes du peuple s’habillent également fort peu, et les boni-mes se présentent absolument nus, si ce n’est que parfois ils ont une ceinture assez légère autour des reins.
-
(3) Ibid., ut sup.
Voir à la table générale les noms cités ici.
-
(1) Petr. Mart.,
Ocean., pag. 22 et 65. —Humboldt,
Essai sur l’histoire de la géographie du Nouveau-Continent, tom. 11, pag. 83.
Les chefs du Darien et des côtes d’Urraba prenaient les titres de
Quevi et de
Sako, qui correspondaient à ceux de prince ou de roi : ce dernier, qui se retrouve au Cundinamarca, est également mentionné comme un titre princier et sacerdotal dans la Mixtèque (2). Si chez quelques-unes de ces nations on trouvait la coutume de dévorer la chair humaine, en d’autres endroits les mœurs montraient une dissolution analogue à celles des populations de Natchez, de Panuco et de Teo-Colhuacan.
Partout on voit établi le culte du soleil, ainsi que des traces d’institutions
phalliques. Entre les rares notions religieuses qui nous ont été transmises sur ces peuples, Herrera parle du culte de
Dobayba, nommée aussi la
Mère des dieux, créatrice du soleil et de la lune, et dont Balboa chercha inutilement à découvrir le temple, afin d’en piller les trésors. Ces notions, malgré leur brièveté, nous ramènent aux dieux des Nahuas, Oxomoco et
Cipactonal, la grand’-mère et le grand-père du soleil et de la lune : mais ce qui achève d’identifier cette race avec les Caraïbes, c’est, ajoute Blas-Valera (3), que « toute cette génération d'hommes si terribles et si cruels » était sortie des régions du Mexique pour peupler ensuite celles de » Panama et de Darien, ainsi que toutes ces immenses contrées qui » vont d’un côté jusqu’au nouveau royaume de Grenade et de » l’autre jusqu’au delà de Sainte-Marthe. » Ce sont les mêmes, en effet, qu’on retrouve, plus bas, sous des dénominations diverses, quoique la tradition leur ait conservé généralement celles de
Cara, Cari, Coro, Cali, etc., dont la première syllabe est demeurée attachée à une foule de localités où ils établirent leur séjour, soit en passant, soit d’une manière permanente (1). Les foires et marchés qui se tenaient dans ces contrées, à l’instar de ceux du Mexique et de l’Amérique centrale, constatent l’existence d’un commerce actif et continu : mais on en ignore les particularités et l’on ne sait pas davantage jusqu’où il s’étendait. Cependant des communications paraissent avoir été établies anciennement avec les peuples du Pérou : on ne saurait donc s’étonner, en lisant les relations du temps, que les premières nouvelles qu’en apprit, Balboa, ainsi que de lamer Pacifique, lui eussent été données par un jeune chef de Comagre qui, en lui désignant le Sud, lui disait que dans cette direction il trouverait des princes qui n’usaient que de vaisselle d’or et qu’on y naviguait dans des barques à voiles et à rames peu inférieures à celles des Espagnols (2) : Un peu plus tard, c’était le chef de Tumaco qui traçait à Balboa, à son arrivée dans la baie de Panama, la
figure des côtes de Quito, lui décrivant en même temps la richesse de l’or du Pérou et la forme extraordinaire des Hamas que l’on charge de minerais dans les Cordillères et que les Castillans prirent pour des chameaux. Cependant il y avait plusieurs centaines de lieues depuis l’isthme jusqu’aux régions dont le Cacique avait une connaissance si précise. Combien y en a-t-il parmi nous ou parmi les Hispano-Américains, même dans les classes
instruites, qui seraient aujourd’hui en état d’en faire autant ?
(2) Hist, des nations civilisées du Mexique et de l’Amér. cent., tom. ni, chap.l, pag.1T.
-
(3) Garcilaso de la Vega,
Comentarios Reales, etc., Iib.1, cap. 11.
(1) De
Cariari, première localité que Colomb découvrit après le cap Gracias â Bios, sur la côte
orientale de Nicaragua, on retrouve ces noms jusqu’à l’extrémité du Pérou.
(2) Petr. Mart.,
Ocean., pag. 22 et 65. — Herrera.
Hist, gen., decad. 1, lib.x, cap.3. .
En observant ainsi sur le grand isthme qui unit les deux Amériques les débris de ces races, qu’on peut regarder comme les plus anciennes entre celles qui fondèrent les institutions sociales sur ce continent, on voit déjà comment leurs migrations ont dû s’opérer du nord au sud, et par quel concours de circonstances des nations ennemies, différant de coutumes et de religion, se sont trouvées simultanément sur la même route et auront pu quelquefois se fondre l’une avec l’autre : ce fait intéressant dans l’histoire des migrations humaines nous conduit par analogie à en supposer beaucoup d’autres; il servira peut-être à expliquer bien des anomalies apparentes, en indiquant de quelle manière des populations, soit sauvages, soit civilisées, ont
dû naturellement se rencontrer sur cette ·route étroite, afin de passer pour ainsi dire d’un pôle à l’autre.
Si nous n’avions d’autre objet que de soumettre à un rapide examen les diverses nations que l’on s’accorde généralement à considérer comme ayant possédé, antérieurement à la conquête, des institutions sociales supérieures, nous passerions sans nous arrêter de l’Amérique au plateau de Bogota, et de là par les Andes au Pérou. Mais ce que nous cherchons à découvrir, ce sont les traces des peuples que nous ·venons de suivre jusqu’aux confins de l’isthme de Darien : car dans les régions intermédiaires, en grande partie aujourd’hui recouvertes de forêts, c’est à peine si, à l’exception des villes et dès États modernes, on trouve un souvenir du passé. Ce que nous avons déjà vu
suffît, cependant, pour démontrer que ces solitudes où l’on discerne encore de
loin en loin quelque tribu indigène, se reliaient par des anneaux d’une chaîne
rarement interrompue d’existences maintenant éteintes, aux civilisations
méridionales. En les interrogeant, nous verrons jaillir encore quelque lumière
sur les problèmes qui se rattachent à l'histoire des grands peuples environnants. En effet, qu’on suive, en longeant le littoral, les navigateurs et les conquérants du xv1esiècle, de Darien à Cumana, on trouve ces contrées occupées, comme nous venons de le voir, par des populations qui paraissent appartenir presque invariablement à la même race que celles des
Caramari
de Carthagène et de Sainte-Marthe, race guerrière et souvent farouche, à laquelle toutes les autres se vantaient d’être unies, sinon par des liens du
sang bien étroits, au moins par des alliances nombreuses. Vivant à des degrés divers de civilisation ou de barbarie, c’est la même race qu’on voit se répandre sur les deux rives de l'Orénoque, envahissant tour à tour les différente régions de l’Amérique méridionale jusqu’aux confins même du Chili.
Peu d’années avant l’arrivée des Espagnols, un essaim de Caraïbes avait débarqué aux Antilles, où leur force et la coutume de dévorer leurs ennemis avaient répandu la terreur. Fiers de leur puissante stature, ces guerriers formidables se sentaient doués des qualités personnelles que semblent avoir presque toujours possédées les races conquérantes. Aussi* se plaçaient-ils au-dessus des peuples qui les environnaient, et ils répétaient avec orgueil qu’eux seuls étaient des hommes, tandis que les autres n’étaient que des esclaves. La même pensée leur faisait redouter pour leurs fils la petitesse des yeux, qu’ils regardaient comme une disgrâce, sans doute parce qu’elle était une
marque distinctive des tribus brésiliennes qui les avoisinaient. Pour la prévenir, ils avaient, ainsi que les Nahuas de ־Nicaragua, adopté la coutume de repousser en arrière le front du nouveau-né, ce qui lui déformait le crâne, mais en faisant ressortir les yeux comme ils le désiraient (1). Leur nom même, si l’on ajoute foi à l’étymologie qu’on en donne (2), attestait l’orgueil d’une race puissante et belliqueuse, car il aurait signifié l’homme par excellence, et, ainsi que
nahual dans le Nord, celui de
cara dans le Sud n’était dans l’origine qu’une sorte de titre d’honneur qu’on décernait aux chefs qui s’étaient distingués par quelque action d’éclat.
(1) Dans l’épopée de Hunahpu et de Xbalanqué, il y a un passage curieux, où les saltimbanques mystérieux, qui se montrent en Xibalba pour exécuter leurs prestidigitations merveilleuses, refusent de se présenter devant les rois, dans la crainte que leurs grands yeux ne paraissent quelque chose de difforme (Voir 1θ
Livre Sacré, pag. 119).
(2) Suivant Rochefort
(Histoire des Antilles , pag. 455),
Caribe signifie guerrier; c’est le même sens qu’on donne au mot
Guarani, qui veut dire guerre, suivant le P. Antonio Ruiz;
Guarini-hara , guerrero , guerrier
(Tesoro de la lengua guarani , pag. 130). Alors
Guarani, Carini, Caribe
auraient la même origine que le mot
war, guerre, ainsi que la plupart des mots germaniques qui s’y rattachent (A. d'Orbigny,
L'homme Américain,
torn, ii, pag.’268). D’autres donnent à ce mot la même origine qu’au mot
Cara des Turcomans,
beau, fort, puissant, excellent, etc.
Les Caraïbes se souvenaient d’être sortis du nord, et l’on a recueilli des traditions qui leur donneraient pour berceau les plaines des Florides, aussi loin même que les Alléghanies (1). On a déjà vu par quel concours de circonstances la race nahuatl avait pénétré dans l’Amérique méridionale, et les premières colonies qu’elle y avait, établies : avant elle, et depuis, d’autres essaims, identifiés avec les Caraïbes par un contact prochain, auraient pu suivre la même route, les uns, en descendant les côtes du Pacifique, à la suite des Chorotecas, les autres en remontant les rives du Magdalena ou en traversant même un bras de mer, d’un point de la terre ferme à l’autre, afin de se fixer dans quelque autre partie du continent, comme aux embouchures de l’Orénoque, où plusieurs de leurs tribus se maintinrent fort longtemps. Autour d’eux s’étaient répandus, dans cette direction, une foule de peuples de mœurs · analogues et parfois de même langage (2) ; ceux-ci avaient sans doute partagé naguère leur fortune ; mais les Caraïbes les regardaient si peu comme leurs égaux, qu’aujourd’hui même ils ne peuvent encore se résoudre à vivre auprès d’eux dans les missions espagnoles. Aussi s’efforçaient-ils constamment de les soumettre ou de les détruire, et de là naissaient des guerres mortelles où se consumaient les forces des nations voisines. On les représentait surtout comme de terribles chasseurs d’hommes, qui entreprenaient les expéditions les plus hardies pour aller au loin surprendre des clans étrangers et y faire des prisonniers. C’est ainsi que les Nahuas, dans les temps les plus anciens, allaient au loin chasser aux captifs, et que les Mexicains, à une époque rapprochée de la conquête, s’engageaient à dessein dans des combats avec les Tlaxcaltèques et les autres États voisins, afin d’avoir des victimes à ramener aux autels des dieux.
(1) Petr. Mart.,
Ve Mare Ocean., j (2) D’Orbigriy,L'homme Américain,
pag.6.— Rwhefori,
Hisi.des Antilles, loin. 11,
passim.
pag.351. I
Quelque inférieure que nous paraisse aujourd’hui la condition des Caraïbes, les relations des premiers conquérants, d’accord avec les observations d’un voyageur moderne (1), nous font voir, chez cette nation ambitieuse et intelligente, des traces d’institutions vastes et savantes, destinées à consolider le pouvoir aristocratique et l’influence sacerdotale. Mais comme elles étaient partout en décadence, même chez les tribus ]es plus policées, à l’époque de la découverte de l’Amérique, c’est à peine si l’on en aperçoit actuellement quelques débris presque effacés. On y retrouve cependant l’hérédité consacrée dans les familles régnantes, le respect des princes et de la religion, l’obéissance aux lois, une extrême ténacité aux anciennes coutumes, les épreuves de l’initiation guerrière, sanctifiées par des pénitences cruelles et des austérités extravagantes qui rappellent les rites des Mexicains ; on y retrouve, comme parmi les Iroquois, l’usage de préparer, par des supplices atroces, le sacrifice du prisonnier qu’on dévorait ensuite religieusement. Le récit qu’on lit de ces horreurs dans les histoires du temps, les représente généralement comme une simple coutume populaire ; mais des descriptions plus anciennes et plus spécifiées ajoutent aux détails ordinaires d’autres rites qui nous montrent le bourreau se préparant au meurtre par des veilles austères, comme le sacrificateur mexicain.
(1) Humboldt,
Relation historique,
pag.471, etc.
Parmi les tribus du Brésil qui avaient appris des Caraïbes à dévorer leurs prisonniers, c’était le prêtre qui les excitait, au nom des dieux a qui demandaient de la chair humaine. » Ainsi les scènes monstrueuses où la peuplade entière s’associait au meurtre de l’ennemi, dont elle mangeait les restes, étaient dans le principe de véritables, sacrifices humains, analogues à ceux qui existaient dans l’Anahuac. Ils faisaient partie de cet ensemble de croyances et d’institutions, systématiquement conçu dans l’origine, comme une satisfaction mystérieuse par le sang, et dont le sacerdoce se servait actuellement pour endurcir le guerrier à toutes les horreurs du carnage. On ne saurait méconnaître qu’une pensée bien profonde eût présidé à cette organisation de la tribu barbare. C’est une vaste combinaison que celle dont nous trouvons ici les débris : car elle renfermait de tous les côtés la vie du
guerrier et lui traçait une route uniforme vers le but militaire et religieux qu’elle lui avait assigné ; mais là, comme au Mexique, elle n’atteignait ce but qu’en sacrifiant les sentiments d’humanité, qu’en étouffant la voix de la conscience, qu’en faussant en-fièrement l’idée vraie de la religion (1). Faut-il s’étonner après cela qu’elle imprimât aux peuples ce mouvement rétrograde que nous signalions tout à l’heure? Elle ne formait le guerrier qu’en dénaturant l’homme. Du reste, les faits paraissent s’accorder partout pour montrer que les cruautés du sacrifice humain et l’anthropophagie qui en était la conséquence, s’accroissaient dans le sens contraire de la civilisation. On peut en juger parles nations de la Zapotèque et du Yucatan, dont la religion était moins cruelle et chez qui la culture sociale était bien supérieure à celle des Mexicains et des Tlaxcaltèques ; il en était de même chez les nations du littoral, depuis la commerçante cité d’Acla au Darien, jusqu’à Cumana, où les coutumes étaient généralement plus douces et la condition plus policé^ que chez les tribus caraïbes de l’intérieur.
(1)
M0ke,
Hist. des peuples américains, pag.54.
Si des bords de l’Orénoque nous passons à des régions plus méridionales, nos regards, en embrassant cette vaste étendue de fleuves et de forêts qui s’étend entre les bords de l’Amazone et ceux du Rio de la Plata,
découvrent des populations homogènes, au teint jaunâtre, à la taille ramassée, à
la physionomie presque mongole et qui, pour la plupart, parlent des dialectes de
la même langue. Ce sont les Guarani-Brésiliens, sortis évidemment d’une autre
souche que les Caraïbes à la haute stature et aux traits caucasiens : mais leurs usages guerriers et religieux, l’organisation de leurs tribus, les détails même de la vie domestique, les
assimilent si complètement à ces derniers, qu’on peut dire, au point de vue social et historique, qu’il devient impossible de séparer les deux familles. Or, quelque obscur que soit le passé chez les peuples qui n’ont point d’histoire, les
mœurs et le caractère du Caraïbe le rattachent visiblement à ces Américains du Nord parmi lesquels il se souvenait d’avoir vécu autrefois. Les Brésiliens, aussi, venaient de contrées plus septentrionales., et ils en avaient rapporté des coutumes qui rappelaient leur séjour dans ces parages : tels étaient
l'anthropophagie et l’usage de scalper les prisonniers (1), celui d’entretenir du feu auprès de leur couche et l’emploi d’une sorte de calumet. Une autre habitude qu’ils ne pouvaient pas tenir de la race caraïbe, atteste encore mieux leurs relations avec les tribus qui occupaient jadis le territoire des États-Unis : c’est l’arrangement particulier de leurs habitations, disposées sur un autre plan que le carbet, mais pareilles de tout point à celles que construisaient les Hurons et les Iroquois.
(1)■« Voici maintenant ce qu’ils font (les Carios) avec les têtes qu’ils
ont coupées dans un combat: ils enlèvent la peau avec la chevelure, la font
sécher, cl la placent au bout d’une perche en signe de victoire,»etc.(Voyage.
d’Ulrich Schmidel au Rio de la Plata,
coll .Ternaux, pag. 181).
C’est donc bien du nord que venait la race brésilienne, et ses coutumes propres le démontrent aussi clairement que celles qui lui étaient communes avec les Caraïbes. Mais en était-elle sortie en même temps qu’eux ? Les vagues traditions qui répondent à cette question prouvent seulement que les deux peuples avaient été entièrement unis à l’époque d’une grande crise qui avait menacé leur existence et qui fut suivie de leur départ pour leur séjour actuel. Thevet, parlant du respect dont les Caraïbes étaient entourés chez les
Tupis, ajoute (2) : « La réputation des Cannibales est si grande en ce pays-là, que tous nos sauvages, pour se dire et porter vaillants, se disent en être descendus. Car comme après leur déluge, plusieurs (de leurs ancêtres) se furent sauvés sur les montagnes de ce peuple, ils se marièrent là et revinrent ensuite avec leurs femmes, les enfants qui en étaient nés et quelques-uns des parents de leurs épouses. Par ce moyen ils repeuplèrent leur région, ce qui est cause qu’ils sont si vaillants. »
(2) Thevet,
Cosmographie, liv. xxn, cbap. 1.
Il ne saurait donc rester aucun doute sur
l'ascendant qu'avait jadis obtenu ce peuple roi, et les Brésiliens désignaient eux-mêmes le Caraïbe comme leur protecteur et comme le brave par excellence, opinion qui était encore admise au
XVIe siècle chez toutes les tribus du littoral. Ainsi l’idée d’amitié, d’alliance, de communauté de fortune entre les deux races se trouvait généralement établie, quelque vague que fût devenue la mémoire des événements qui les avaient réunis. Les Caraïbes avaient donné aux Brésiliens les devins ou
piayes qui prenaient encore au Brésil le nom de
Caraïbe
ou meyre qui signifiaient étranger (1). A ces prêtres d’une religion sanguinaire, les populations voisines attribuaient les habitudes féroces qui les élevaient à leurs propres yeux et constituaient le guerrier.
On voit donc partout l’action du même peu-pie dominer l’existence des autres, comme si les tribus au teint jaunâtre, à la physionomie chinoise, dont se compose le groupe brésilien, avaient obéi sans résistance à la supériorité d’une race à la fois plus intelligente et plus énergique.
(1)Thevel,
ibid.— Jean de Lery,
et, depuis lors, Humboldt, en font aussi la remarque/ainsi que M. Ferdinand
Denis, le savant bibliothécaire de Ste-Geneviève.
Ces indications suffisent pour montrer
l'influence que le Caraïbe dans l’Amérique méridionale, comme ailleurs le Toltèque ou le Nahua, avait exercée à une époque ancienne sur ces nations inférieures. Issu d’une autre souche et formé, pour ainsi dire, d’éléments plus actifs, il les avait rencontrées éparses, désunies, timides, peut-être, ou étrangères du moins à la passion des armes : mais après s’en être emparé comme d’une masse inerte, il leur avait donné sa propre impulsion. De lui venaient leurs pensées comme leurs lois, leur caractère comme leurs rites, et ce n’est pas de lui que nous l’apprenons, mais d’elles seules. Nous n’essaierons pas de déterminer l’époque, ni la région où s’était forme le lien qui attachait la race brésilienne à la fortune des Caraïbes : les événements accomplis avant les temps historiques ne peuvent être ramenés qu’à demi à la lumière. Cependant, les notions que nous avons relatées dans les chapitres précédents permettent de distinguer vers quel temps ces grands essaims ont pu s’acheminer du nord au midi, pour prendre possession des vastes contrées où les Européens les découvrirent. Le
Livre Sacré
nous fait assister à trois grandes périodes de dispersion des races américaines : c’est celle du déluge de Gucumatz où probablement de nombreuses nations, épouvantées de ce cataclysme, s’éloignèrent, ainsi que semble l’indiquer la tradition des Tupis, du théâtre de ce grand désastre; ce sont les révolutions, causées dans l’empire de Xibalba par les
différentes migrations de la race nahuatl, migrations qui occasionnèrent évidemment le déplacement d’un grand nombre de nations plus anciennes, durant les siècles qui précédèrent ou qui suivirent immédiatement le commencement de Père chrétienne ; c’est enfin l’irruption des tribus du nord sur le Mexique, au temps de la chute de l’empire toltèque, au
xie siècle, et qui paraissent avoir causé également d’immenses bouleversements dans le monde américain. On voit clairement à ces diverses époques les mouvements qui s’opèrent parmi les peuples, tant barbares que civilisés, et si, dans les traditions mexicaines, on ne les aperçoit guère au delà de Panama,· dans celles du Pérou, au contraire, on les voit s’avancer à droite et à gauche, descendre dans les régions situées au delà même du lac de Titicaca et traverser toute l’étendue du continent.
Ainsi qu’on l’a vu précédemment, la marche des tribus avait en général suivi les bords de
l'Océan ; d’autres vinrent, cependant, directement par mer, comme on le verra par les traditions que nous rapporterons plus bas. Chacune de ces migrations, · encore qu’elles fussent d’une même race, s’accomplit à plusieurs reprises et quelquefois même à des périodes fort éloignées. Les nations pampéennes, qui semblent avoir occupé primitivement la partie méridionale du continent, furent naturellement balayées l’une après l’autre devant ces invasions redoutables, quel que fût le degré de civilisation qu’elles eussent atteint, ou bien se confondirent avec les nouveaux venus. Chez un grand nombre de ces nations, on reconnut à l’époque de la conquête des traces
nombreuses d’institutions policées qui rappelaient une civilisation antérieure, déchue comme tant d’autres, et dont les
traditions religieuses, quoique bien vagues déjà, les rattachaient aux dogmes antiques propagés par la race nahuatl. Chez les
Yuracarès
(hommes puissants), c’était un incendie général des forêts dont le récit rappelle en partie l’ouragan dont il est question au
Livre Sacré, et l’éruption des volcans, telle que la raconte le
Codex Chimalpopoca \ cette catastrophe remplace chez eux le déluge des autres nations. Chez les mêmes encore,
Ulé, de l’arbre le plus brillant des forêts qu’il était d’abord (1), se métamorphose en homme, à la prière d’une jeune fille, qui, devenue mère d’une manière
merveilleuse, donne le jour à Tiri qu’arrache de son sein la femelle d’un jaguar. De leur côté, les
Mbocobis racontent que la lune est un homme
[Adago) et le soleil sa compagne
(Gdazoa).
Ce dernier tomba du ciel : un Mbocobi le releva et le plaça où il est ; mais il tomba une seconde fois et incendia toutes les forêts. Les Mbocobis se sauvèrent en se changeant en
Gabinis et en
Caïmans. Un homme et une femme seuls montèrent sur un arbre pour fuir le danger et voir couler les flots de feu : une flamme leur brûla le visage et ils furent changés en singes (2). En résumé, chez la plupart de ces populations, dont on a si mal recueilli les traditions religieuses, on retrouve sous une forme ou une autre le culte du soleil souvent mêlé à celui du serpent ; celui du
Tamoï,
ou le Vieux du ciel, delà Grand-Mère ou du Grand-Père qui rappellent constamment les titres d’Oxomoco et de Cipactonal. C’est le même dieu qui a vécu parmi eux, qui leur a enseigné l’agriculture, qui, avant de les quitter, leur a promis de les secourir au besoin et qui ensuite a disparu à l’orient. C’est aussi en mémoire de son ascension au ciel qu’ils bâtissaient des temples octogones où ils allaient demander par leurs prières et leurs austérités
l'accomplissement des promesses de leur législateur (1).
(1) D’Orbigny,
L’homme Américain^
toin. i, pag.365. Le lecteur se rappel-leva que la balle avec laquelle jouait Hunhun-Abpu était
d’ulé, ulli, ou gomme élastique. La fable ici paraît un souvenir confus
de ces événements antiques, comme d’Oxomoco, épouse de Cipactonal , représenté quelquefois comme
Tlaca-Ocelotl,
)’Homme-Tigre.
(2) V. le
Livre Sacre, pag.31.
(1) D’Orbigny,
L’homme Américain,
torn.h, pag. 102, 277, 319 et 329.
§ XIII.
Origine antique du Pérou. Ecritures et chronologie. Premières émigrations. Arrivée des Chimus ou Géants. Leur migration vers les montagnes, puis à la côte. Invasions étrangères. Ruine de la dynastie primitive du Pérou. Période inconnue jusqu’aux Incas. Réforme religieuse et sociale opérée par ces princes. Traditions antiques de Tijahuanaco et du lac de Titicaca. Les Viracocha. llla-Ticci et Con-Ticci-Viracocha. Pacaric-Tambo et le Tonacatepetl. Les quatre Ayar, souvenir des traditions nahuas. L’Inca Virococha. Culte de Con chez les Chibchas. Traditions et institutions toltèques au
Bogota et au Zenu.
Si
des plaines centrales de l’Amérique du Sud on jette les regards vers la grande
chaîne des Andes, on reconnaîtra que la côte occidentale du continent forme ici
comme une étroite vallée, resserrée entre l'Océan et les montagnes. Au rapport
de quelques observateurs modernes, une seule race d’hommes aurait peuplé toute
cette contrée dont la longueur est de plus de mille lieues. On ne voit pas,
disent-ils, qu’aucune invasion y soit venu déplacer violemment les peuples, et
le rempart de montagnes que la nature y a mises, aurait partout couvert les
anciens habitants des révolutions qui s’accomplissaient dans les autres régions
de l'Amérique. Ces peuples, c’est sous le nom
d'Ando-Péruviens qu’un de ces observateurs (2) les a classés dans le tableau des races américaines. Cependant, si l’on en croit les traditions antiques du Pérou et de l’Equateur, le mouvement des grandes migrations et le choc des masses, pour être plus anciens, ne s’y seraient pas moins fait sentir qu’ailleurs. Les notions que nous comptons présenter à ce sujet sont en partie tirées d’un auteur accusé quelquefois d’avoir exagéré l’antiquité des annales péruviennes (3), mais à qui l’on accorde cependant une connaissance approfondie des choses de cette contrée. Après, avoir hésité à nous servir de ses
Mémoires, nous avons cru, sur un examen attentif de cet ouvrage, ne pas pouvoir lui refuser la confiance qu’il nous paraît mériter. Il est d’accord, pour la plupart des faits les plus importants, avec Herrera, Zarate, Balboa et Garcilaso lui-même ; mais ce qui a surtout entraîné notre suffrage, c’est que ces faits coïncident d’une manière singulière avec les époques mémorables de l’antiquité américaine, telles qu’on les trouve exposées dans le
Livre Sacré
et dans le
Codex Chimalpopoca, qu’on ne le peut en aucune façon soupçonner d’avoir connus auparavant. Quant à Garcilaso, écrivain véridique en tout ce qui touche au côté glorieux de l’histoire des Incas, on ne saurait dire qu’il soit contraire à l’ensemble des annales, rapportées par Montesinos : Inca lui-même et considérant comme barbare (1) tout ce qui était antérieur à sa famille ou établi diversement de la législation des fils du Soleil, il se contente de commencer l’histoire de son pays avec Sinchi-Roca, réformateur religieux et fondateur d’une nouvelle dynastie, dont il fait naturellement le second monarque du Pérou, afin de le rattacher immédiatement à Manco-Capac, que les peuples étaient accoutumés à vénérer, comme la souche sacrée des rois et des nations dès la plus haute antiquité.
(3) Montesinos,
Mémoires sur l'Ancien Pérou, coil.Ternanx. Munoz, historiographe de l’Amérique, nommé par le roi d’Espagne, dans une note jointe au manuscrit de cet ouvrage, dit que Montesinos avait été deux fois visiteur (visitador) au Pérou, qu’il l’avait parcouru dans tous les sens et y avait résidé plus de quinze ans. Le P. Rodriguez, dans son
Histoire du Maragnon, dit que personne ne connut mieux les antiquités du Pérou. Ajoutons que les monuments de Tiahuanaco et d’autres si supérieurs à ceux de la civilisation des Incas, sont le meilleur témoignage en faveur des nations civilisées, dont Montesinos donne les annales, et contre les assertions de Garcilaso, qui ne peut s’empêcher de le reconnaître lui-même
(.Comentar. Ileales, lib. 111, cap. 1).
(1) C’est dans le même esprit que les historiens romains omirent à dessein tout ce qui avait traita la civilisa-lion et aux annales étrusques, détruites par leurs consuls après la prise de Véies, et que Scipion ordonna la destruction des monuments et des bibliothèques de Carthage. De même encore les Grecs considéraient les Perses et les appelaient des barbares comme leurs successeurs appelaient aussi nos pères des barbares, an
moment même où de vrais barbares, les Turcs, s’apprêtaient à leur prendre Constantinople. Du reste Garcilaso dit, avec ses préjugés ordinaires, que les Incas étaient incapables de faire le mal et en dit le moins qu’il peut. Balboa ne paraît pas du même avis
Les divers écrivains qui ont traité de l’histoire du Pérou, et Garcilaso le premier, s'accordent à donner aux régions, comprises actuellement sous ce nom, une origine fort ancienne et à reculer, bien au delà de la monarchie des Incas, le berceau des nations qui furent depuis soumises par leurs armes (1). La plupart sont d’accord également à reconnaître qu’en outre des
quipos ou nœuds de diverses couleurs, dont ils se servaient pour compter les temps et les choses, les peuples de cette contrée possédaient plusieurs sortes d’écritures, les unes
calcul if ormes, ainsi qu’elles étaient surtout à Quito, les autres figuratives et monosyllabiques (2), d’autres enfin phonétiques comme les nôtres, si l’on en croit Montesinos et, peut-être, Herrera lui-même. Le papier fabriqué des feuilles du bananier, dont on se servait encore pour écrire au Chili, vers l’époque de la conquête, aurait existé dix-huit cents ans au moins avant notre ère, ainsi que les
quilcas, peaux de bêtes préparées ou parchemins, sur lesquels on écrivait alors les annales du pays : car « on connaissait l’usage des lettres, et il y » avait des hommes savants et des maîtres qui enseignaient à » lire et à écrire, ajoute l’auteur (1), comme le font aujourd’hui » les
Amautas. » Dès cette époque reculée, « le roi Inti-Capac avait » établi l’année solaire de 365 jours et six heures, et partagé les » années en cycles de dix, de cent et de mille ans, au moyen des» quels ils conservèrent l’ordre des dynasties royales (2) et la » mémoire des événements les plus reculés de leur histoire. »
(1) Garcilaso parlant des populations appelées
Géants dans la tradition, et auxquels on attribuait les édifices de Tiahuanaco, dit : « Sera bien démos « cuenta de una hûtoria notable y de » grande admiracion, que los Natu» rales della (region de Mania) tienen » por tradicion de sus aniepasados, » de
muchos siglos atras, de uiios » gigantes, que dicen fueron por la » mar â aquella tierra....
{Cornent. Real. lib. ix, cap. 9.) — Montesinos fait remonter la première dynastie péruvienne à 2,500 ans avant J.-G. — Suivant Velasco,
Hist, du roy. de Quito, coll. Ternaux, tom.
1,
pag. 12, la
race des peuples, dits géants, habitait encore la côte de Mania, dans le commencement de Père chrétienne, et elle en avait chassé des nations plus anciennes. Au Cundinamarca la tradition faisait remonter à vingt cycles^ la réforme religieuse due au prophète Suhacon : on sait que ces cycles étaient de soixante ans chacun, comme au Japon. (Zamora,
Hist, del Nuevo Reyno de Granada, lib. 11, cap. 14, pag. 134.)
(2) Voici ce que dit Herrera : « lu-ע
dios Christianos hahavido que se han
יל
confesado por el Quipo, como un
י>
Castellano por escrito, i algunos In-׳> dios se han confesado llevaodo la « Confesion escrita con
pinturas, 1
» caractères, pintando cadannode los » diez Mandamientos por cierto modo, » i luego haciendo ciertas senales
י»
como cifras... de donde so puede » colcgir la viveça de aqiicllos ingenios, pues por este modo
escri-» ven tam bien muchas oraciones , » i asi nunca, los Indios tuvieron Le» tras, sino cifras, ό Memoriales, en la » forma dicha. Por unas cuentas de » pedreçuelas aprenden quanto quieren tomar de memoria.... Sus
esrituras, como no eran letras, sino » dicciones, sin necesidad de travarse « unas con oiras, las ponian de arriba » abajo ; i de esta manera, con ־sus
» figuras se enlendiau. »
{Hist. gen.
decad. v, lib. iv, cap. 1.)—Balboa, parlant du testament écrit de Huayna-Capac, dit : « On prit un long bâton
ou » espèce de crosse et on y dessina des » raies de diverses couleurs d’où l’on » devait avoir connaissance de ses » dernières volontés ; on le confia » ensuite au
Quipocamayoc ou notaire (ou plutôt archiviste-général). »
{Hist, du Pérou. Coll. Ternaux, pag. 198.) Ainsi 011-écrivait aussi les signes qu’on faisait avec les quipos. Voir encore Aubin,
Mém. sur la peinture didactique et l’écriture fig. des anciens Mexicains, Paris, 1849, pag. 59. Quant aux
quipos, ils étaient connus au
Paruhuas de Quito longtemps avant les Incas; les chefs araucaniens s’en servent encore aujourd’hui et les lisent couramment. Les écrivains des États-Unis comparent les quipos au
Wampum ou colliers de porcelaine dont parlent Lafîtau et Charlevoix et disent que les Indiens du nord s’en servaient de même pour conserver leurs annales !Smith’s
History of Ncm-York, vol. 1, pag. 74).
(1) Montesinos,
Mémoires sur l’ancien Pérou, pag. 33. « Quand D. Alonso de Eveilla se trouvait au Chili, dit-il, il manqua de papier pour écrire les vers de son poème, et un Indien lui enseigna l’usage de ces feuilles. Ils écrivaient aussi sur les pierres. Un Espagnol a trouvé des inscriptions de ce genre sur les édifices de Quinoa, à trois lieues de Guamanga (à 60 1. environ à
l'O. N. O. du Cuzco), et personne ne put les lui expliquer... » Cette écriture serait-elle la même que M. Aubin a si bien appelée
calculiforme? elle serait entièrement phonétique, et les Arauçaniens, au dire des voyageurs, en auraient conservé le secret. Remarquons ici que le mot
quilca, qui n’a pas de sens dans le qquichua, pourrait avoir sa racine dans le mot
cuiloa (nahuatl), écrire, peindre.
(2) « Ce dernier cycle ׳celui de mille ans) se nommait
Capac-hesata on
Intip-huatan ,
c’est-à-dire grande année du soleil. C’est au moyen de ces cercles qu’ils ont conservé la chronologie de leurs rois. Les Indiens se servent très-habituellement de celte phrase.
isaay Intiapillis campin cay, cay caria; telle ou telle chose est arrivée, il y a deux soleils. C’est parce que le licencié Polo de Indagardo n’a pas compris cette phrase, qu’il a avancé que les Ingas
n’avaient pas plus de 450 ans d’antiquité; il a confondu le cercle de
cent ans avec celui de mille ans. Les Indiens disent 4500, ce qui les
fait remonter au déluge. Cependant il est très-vraisemblable que les Ingas n’ont en effet régné que 400ans.»
(Mém. sur l'ancien Pérou, pag. 62.' Nous ne changeons rien aux mots qquichuas, qui sont fort peu corrects par la faute du copiste ou du correcteur du traducteur de Montesinos.
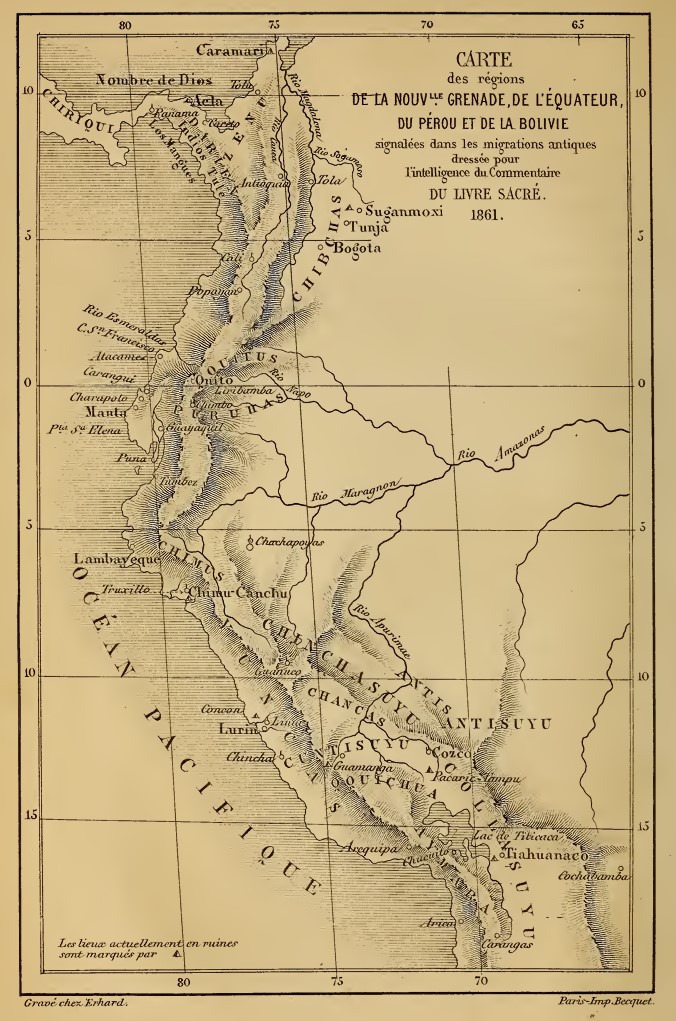
C’est ainsi que les traditions, d’accord avec les chants historiques des Amautas, avaient transmis le souvenir des premières tribus qui, vingt-cinq siècles avant notre ère, avaient peuplé le Pérou, depuis les côtes qui sont sous l’équateur jusqu’à l’extrémité du Chili. Ces tribus seraient venues indistinctement des Andes, de terre ferme et par la mer du Sud; elles seraient demeurées en paix les unes avec les autres, pendant une période d’environ deux siècles, après quoi des contestations s’étant élevées sur la possession des sources et des pâturages, les premières guerres auraient éclaté à cette occasion. Chaque tribu se choisit alors un chef capable de la conduire au combat, et ceux-ci auraient profité de cette circonstance pour étendre leur pouvoir. Tel était l’état des choses, lorsqu’apparurent les quatre frères avec qui commencent d’ordinaire toutes les histoires péruviennes, mais dont la légende rappelle si clairement les antiques traditions du
Livre Sacré, que nous croyons devoir la laisser momentanément pour la reprendre plus bas, lorsque nous traiterons des notions religieuses conservées dans ces contrées. Le nom du fondateur de la première monarchie péruvienne aurait été Pirhua, qui réunit plusieurs peuplades éparses et qui aurait bâti la ville du
Cuzco, afin de pouvoir les retenir plus aisément sous son autorité (1).
(1) Id.
ibid. pag. 6. Les diverses légendes qui regardent
Pirhua nommé d’abord
Ayar-Uchu-Topa, n’ont rien de précis ni d’arrêté et elles paraissent confondues avec des traditions d’une date postérieure. Sous la dynastie des Incas, on distinguait la monarchie
qquichua par le nom des quatre aires des vents. Ainsi
Cuzco étant considéré comme le centre ou l’ombilic de la terre, on appelait ce qui était à
l'0rient de cette ville
Antisuyu, région des Antis, ce qui était à l’occident
Cuntisuyu,
région de Cunti, au nord
Chinchasuyu,
région de Chincha, et au midi
Collasuyu, région de Collao. C’est dans celle-ci qu’existait le lac fameux de Titicaca.
Sous le règne de Manco-Capac Ier, arriva au Pérou, suivant Montesinos, la première émigration étrangère : ses bandes nombreuses sortaient à la fois des provinces méridionales
d'Arica et de
Collao, tandis que d’autres descendaient des Andes au
nord-est vers le Cuzco. La tradition leur donnait le nom
Rimas (2) : c’étaient des hommes grands et forts; mais leur caractère paisible les fit regarder comme une classe inférieure. Plusieurs de leurs tribus s’établirent dans les provinces de
Puma-cocha, de Quinoa, de
Huaitara et de Chachapoyas, qui s’étendaient jusqu’à plus de cent lieues au nord du
Cuzco et où l’on trouvait encore au temps de la conquête des débris d’édifices antiques, monuments de cette vieille race : il y en eut d’autres, qui, on ne sait pourquoi, ajoutent les Amautas (1), ayant construit des canots, descendirent le fleuve Apurimac, pour aller peupler sans doute les contrées arrosées par le Maragnon. Deux comètes, qui se montrèrent, dix-sept cents ans environ avant Père chrétienne, auraient été suivies d’une grande sécheresse, dont les conséquences auraient fait périr la plupart des habitants de la côte entre
Tumbez et
Arica (du 3° au 18° sud), après quoi le pays serait demeuré à peu près désert. Mais quelques années plus tard, il aurait été repeuplé par des étrangers de haute stature et d’un aspect monstrueux, dont l’apparition aurait jeté l’épouvante parmi ceux qui y étaient restés. Ces étrangers sont indifféremment appelés les
Géants et les
Chimus (2), dans les histoires ; c’est à la côte où se trouve le port de
Manta sur
l'Océan Pacifique qu’on les vit débarquer (3), sans qu’on sache d’où ils étaient partis.
(2) Montesinos,
Mémoires sur l’ancien Pérou, page 26. M. Ternaux a laissé passer tant de fautes de copiste ou d’impression dans les ouvrages qu’il a traduits de l’espagnol, qu’on a le droit de douter si le mot
Atumuruna est correct. Tel qu’il parait on ne le trouve point dans le
vocabulaire de la langue qquichua,.
Cependant, il serait possible qu’il vint de
hatun, supérieur ou ancien ou grand, et de
runa, homme. Ceci correspondrait à — hommes anciens ou grands, peut-être à
géants, cette dernière dénomination étant généralement celle de toutes les populations ancien-nés, dont l’origine a quelque chose de mystérieux.
(1) Ceci donnerait à penser que c’élaii une race primitive et conquise, provenant d’une de ces grandes migrations antiques de peuples chassés de leur pays.
(2) Montesinos,
Mémoires, etc. pag. 67 et 74. L’auteur n’identifie les
Géants avec les
Chimus qu’à la pag. 78, où le récit prend un ton plus conforme à
l'histoire. Sous le nom de Chimus, Garcilaso les reconnaît lui-même comme une des plus anciennes et des plus puissantes races du Pérou: à la même famille auraient appartenu les
Chinchas,
quoique les deux nations eussent été souvent en guerre pour la possession des pâturages (Com.
Real. lib. vi, cap. 32).
(3) Manta, aujourd’hui petit port de mer au N. de
Monte-Cristo, dans la république de
[,Ecuador (0°57’ sud). C’est là
également que Garcilaso et les autres auteurs font aborder ceux qu’ils appellent
Géants, d’après la tradition; tous également sont d’accord sur les grands édifices qu’ils y laissèrent et dont on voit encore des restes à la
Punta-Santa-Elena (2e 11’ sud). Conf. Garcilaso,
Corn. Real., lib. ix, cap. 9. — Herrera,
Hist. gen.,
decad. v, lib. 11, cap. 1. — Montesinos,
Mémoires, pag. 75. — Velasco,
Hist, du roy. de Quito, chap. 1, pag. 12. Suivant ce dernier, ils occupaient encore toute la côte de
Manta et de
Charapoto, au commencement de l’ère chrétienne. Les traditions disent qu’ils furent consumés par le feu, à cause de leurs sodomies: mais les mêmes histoires ajoutent plus loin, qu’ils en furent chassés pour la plupart par une autre nation qui arriva également par mer, les
Puruhas
ou
Puruhuas qui paraissent avoir appartenu à la race nahuatl.
Ces étrangers occupèrent d’abord tout le pays qui s’étend entre la rivière de Guayaquil et le rivage de
l'Océan, où l’on voit encore divers travaux qui leur sont attribués : à la pointe de
Santa-Elena, ce sont des puits creusés dans le roc, et dans l’ile de
la Plata, qui est en face du continent, un temple dédié à
Umiña,
qu’on appelait le dieu de la santé et qui n’était pas moins célèbre autrefois que celui de Pachacamac. Chassés plus tard par d’autres populations, ces géants pénétrèrent dans l’intérieur des montagnes jusqu’à Huaitara et Quinoa, où, ajoute l’annaliste (1), ils
trouvèrent des édifices déjà commencés. Cieça de Leon mentionne des ruines d’une grande importance (2), ornées d’inscriptions sculptées qui paraissent se rapporter à cette indication ; elles existaient encore de son temps sur les bords du
Rio-Vinaque, et suivant la tradition des Indiens de
Guamanga ces monuments avaient été édifiés de longs siècles avant la domination des Incas, par des hommes blancs et barbus, semblables à ceux qui avaient construit les palais et les temples de
Tiahuanaco. Quant aux Chimus ou Géants, des montagnes ils seraient redescendus sur les côtes du Pacifique jusqu’auprès de Truxillo, et ils
auraient été des premiers à coloniser toute la région, dite des
Yuncas, c’est-à-dire les plaines de terre chaude, jusqu’aux confins du Chili (3). Les Amautas, dans leurs récits merveilleux, disaient qu’ils étaient les fds de la mer, au sein de laquelle ils avaient été créés par le dieu
Pachacamac, ou créateur de toutes choses ; car tel était le titre qu’ils donnaient à la divinité suprême à qui les chefs de cette nation bâtirent le temple fameux de ce nom dans la vallée de
Lurin. Leur arrivée au Pérou datait de quinze siècles avant l’ère chrétienne, et on les regardait comme la race la plus anciennement civilisée de cette partie du continent (1). Ce qu’il y a encore de remarquable à leur sujet, c’est qu’ils travaillaient les pierres avec des instruments en fer qu’ils avaient, dit l’annaliste (2), apportés de leur pays. Du reste on les accusait d’être des hommes superbes et orgueilleux, adonnés à tous les excès de la table et de la chair, mais en particulier au vice contre nature (3). Dans la suite, lorsque les Incas tentèrent de les soumettre à leur puissance, ils n’y réussirent qu’en admettant en quelque sorte leurs rois comme leurs alliés et en recevant eux-mêmes le culte de Pachacamac dans l’empire.
(4) Umiña,
pierre précieuse en qquichua. La tête de cette idole était faite d’une émeraude d’une grosseur prodigieuse (Velasco,
Hist, du roy. de Quito, liv. 11, § 4, n. 6).
(1) Quinoa, près de
Guamanga, à 601. environ O.-N.-O. du Cuzco. Ceci est une preuve de l’étendue de la puissance antique des
Chimus
ou
Géants,
dont on retrouve le nom dans plusieurs localités, telles que
Chimbo,
non loin de
Riobamba, et le célèbre pic du
Chimborazo (ou neige de Chimbo), ce qui tendrait encore à prouver que les très-anciens habitants du royaume de Quilo furent aussi des Chimus,
longtemps avant les conquêtes des
Scyris ou
Caras.
Cependant, si ce que Montesinos dit est vrai, ils auraient été précédés
encore dans ces montagnes par d’autres peuples civilisés, puisqu’ils
trouvèrent des édifices commencés à Quinoa.
(2) Cieça de Leon,
Chronica del Peru, part. 1, cap. 87. — Herrera,
Descrip, pag. 42.
(3) Toute la côte paraît avoir été originairement peuplée par la même race, à laquelle d’autres vinrent peu à peu se mêler.' Les Incas les désignaient tous sous le nom générique de
Yuncas, gens des plaines ou de terre chaude. M. Léonce Angrand, ancien consul et consul général au Pérou et en Bolivie, qui nous a fourni sur ces contrées un grand nombre de renseignements, dit que les langues des populations
Yuncas différaient essentiellement du
qquichua et de
l'aymara. Des auteurs tout à fait modernes désignent sous le nom de
Chis
les hommes de la race la plus ancienne du Pérou, établie le long des côtes du Pacifique, entre les 10e et 14e degrés de latitude sud (Rivero et Tschudi,
Antiquités Péruviennes, trad, française dans la
Revue des races latines, avril 1859, chap. 2, pag. 511). Suivant les mêmes, la capitale antique des
Chimus, portant comme le chef de cette nation le nom de
Chimu-Canchïi (Enclos du Chimu), existait auprès de l’emplacement de la cité actuelle de Truxillo, et les ruines de cette ville, décrites par Rivero, couvriraient, suivant son dire, presque toute l’étendue qu'il y a entre le village de
Mansiche et le
Rio Mocha (Id.
ibid. oct. 1859, chap, x, pag. 450). Suivant M. Angrànd qui a visité également ces ruines, et qui les a dessinées, le groupe principal existe à un quart de lieue de Truxillo, vers le S.-O. dans la direction du port de Huanchaco : de l’autre côté de la roule à droite, se trouve la
huaca dite
de San-Pedro,
une des plus vastes nécropoles du Pérou. Les restes des palais du Grand-Chimu sont généralement en
adobe
et en
tapia (pisé antique des Indiens).
(2) Montesinos,
Mémoires, etc. , pag. 75. A la page suivante l’auteur répète que la vue de leurs armes de fer jeta l’épouvante dans les
populations. Velasco dit de son côté, en parlant des armes des Péruviens : « Ils n’employaient pas le fer, quoiqu’ils le connussent sous le nom de
Quillay, parce qu’ils savaient tremper le cuivre comme l’acier.
(Hist, du roy. de Quito, liv. 11, § 7, art.
armes.) —
« Il est remarquable, dit Molina, que le fer, qu’on suppose universellement avoir été inconnu aux nations américaines, a un nom particulier dans la langue chilienne. On l’appelle
panilgue et les instruments qui en sont faits
chioquel, pour les distinguer de ceux faits d’autres matières et qui sont compris sous le nom générique de
nulin. (The geographical na t·, and civil history of Chili, translated from the original Italian, etc. London, 1809, chap. 4.) Le
Mercurio Peruano, tom. 1, pag. 201, an. 1791, mentionne les mines suivantes comme ayant été
travaillées par les Incas (ou bien ceux qui les précédèrent) :
Escamera, Chilleo et Abatanis,
d'or, Choquipina et Porco,
d’argent;
Curahuato, de cuivre ;
Carabuco, de plomb (probablement le
voisinage d’Oniro, dit Bollaert,
Antiquities, pag. 90, donnait de l’étain) et les magnifiques
mines de fer d’Ancoriamès (16° 25׳ sud) sur la rive
orientale du lac de Titicaca. L’Amérique est encore à découvrir! il faut ôter les voiles sous lesquels la politique espagnole a voulu ensevelir son ancienne civilisation.
-
(3) Ce nom de
géants donné aux Chimus, les reproches qu’on fait partout à leur orgueil et à leur luxure sont exactement les mêmes que les Nahuas opposaient aux Quinamés : remarquons que nulle part encore il n’est question de
l'anthropophagie ni des sacrifices humains,· importés par la race nahuatl, ce qui pourrait bien faire croire que dans le culte de Pachacama, créateur du monde, on retrouvât l’origine de celui des Incas qui parait n’être qu’une rénovation de la religion primitive, après la ruine de la religion toltèque.
Le
XIIIe siècle avant l’ère chrétienne est signalé par la réunion d’un grand nombre d’Amautas, qui travaillèrent à la correction du calendrier civil et religieux et par des modifications dans le culte du royaume du
Cuzco. Dans les huit ou dix siècles suivants, on trouve encore, de temps en temps, des invasions sortant du sud ou du nord : mais ce qu’il y a de plus remarquable, ce sont les progrès de l’astronomie introduits successivement par les rois qui s’en occupaient d’une manière particulière ; c’est ainsi que trois siècles avant la naissance du Christ, Yahuar-Huquiz, l’un des plus habiles astrologues de son temps, « découvrit la nécessité d’intercaler un jour tous les quatre ans, pour former les années bissextiles; mais, ajoute la tradition (1), il imagina au lieu de cela d’intercaler une année au bout de quatre siècles, calcul que les Amautas et les autres astrologues qu’il consulta, trouvèrent très-juste. »· Cent cinquante ans après, des peuples nouveaux envahissaient le Pérou du côté de la province de Tucuman (2) ; bientôt après, d’autres arrivaient en descendant les Andes, demandant à s’établir paisiblement dans le pays : ils venaient, disaient-ils, d’une contrée .lointaine, riche et puissante, d’où ils avaient été chassés par des étrangers de haute taille, et pour arriver au Pérou ils avaient dû traverser d’immenses forêts et des contrées marécageuses remplies de bêtes féroces (3).
(1) Ce fut
Ayay-Manco, trente-troisième roi du Cuzco, qui convoqua la seconde assemblée pour la réforme du calendrier, 700 ans environ av. J.-C. C’est alors qu’on décida qu’on ne compterait plus par lunes, mais par mois de trente jours, et par semaines de dix. Ils nommèrent petite semaine les cinq jours qui restaient à la fin de l’année; ils y ajoutèrent un jour pour les années bissextiles et les nommèrent
Allacauqui. Ils comptaient aussi par décades d’années et décades de décades, qui faisaient un soleil ou cent ans ; l’espace de cinq cents ans se nommait
pacha cuti. La réforme dont il est question ensuite sous Yahuar-Huquiz eut lieu environ 350 ans plus tard. (Montesinos,
Mémoires, etc. pag. 95 et 101.)
(2) Au 26° sud, dans la république Argentine.
(3) Montesinos,
Mémoires,
etc. pag. 103. Ces notions sembleraient indiquer que ces étrangers auraient traversé les contrées de l’intérieur arrosées par l’Amazone : d’où
venaient-ils ? c’est un problème; mais nous inclinons à penser qu'ils étaient de la même race que les Chimus et qu’ils avaient été déplacés par une des premières révolutions arrivées en Xibalba depuis l’invasion nahua. Nous ne prétendons point toutefois imposer celte opinion.
Entre tant d’invasions et de migrations différentes, il est bien difficile de reconnaître à quelles races ces populations pouvaient appartenir. Mais il ne serait pas impossible qu’on retrouvât dans ces hommes, chassés par des étrangers à la taille .élevée, un groupe de la race antique des
Vitznahuas, et qu’on pût les identifier avec ces hommes, à la complexion blanche et à la face barbue, dont parlent les traditions du lac de Titicaca ; leur civilisation aurait eu ainsi sa source dans
l’empire de Xibalba, antérieurement aux changements apportés par la race nahuatl (1). Les deux siècles qui suivirent leur arrivée sont regardés comme l’époque la plus florissante de l’histoire ancienne du Pérou (2), ce qui ferait supposer encore qu’ils ne furent pas étrangers au progrès de la civilisation. La fin de cette période de prospérité coïncide d’ailleurs avec les . noms de deux rois suffisamment significatifs, Manco-Capac III et Manco-Capac IV (3) : mais elle fut suivie d’une longue période de douleur et d’angoisse ; on vit des signes effrayants dans le ciel et l’on éprouva des tremblements de terre qui durèrent deux mois. Le Pérou fut envahi par des nations féroces, dont les unes arrivèrent par le Brésil et les Andes, les autres du côté de terre ferme, ce qui causa de terribles et sanglantes guerres, pendant lesquelles se perdit l’usage des lettres qu’on avait conservé jusqu’alors (4).
(1) Il reste trop peu de chose sur ces temps anciens pour qu’il soit possible d’émettre une opinion sans se hasarder. Cependant, disons que les têtes d’oiseaux gravées sur le portique monolithe de Tiahuanaco , et dont M. Angrand a rapporté jusqu’au moindre détail avec une exactitude si parfaite, rappellent, et c’est aussi l’opinion de notre savant ami, le culte du soleil figuré par l’Ara au Yucatan, dans quelques parties de la Mixtèque et par le
mythe de
Vukub-Cakix (Sept-Aras) au
Guatemala. Ce culte, établi avec la civilisation qui en était la conséquence, à Tiahuanaco et ailleurs, donna naissance à ces vastes et magnifiques édifices qui faisaient l’admiration même des Incas et qui restèrent inachevés, par suite de l’invasion subséquente de la race nahuatl qui arriva à peine 200 ans plus tard.
(2) Montesinos, Mémoires, etc.,p. 107.
(3) Le nom de
Manco-Capac, unique dans l’histoire de la dynastie inca, qu’il commence, suivant Garcilaso, pourrait bien avoir été attribué comme un titre aux chefs des diverses dynasties qui régnèrent antérieurement.
(4) Montesinos,
Mémoires, etc., pag. 108.11 paraîtrait plutôt que ces lettres furent remplacées par des caractères différents, apportés probablement par la race conquérante.
Titu-Yupanqui,
qui régnait en ce temps-là, se prépara à les coin-battre : mais « on l’avertit
bientôt qu’une armée nombreuse s’avançait du côté du Callao ; que les nations féroces qu’on avait aperçues dans les Andes s’approchaient également, et que parmi elles il y avait un grand nombre de
noirs (1);
que les habitants des plaines commençaient aussi à se soulever et avaient réuni une armée considérable (2). » Le roi, malgré l’avis de ses ministres, voulut marcher en personne au-devant d’eux ; mais, dans le fort de la bataille il fut tué, et sa mort plongea le royaume entier dans l’anarchie.
(1) Cette invasion qui vient du Brésil et des bords de l’Amazone, accompagnée d’un grand nombre de
noirs, est fort remarquable. Ce n’est pas la première fois qu’il est question dépeuples noirs en Amérique avant la conquête. Colomb avait appris lors de son second voyage que File de Haïti était attaquée quelquefois par une race d’hommes noirs,
gente negra, qui avaient leur demeure dans le sud ou le sud-ouest. 11 les distingue parfaitement des Caraïbes, qu’il appelle
Cari-־bales (Herrera,
Hist.'gen. decad. 1, lib. iv, cap. 9). Vasco
Nuñez de Balboa, qui franchit le premier l’isthme pour parvenir à la mer du Sud, trouva des hommes noirs au Darien : « Ce » conquérant, dit Gornara, entra dans » la province de
Quareca. Il n’y trouva » point d*or, mais quelques nègres » esclaves du seigneur du lieu. Ayant » demandé à ce seigneur d’où il avait » tiré ces esclaves noirs, il reçut pour » réponse que des gens de cette cou» leur vivaient assez près de là et » qu’on était constamment en guerre » avec eux.
» (Hist, de Indias, fol. xxxiv.) Gomara ajoute que ces nègres étaient en tout semblables aux
nègres de Guinée et pense qu’on n’en a jamais plus vu d’autres en Amérique. Gumilla parle également de nègres qui habitaient les bords de l’Orénoque.
(El Orinoco ilustrado, etc. tome 1 , pag. 78.)
(2) Montesinos,
Mémoires, etc., pag. 110.
Les traditions qui nous ont conservé la mémoire de ces événements, laissent, malgré leur brièveté, entrevoir suffisamment l’étendue des changements qui s’opérèrent alors dans le Pérou. L’indépendance des provinces, dont chacune se donna un chef partitculier, l’abandon du Cuzco par les habitants et par l’héritier même du dernier souverain, à qui les historiens n’accordent plus que le titre de roi de
Tambotoco, non moins que la confusion qui règne, dans les récits subséquents, jusqu’à la fondation de la monarchie, des Incas, ouvrent un vaste champ aux conjectures : il y a tout lieu de croire que d’autres dynasties, également étrangères à ces princes et aux dynasties primitives, parleur culte comme parleurs institutions, auront rempli ce long intervalle qui dura plus de mille ans. La ville du Cuzco, abandonnée même par les prêtres du Soleil à la suite de plusieurs nouveaux tremblements de terre, aurait été entièrement détruite alors et cessé d’être la capitale du pays (1). L’époque de ces invasions formidables et de ces désas-très, fixée vers le premier siècle de notre ère, concorde avec celle des premières migrations de la race nahuatl et des grandes
révolutions de l’empire de Xibalba. Il ne serait donc pas impossible 4ue les nations barbares qui changèrent alors la face du Pérou eussent été de celles qui se laissèrent entraîner par cette race énergique à conquérir des régions nouvelles : descendant des
Andes et venant du Brésil, elles auraient suivi les routes indiquées plus haut, ■ravagé l’intérieur de l’Amérique méridionale, peut-être même jusqu’au Rio de la Plata, envahi, ensuite les bords du lac de
Titicaca et refoulé les anciens Qquichuas (les Aymaras ?) à Tambotoco. Car c’est alors apparemment que sortit des vallées de Coquimbo ce vaillant capitaine du nom de
Cara, qui conquit
Chucuvitu et les îles du lac (2), où il massacra les hommes blancs et barbus qui avaient établi dans cette ville, ainsi qu’à
Tiahuanaco,
le siège de leur empire et de leur religion (3). C’est probablement ce prince qui, après ses victoires, fixa son séjour dans la cité de
Tapac-ri, où ses descendants régnaient encore sous le même nom, gardé comme un titre royal, au
XIIe siècle, lorsque l’Inca Capac-Yupanqui les soumit à son autorité (1).
-
(1) La barbarie la plus complète succéda à la civilisation, suivant la tradition, au point que les lettres se perdirent. Mais il est évident que c’est dans cet intervalle que devait régner la civilisation nahuatl. Quant aux lettres dont on se servait, il faut
remarquer que le roi de Tambotoco, regardant les lettres comme la source des malheurs publics, en défendit
lui-même l’usage (dans son petit royaume, bien entendu), et un Amauta ayant inventé, quelques années après, une nou-velle espèce de caractères, fut brûlé vif pour ce délit. Ceci inclinerait bien à penser que ces caractères étaient ceux des nations étrangères, dont le culte venait de supplanter l’ancienne religion.
Tambo-Toco, que Balboa
traduit Maison de
l'Aurore ou de la Fenêtre, était le même lieu que
Pacaric-Tambo , regardé par les auteurs comme le berceau de la première monarchie péruvienne. C’était une ville à 7 ou 8 lieues au sud du Cuzco (Balboa,
Hist, du Pérou, pag. ■'!). !
-
(2) Herrera,
Hist, gen., decad. v, lib. tn, cap. 6.
-
(3) Garcilaso,
Comentarios Reales,
lib. in, cap. 1. Cet écrivain décrit avec admiration les grands édifices de Tiahuanaco , que l’Inca Mayta-Capac trouva abandonnés et inachevés
lorsqu'il réduisit à son obéissance la population riveraine du lac de Titicaca.* Les monuments de
Chuquivitu ou
Chucuytu n’étaient pas moins
remarquables. M. Angrand a dessiné les rui-nés de Tiahuanaco et en a levé les plans avec un talent et une exactitude dont la science ne saurait lui
témoigner trop de gratitude. Dans la grande colline artificielle dont nous avons examiné avec attention les dessins, nous avons cru reconnaître le système des grandes pyramides, sur le sommet desquelles les peuples de Palenqué et d’Yucatan construisaient leurs temples et leurs palais; on n’y distingue que difficilement, cependant, les
traces de plusieurs terrasses superposées.
-
(1) Garcilaso,
Comentarios Reales,
lib. ni, cap. 14. Cel auteur donne au chef de Tapac-ri le nom de
Cari, qu’il tient, dit-il, comme un titre des rois ses ancêtres. C’est la province de
Tapacari, dans le département actuel de
Cochabamba.
-
Cette race qu’on reconnaît, d’un côté, à ses grandes
institutions sociales, de l’autre, à ses mœurs désordonnées, à ses coutumes sanglantes, à l’anthropophagie religieuse, aux sacrifices
humains, comme au culte du serpent, de
Con et de
Viracocha (2), se répandit sur la plus grande partie de l’Amérique méridionale,
entraînant de gré ou de force les peuples à ses autels superstitieux. Ses traces se discernent, ainsi qu’on le verra tout à l’heure, dans toute l’étendue du Pérou : durant mille ans entiers elle domina, changeant et se
modifiant sans doute, comme dans l’autre moitié de l’hémisphère, au contact des populations ou des inspirations schismatiques de ses divers Viracochas ou prophètes (3), jusqu’à ce que les Incas, profitant de leurs dissensions, eussent réformé le culte, en brisant les idoles et ramené la monarchie à son
existence primitive. L’origine de cette dynastie est racontée diversement par les auteurs. Il était naturel que ses admirateurs la ramenassent à MancorCapac, ce mythe ou ce héros déifié qu’on trouve, comme ailleurs Quetzalcohuatl, au commencement de toutes les histoires. La plupart, cependant, sont d’accord pour les faire sortir d’une contrée voisine du lac de Titicaca, et suivant un écrivain digne de foi (1), la révolution qui porta les Incas au trône aurait pris naissance dans le Collao, avec un prince du nom d’Inca-Zapana, qui s'éleva le premier et prit les armes contre les femmes qui gouvernaient dans la ville de
Chuncara (1). Vainqueur de ces Amazones, dont le gouvernement et la défense rappellent encore les femmes-chefs qui exerçaient le commande- ’ ment entre diverses nations de la race nahuatl, Zapana
marcha des bords du lac de Titicaca vers le Cuzco, dont il s’empara, après avoir
soumis les contrées environnantes. Rien n’empêche que ce ne soit là le héros
réformateur de la religion que les princes de sa famille auraient depuis
environné des légendes sacrées relatives à Manco-Capac. Mais que ce soit lui ou
seulement son successeur qui ait eu la gloire de relever la splendeur du Cuzco, il parait que des princes de son nom continuèrent à régner après lui dans la province de
Cochabamba d’où il était sorti et qui se soumirent dans la suite aux Incas (3).
-
(2) Id.,
ibid., passim. Nous verrons
t plus loin les notions religieuses des Nahuas, qui s’étaient conservées
malgré la domination des Incas.
(3) La religion des Nahuas ou
Toltèques avait cela de commun avec les sectes enfantées dans le sein du
christianisme qu’elle donna naissance à des schismes fort nombreux. Au milieu des rites sanglants de l’anthropophagie et des sacrifices humains, il s’éleva fréquemment, des hommes, animés d’un esprit véritablement religieux, qui travaillèrent à abolir ces coutumes cruelles. Ces dissidences, dont les chefs prirent souvent pour drapeau les noms de Telzcatlipoca, dans ses
symboles guerriers ou ennemis de l’hu-inanité, et de Quetzalcohuatl, dans
ses symboles pacifiques occasionnèrent des guerres civiles et
religieuses, qui, dans l’Anahuac, contribuèrent puissamment à la ruine de l’empire tollé que an
XIe siècle. Voir mon
Histoire des nations civilisées du Mexique, etc., torn. 1 et 11,
passim. Les mêmes causes produisirent probablement les mêmes effets au Pérou, et aidèrent les Incas dans la reforme politique et religieuse dont ils firent la base de leur monarchie.
-
(1) Zarate,
Hist, del descub. y con-quista del Peru, lib. 1, cap. 13.
-
(2) Herrera,
Hist, gen., decad. v, lib. in, cap. 6.
-
(3) Garcilaso,
Coment. Real., 1. ill, cap. 14.
Dans les premiers temps de la monarchie qquichua, l’ordre de la succession au trône aurait conservé les traditions des Nahuas ; après la mort du souverain c’était son frère qui lui succédait, et ce n’était qu’à la suite de son oncle qu’il était donné à l’héritier du premier de saisir le sceptre (4). Les choses changèrent sans doute avec l’affermissement de la nouvelle dynastie : mais on lui trouvait encore, même au
XIIIe siècle, des traces frappantes des institutions toltèques. Dans plusieurs nations voisines elles conservèrent une vigueur plus grande encore : c’est ainsi que chez les
Chancas, peuple puissant au nord des Qquichuas (5), la royauté se composait encore de trois souverains confédérés,
Huanca-Huallu, Tumai-Huaraca et
Aztu-Huaraca, dont le premier
préféra alors l’exil à la domination des Incas.
-
(4) Zarate,
Hist, del descub.., etc.,
ut sup.
-
(5) Les
Chancas, nation puissante, dont les dernières provinces étaient situées à 40 lieues environ au nord du Cuzco, et dont faisait partie celle
d’Antahuaylla. Ils se vantaient d’avoir conquis autrefois une portion fort considérable de l’Amérique, et se gouvernaient en trois royaumes, suivant la constitution toltèque. Ils
menacèrent, jusqu’au temps de l’Inca Viracocha, la puissance des Incas, et leur dernier roi Huanca-Huallu s’exila avec huit mille de ses partisans dans l’intérieur du continent, plutôt que de recevoir le joug de l’étranger et de changer ses coutumes (Garcilaso,
Coment. Real., lib. iv, cap. 15, 23 et 24, et lib. v,cap. 26). Les
Qquichuas avaient été autrefois soumis aux
Chancas; sous ce nom on comprenait les provinces dites de
Cotanera, Cotapampa et
Aymaraes. L’opinion de M. Angrand est que les Incas, fondateurs de la dernière dynastie du Pérou, étaient originaires de ces provinces qui sont au nord du Cuzco.
Avant cette époque, toutefois, l’histoire fait connaître encore diverses migrations qui ont besoin d’être relatées ici : les peuples qui en faisaient partie arrivèrent au Pérou, en traversant les Andes, comme la plupart de ceux qui les avaient précédés. Ils se livraient, dit la tradition (1), à la sodomie et à toute sorte de vices et mangeaient de la chair humaine. A ce caractère, exagéré d’ordinaire, cependant, par des relations ennemies, on ne saurait méconnaître leur origine : de près ou de loin, ces hordes devaient appartenir à la race nahuatl. L’époque de leur arrivée paraît coïncider avec le
ixe siècle : dans le même temps apparurent d’au-très nations, non moins barbares dans leurs coutumes, venant du port de
Buena-Esperanza (2) : elles traversèrent l’isthme de Panama et s’établirent sur les côtes voisines de l’Equateur, où elles fondèrent plusieurs villes. On leur donna, entre autres noms, ceux de
Colima, de
Paceha et
de Pirao ou
Puruhua (3), et sous ce dernier, il exista un Etat puissant qui se confondit, un siècle environ avant la conquête, avec celui de Quito. Les Puruhuas avaient parmi leurs divinités le dieu dont le temple, édifié
à Liribamba, leur capitale, était journellement ensanglanté par l'immolation des victimes humaines (1). Avant l’arrivée des Puruhuas, toute cette côte, depuis la pointe de Santa-Elena jusqu’à la baie de Manta, avait été occupée par des tribus qui y avaient succédé aux Géants du peuple de
Chimu (2) : mais vers la même époque que les Puruhuas, d’autres nations, également arrivées par mer, s’étaient établies entre Manta et le cap San-Francisco, et de leur chef
Caran, avaient nommé leur capitale
Carangui ou
Caraccas (3).
Ces étrangers avaient, ainsi qu’un grand nombre de tribus de la race nahuatl, l’usage de comprimer et d’allonger la tête des enfants : leurs nombreuses familles se confondirent ensuite avec les autres populations, au loin même dans l’intérieur, et leur communiquèrent leur nom générique de
Cara ou Vaillants, qui leur resta; mais leurs chefs, peu satisfaits du séjour de Carangui, remontèrent au nord jusqu’à Atacamès, et dans l’espace d’un siècle ou deux s’emparèrent de tout le pays qu’arrose le fleuve Esmeraldas. A la suite de cette conquête, ils portèrent leurs armes dans le royaume de
Quitu (4), qu’ils achevèrent de soumettre à leur domination, vers la fin du xe siècle : ce qu’il y a de remarquable à observer à ce sujet, c’est que les Garas, malgré l’origine caraïbe ou nahua
à laquelle ils paraissent appartenir, aient introduit dans le royaume de Quito, qu’ils gouvernèrent sous le titre de
Scyri,
la langue et la religion des Qquichuas (5).
(1) Montesinos,
Mémoires, etc., pag. 122.
(2) Id.,
ibid. L’auteur ne dit pas quel est ce lieu de
Buena-Esperanza,
d’où venaient ces tribus; il y avait un port de ce nom près de
Colima, au
( Mexique, et il y a lieu de croire qu’ils
ן
venaient de là; le nom de
Colimas, que Veiasco donne à l’une de ces tribus, nous y autorise
suffisamment. Les Colimas paraissent avoir colonisé également le
Rio Calima,
qui descend des montagnes voisines de
Cali, dans la Nouvelle-Grenade, au 4° nord, sur
l'Océan Pacifique, et l’on sait que des populations vaillantes et nombreuses du nom de
Colimas habitaient aussi dans le voisinage de
Hunza,
an 5° degré nord, dans les vallées voisines du
Rio Magdalena (Velasco,
Histoire du royaume de Quito, liv. 1, § 1. — Herrera, Zfùi.
gen., decad. νιπ,Ι.ιν, cap. 6, 7, 58).
(3) Montesinos,
Mémoires, etc., pag. 120 et 121. Cet écrivain les appelle
Piraos, mais, en le comparant avec Velasco, on voit que ce sont les memes
que les Puruhuas; nous ignorons quelle était leur langue.
-
(1) Velasco,
Histoire du royaume de Quito, liv. 1, § 8, n. 2, et liv. n, § 4, ii. 4.
-
(2) Les tribus qui occupèrent cette côte prenaient leurs noms des villes
d’Apichiqui, de
Cancebi, de
Chara-poto, de
Pichota, de
Picoaca, de
Pi-chunsi, de
Manavi, dp
Xarahusa, de
Xipixapa et
d’Yzapil (Velasco,
ibid.,
liv. i, § 1, n. 7). Plusieurs de ces noms rappellent des noms mexicains ou de ]’Amérique centrale. Il y avait une tribu principale parmi les Mams du
Guatemala qui portait le nom de
Cancebi.
(3) Velasco,
ibid., liv. 1, § 1,
passim. — Les Indiens d’ica et ceux d’Arien disaient qu’anciennement ils avaient coutume de naviguer à des îles situées au couchant et fort éloignées, et que le voyage se faisait avec des radeaux soutenus sur des cuirs de loup marin gonflés d’air (Garcia,
Origen de los Indios, lib. 1, cap. 4, § 1, pag. 35).
-
(4) Id.,
ibid. On ignore dans quelle condition étaient les
Quitus et la langue qu’ils parlaient avant leur conquête par les
Caras; l’inspection de quelques ruines qui paraissent antérieures à la période des Scyris atteste une civilisation déjà puissante, et celle des Garas n’était pas inférieure à celle des Incas, qu’elle surpassait en bien des branches d’art et d’industrie.
(5) Velasco,
Histoire du royaume de Quito,\\v.\\, § 8, n. 7. M. Angrand, dont l’opinion est ici d’un grand poids, croit que les
Caras ou Scyris s’étaient trouvés en contact avec les
Qquichuas dans les provinces voisines du Cuzco, ou peut-être étaient-ils issus d’un mélange de Caras ou Nahuas avec les Qquichuas. Quant aux Incas, après avoir fait la conquête de Quito, ils poussèrent leurs armes plus au nord jusqu’à la province des
Quillacencas,
c’est-à-dire des
Nez de métal ou
Nez-Perces: Garcilaso (lib. vin, cap. 3) dit que le nom de
Quillacenca veut dire
((Nez de fer, parce que ces peuples mettaient à leurs nez des anneaux d’or, d’argent ou de cuivre. I On devrait plutôt supposer qu’ils s’appelaient
Nez - Percés , Nez-Cicatrisés , parce qu’ils se perçaient en effet le nez pour y passer des anneaux...
{Note de M.L. Angrand dans
Pérou avant la conquête espagnole, par
M. Ernest Dus-jardins; Paris, 1808,pag. 80.) Plusieurs populations de la côte voisine portaient également des joyaux au cartilage du nez, ainsi que le faisaient les Nahuas, Toltèques, Mexicains et Guatémaliens.
Tant d’invasions diverses devaient avoir pour conséquence de mélanger singulièrement les populations, et dans un tel chaos ce ne saurait être une chose aisée de reconnaître la souche originale de la plupart d’entre elles. On sait encore qu’à l’époque où les régions méridionales, comprises sous le nom de
Callao,
se virent envahies par des tribus qui massacrèrent les hommes barbus de
Tiahuanaco, un grand nombre des habitants de ces contrées, ainsi que des montagnes plus orientales du Cuntisuyu, se réfugièrent dans les plaines d’Aréquipa, dont le climat les avait éloignés jusqu’alors : là ils se confondirent probablement avec les races des Chimus, que leurs traditions faisaient également descendre des Andes, ainsi qu’on l’a vu plus haut. Les habitants de
Lambayèque (Llampallec), désignés aussi sous le nom de
Yuncas, qui est commun à toutes les
nations des plaines de terre chaude, surtout du côté du Pacifique, racontaient à leur tour que leurs ancêtres étaient venus, à une époque reculée (1), d’un pays plus septentrional, montés sur une grande flotte de radeaux (2). La tradition montre leur chef Naymlap, débarquant à l’embouchure de la rivière Faquizllanca (3), accompagné d’une suite brillante de femmes et d’officiers de tout rang : ils occupèrent les territoires de
Montupey, de
Lallanca, de
Callanca et de
Collique,
dans la vallée de Llampallec, ainsi nommés de leur idole principale, à laquelle ils bâtirent un temple qu’ils appelaient
Chot (1). Après un long règne, Naymlap aurait été enlevé au ciel, et plusieurs de ses compagnons , affligés de sa disparition, se rembarquèrent, abandonnant femmes et enfants, pour courir à sa recherche.
Cium, fils de Naymlap, régna après son père, et de ce prince descendit une longue série de rois qui, dans la suite, furent soumis au Grand-Chimu, et plus tard aux Incas. Dans les recherches que nous avons faites pour découvrir à quelle race ceux de Llambayèque pouvaient appartenir, nous avons cru trouver de l’analogie entre leur langue et celle des
Araucans
du Chili, d’un côté, et de l’autre avec celle des
Wabi, habitants des
lagunes de Tehuantepec (2). Ceux-ci, du reste, racontaient que leurs pères étaient venus de la mer du Sud, également montés sur des barques ou radeaux, en côtoyant le rivage. Suivant Burgoa (3), la langue des Wabi
ne différerait guère non plus de celle des Nagarandas de Nicaragua.
(1)
Balboa,
Histoire du Pérou, pag. 87,89 et suiv.
Llampallec, aujourd’hui
Lambayeque. En calculant la moyenne du règne des rois de Llampallec à 30 ans, et en prenant une centaine d’années pour l’anarchie que l’auteur appelle
république, on trouve, pour le commencement de cette nation, environ la fin du
ixe siècle.
(2)
Balza, radeau de cannes attachées sur des courges ou
autrement; ces balzas sont fort légères, et peuvent porter un grand poids; on s’en sert encore aujourd’hui au passage de
certaines rivières et pour naviguer sur les côtes.
(3; M. Ternaux (Balboa,
Hist, du Pérou, pag. 90) dit, dans une note, qu’il possède une grammaire de la langue
yunga (une des langues
yuncas, comme dit fort bien M. Angrand) de Lambayequel composée par Fernando de la Carrera, et imprimée à Lima, en 1644, in-12. Il dit que
celte langue yunga est parlée par plus de 40,000 Indiens, dans les
corregimientos de
Piura, Truxillo, Zaña et
Caxamarca,
ainsi que dans quelques districts des montagnes, où les Incas avaient
transporté une partie de la population. Le nom de
Cuelap, dont les ruines importantes encore existent dans le district de Santo-Tomas (Rivero et Tschudi,
Antiq. Péruv., ibid, ut sup., pag. 454), indique une origine de la même langue.
(1) L’épouse du roi s’appelait
Ceterni; ses principaux officiers étaient
Pitazofi , Ninacolla , Nimagentue , Fongasigde, Ochocalo, Xam, Ollop-Copoc, Llapchilulli. Les successeurs de
Naymlap furent
Cium, Ezcuñain, Mascuy, Cunti-pallec , Allascunti, Nofanech, Mulu-Muslan, Llamecoll, Lanipatcum ,
Acunta
et
Tempellec.
Ensuite se passe un temps indéterminé, après lequel gouvernèrent,
Pongmassa, Pallomassa, et
Oxa ; puis, sons les Incas,
Llempisan, Chullumpisan, Cipromarca,
Fellempisan, Efquempisan et
Tecfunpisan,
qui régnait, quand vinrent les Espagnols (Balboa,
Histoire du Pérou, pag. 93 et sniv.). L’idole placée an temple de Chot s’appelait
Llampallec : elle était faite d’une pierre brillante de couleur verte.
(2) Voir mon article sur les
Wabi de Tehuantepec dans la
Revue orientale et américaine, torn, v, pag. 261, janvier 1861. M. Hyacinthe de Charencey, qui a écrit plusieurs notices intéressantes de philologie comparative, croit avoir trouvé des analogies égale-nient entre ces diverses langues.
(3) Burgoa,
Geographica description historia de la provincia de Guaxaca,
cap. 72, fol. 367.
Les invasions étrangères qui, du nord, descendirent si souvent dans les temps anciens sur l’Amérique méridionale, paraissent avoir diminué graduellement avec le cours des siècles. Cependant, elles n’avaient pas entièrement cessé à l’époque de la conquête espagnole : car deux ans seulement avant l’entrée de Balboa dans la province de Paris, au Darien, ce territoire avait été envahi soudainement par une horde considérable d’anthropophages à la haute stature, sortis, à ce qu’il paraît, des régions voisines de Nicaragua (1). Ainsi, à dater des temps les plus anciens, c’est toujours du nord au sud qu’on peut observer ces grands mouvements de peuples dont l’Amérique fut le théâtre : c’est dans cette direction que roule à l’intérieur du continent ce vaste torrent de migrations, refoulant devant lui, à droite et à gauche, les populations qui les y avaient précédées. C’est alors aussi que celles-ci, se rapprochant des plaines, affrontaient les dangers de la terre chaude, dans l’espoir d’y trouver un abri contre la tempête, ou s’exposaient sur les flots de
l'Océan, retournant à leur tour vers le nord, d’où leurs pères étaient partis dans l’origine. Dans les traditions religieuses qui restent à examiner, nous verrons que les notions les plus anciennes du culte et des institutions politiques se rapportent également au berceau commun signalé par le
Livre Sacré.
(1) Herrera,
Hist, gen., decad. 1v, lib. i, cap. 11.
Paris était le nom du chef de
Cutaturà, ou celui-ci le nom du chef de
Paris; ils sont alternativement confondus.
Au Pérou et dans les contrées adjacentes, ainsi que dans
l'Amérique centrale, l’idée de
l'Être suprême se confond d’ordinaire avec celle du tonnerre, qui renferme, comme Hurakan, la trinité redoutable des voix qui mugissent dans la tempête, exprimée chez les Qquichuas et au royaume de Quito, par le mot
Illapa, trinité invisible du tonnerre, de l’éclair et de la foudre, à qui même on avait dédié des. temples (2). Seulement, sous la dynastie inca,
ces trois, au lieu d’avoir le premier rang, ne sont que les serviteurs de la divinité du soleil (1) : car au Pérou, la religion dominante, après avoir renversé les autels sanglants des Nahuas, était redevenue astronomique. Par une politique dont on ne peut assez admirer l’énergie et la persévérance, les rois de cette dynastie, confondant à dessein toutes les notions de
l'histoire et de la religion, antérieures à leur avènement, sous le nom méprisant d’antiquité barbare (2), avaient ramené le culte et la société, dont ils étaient les rénovateurs, uniquement au soleil et à son fils
Manco-Capac, dont ils prétendaient descendre en ligne directe. Cependant, malgré leurs efforts pour anéantir tout ce qui les avait précédés, on en retrouve partout les traces dans les traditions, dans les monuments, dans les noms des lieux les plus célèbres, jusque dans la personne d’un des Incas les plus puissants,
Viracocha,
Après avoir rapporté l’histoire d’un déluge ou d’une inondation, dont les
circonstances varient suivant les localités, on dit que le monde était déjà depuis longtemps habité par des hommes, quoique le soleil ni les autres astres n’existassent pas encore : alors apparut, sortant du lac de Titicaca, un personnage blanc de visage, barbu et couvert de longs vêtements flottants, auquel toutes les traditions s’accordent à donner le nom de Viracocha (3). Ce personnage s’étant arrêté au lieu où existent encore actuellement les ruines imposantes de Tiahuanaco, créa le soleil et lui commanda de se mettre en marche pour éclairer le monde, après quoi il créa la lune et les autres astres (4). Il est impossible de ne pas reconnaître, dans ce mythe, le langage symbolique du
Livre Sacré, comme des autres traditions d’origine nahuatl, langage employé constamment pour exprimer le temps où la nation, privée de la lumière véritable, n’avait pas encore vu lever le soleil de sa liberté, avec le système astronomique et les institutions que ce système représentait (1).
(2) Garcilaso,
Comentarios Reales,
lib. !,cap. 2.
Gel auteur ajoute: <׳. Tuvieron que residian en el ayré, mas no en el Cielo. » C’est encore l’idée du Tonnerre, de
l'Eclair et de la Foudre, contenus dans un seul
Hurakan,
le centre, le cœur du ciel, la tempête, le vent, lu souffle
(Ibid., 1. 11, cap. 23, et I. tu, cap. 21).
(1) Id.,
ibid.
Dans le système des Nahuas, le culte des éléments précède celui des
astres; dans celui des Incas, le culte du soleil et des astres reprend
sa place première.
(2) C’est constamment Vidée que présente Garcilaso
(Ibid., lib. 1, cap. 9 et suiv., passim).
(3) Herrera,
Hist. gen., decad. v, lib. in, cap. 6. — Garcia,
Origen de los Indios, lib. v, cap. 3. — Balboa,
Histoire du Pérou, pag. 40. — Garci-laso,
Comentarios Reales, lib. v, cap. 21 et passim.
(4ו
Id.,
ibid.
On a longuement discuté sur la valeur du nom de Viracocha ; mais il a été d’autant plus difficile d’en donner une explication satisfaisante, qu’il paraîtrait ne pas s’interpréter étymologiquement suivant les règles de la langue qquichua (2). Il est évident, toute-·fois, d’après les circonstances particulières qui environnent les personnages désignés sous ce nom, que l’idée mystérieuse qu’il renferme est identique avec celle que le
Livre Sacré attribue à Gucumatz ou Quetzalcohuatl. Viracocha, ainsi que
Quetzalcohuatl, est représenté comme un homme blanc et barbu, aux vêtements longs, prêchant une religion nouvelle, arrivant par mer, suivant les uns (3), sortant d’un lac, selon les au-très (4) ; c’est sous ce nom qu’on désigna les Espagnols, au moment de leur débarquement ; c’est celui que leur donna, par analogie, Atahualpa lui-même, à sa première entrevue avec eux, imitant ainsi, sans le savoir, Montézuma qui, prenant Cortès pour un descendant de Quetzalcohuatl, à son arrivée à Tabasco, lui envoya en présent les ornements de ce demi-dieu (5). Maintenant, si on l’envisage dans les autres titres qui précèdent le symbole principal, on le trouve confondu avec la divinité suprême sous celui d’Illa-Ticci-Viracocha, qu’un auteur traduit par l'Eclat, le fondement et l’abîme de toutes choses (6), d’autres par l'Éclat de la foudre, le Principe des choses et
l'Écume ou la graisse des eaux ou de la mer. Or, quelles que soient les altérations que le temps ou la politique des Incas ait fait subir à ce nom célèbre, il n’est pas moins vrai qu’au fond on y reconnaît les symboles mystérieux du
Livre Sacré sur le Formateur et le Créateur, si poétiquement exprimés par ces paroles : « Ils
sont sur l’eau comme une lumière grandissante ; ils sont enveloppés de vert et d’azur, voilà pourquoi leur nom est » Gucumatz (Quatzalcohuatl)..... Voilà pourquoi le ciel existe, » comment existe également le
Cœur du ciel...., dont le nom est » Hurakan (la voix qui gronde dans la tempête, le tonnerre
» Illapa}. »
-
(2) Les vocabulaires écrits après la conquête n’en donnent aucune étymologie qui soit bien d’accord avec la langue qquichua.
-
(3) Velasco,
Histoire du royaume de Quito, liv. in, § 7, n. 14. — Balboa,
Histoire du Pérou, pag. 40.
-
(4) Herrera,
Hist, gen., decad. v, lib. in, cap. 6. — Garcia,
Origen de los Indios,]ft). v, cap. 3, etc.
-
(5) Garcilaso,
Comentarios Reales,
lib. v, cap. 21 et passim. — Velasco,
Hist, du roy. de Quito,], in, § (J, n. 17.
-
(6) Montesinos,
Mémoires, etc., pag. 94. Voici l’étymologie qu’en donne cet auteur, elle vaut bien les autres : a Le roi voulut que le grand dieu Pirhua fût adoré par-dessus tous les autres; et, comme le mot
Pirhua avait changé de signification, il ordonna qu’on le nommât
lllatici-Huiracocha, ce qui veut dire l’éclat, l’abîme et le fondement de toutes choses, car
illa signifie éclat;
tici, fondement;
huira, corruption du mot
pirua, veut dire réunion de toutes choses, et
cocha signifie abîme. »
Ainsi, comme dans le
Livre Sacré, le nom de Viracocha ne s’applique pas à un seul mythe, à un seul individu. Viracocha, de même que Quetzalcohuatl, exprime l’idée d’une religion de mystère, le symbole du feu, de la majesté enveloppée, et que les prêtres s’appliquaient à eux-mêmes, comme le titre le plus auguste de leur pontificat. Dans l’Amérique centrale, les Créateurs et les Formateurs sont quatre : ils sont aussi quatre Gucumatz, représentés surtout dans
Tepeu, Celui d’en haut, le Dominateur, et
Gucumatz, le Puissant-Serpent, orné de plumes, le
Tupac-Amaru (serpent sacré) qu’adoraient également les populations antisiennes. Au Pérou, les quatre se reconnaissent dans les quatre personnages divins de
Manco-Capac, de
Colla, de
Tocay et de
Pinahua, à qui un être supérieur, un Viracocha a partagé le ' monde à la suite du déluge (1). Dans les mythes de
Pachacamac
et de
Pachacutec (2), on entrevoit le Créateur et le Formateur suprême, Celui qui engendre et Celui qui donne l’être
(Alom, Qaholom, dans là langue quichée) ; mais on ne saurait méconnaître dans
llla-Ticci et
Con-Ticci-Viracocho l’idée de Hurakan réuni à Gucumatz pour créer l’univers.
(1) Garcilaso,
Comentarios Reales,
lib. i, cap. 18. Il est à remarquer que
Tocay appartient à un dialecte de la langue quichée: c’est
l'Oiseau-Mouche; et
Pinahua appartient au nahuatl, et signifie Celui qui rougit, qui est honteux; il correspond à
l'ahqixb quiché. Velasco
(Histoire du royaume de Quito,
lib. ni, § 7, n. 14)
ajoute que le nom de
Viracocha était porté par le frère de Manco-Capac, fondateur de l’empire.
’ (2) Garcilaso dit très-bien que
Ticci-Vira-Cocha est le même que
Pachacamac, le créateur de toutes choses, le Très-Puissant (Poderosisimo), autre nom de
Gucumatz, qui est aussi l’un des deux ou des quatre créateurs·
Pacha-cutec signifie qui change
le monde.
Quiconque se donnera la peine d’étudier tant soit peu les étymologies savantes de la langue nahuatl, dont M. Aubin s’est fait l'interprète (1), reconnaîtra aisément une origine nahuatl au monosyllabe initial du second de ces deux noms ; nous ajouterons qu’il renferme, d’ailleurs, une allusion aux symboles les plus profonds de la religion antique (2). C’est, avec Viracocha et
Pachacamac, le nom le plus connu entre ceux des divinités antérieures à la dynastie des Incas, dans les histoires péruviennes, et il entre dans la composition d’une foule de noms de localités, tant au Chili et en Bolivie, qu’au Pérou, sans compter un grand nombre de villes situées dans l’autre partie de
l'hémisphère (3). Con, première et suprême puissance, dit Velasco, qui n’avait ni chair ni os, de même que les autres hommes, qui avait créé le monde et qu’on croyait venu du septentrion, abaissant les montagnes et soulevant les vallées par sa seule volonté. Dans la description, que cet auteur nous a· laissée du temple de cette divinité à
Liribamba, capitale des
Puruhuas, au sud du royaume de Quito, on retrouve tout le caractère des mythes religieux de la race nahuatl. « C’était une idole d’argile qui représentait seulement la
ע
tête d’un homme. Elle avait la forme d une
marmite (1) : la » bouche et les lèvres étaient sur le sommet de la tête, et c’est » par là qu’on versait le sang des sacrifices, dont on frottait » aussi la face de l’idole, qui représentait le Dieu de la guerre ou » de la vengeance. On lui immolait les prisonniers qu’on avait » faits à la guerre. »
(1) Mémoire sur la peinture didactique et l’écriture figurative des anciens Mexicains.
(2) Ce mot ne parait avoir aucun· sens dans la langue
qquichua.
Co, con,
radical de
comitl, vase, marmite, chaudron, dans la langue nahuatl. Dans l’ancien langage symbolique du Mexique, ce nom fait allusion à des mythes religieux d’une haute antiquité. Un fragment tronqué d’un très-ancien chant chichimèque y fait allusion, dans le
Codex Chimalpopoca, signalant à plusieurs reprises le
huey-comitl, mot à mot grand vase ou marmite, dont le sens mystérieux est encore à découvrir. Peut-être s’agit-il de l’union fécondante de la race nahuatl, figurée par
Mixcohua-Xocoyotl, et la race antique colhua-chichimèque, représentée par
ItzpapaUdl (le Hunhun-Abpu du
Livre Sacré et la femme
Xquiq). Serait-ce là l’origine des institutions dont parle M. Aubin, à propos des conjectures hasardées sur les inscriptions calculiformes.
« Ces conjectures, » dit-il, recevraient un haut degré » d’intérêt et de
vraisemblance de ce » qu’on pourrait ajouter sur Quetzalcohuatl, introducteur des arts graphiques au Mexique et adoré depuis
יי
la Californie jusqu’au Pérou; sur » les institutions phalliques, commit» nés au Mexique et à la Colombie, » d’après le
Codex Mexicanus du Palais-Bourbon,
יי
etc.
Mémoire sur la peinture didactique, etc.). Dans la langue quichée,
cun exprime l’idée du vase
pudendum muliebre, et aussi celle de la médecine.
Comitl, ajoute M. Aubin, est aussi la petite bisnaga à
chiles rouges acidulés, comestibles, appelés
chrlchotl ; le
huey-comitl est la grande bisnaga,
boule végétale, énorme , dont on fait des conserves.
(3) M. d’Orbigny et Castelnau citent plusieurs villes dont le nom commence par ce mot dans l’Amérique rnéridio-nale. Ce dernier dit avoir visité les ruines d’une ville antique considérable, du nom de
Concon, à 4 lieues de Lima (Forage
dans l’Amérique méridionale, etc., torn, iv, pag. 188). A la même divinité paraissent faire allusion les noms de plusieurs villes connues au Mexique et dans l’Amérique centrale. Telles sont :
Tetzcoco,
l'Athènes de l’Anahuac, dont l’étymologie serait
tetz-con-co, dans le vase brillant ou émaillé (Aubin,
Mémoire, etc., pag. 102);
Comitlan, Auprès du vase ou de la marmite, ville près de laquelle il y a de grandes et belles ruines, dans l’Etat de Chiapas;
Copan,*Sur le vase ou sur la .marmite, célèbre par ses magnifiques débris, aux frontières de Guatémala et de Honduras. A l’ouest du Cuzco, ancienne capitale du Pérou, était une petite province, appelée
Cun-ti, d’où vint le nom générigue de
Cunti-Suyu (ou
Conti-Suyu, ainsi que l’écrit aussi Garcilaso), indiquant la région de l’ouest. Le nom de Cuzco, mieux Cozco, pourrait bien avoir la même origine ; il n’appartient pas au qquichua, dit Garcilaso
(Comentarios Reales, lib. π, cap. 11), mais à la
langue particulière des Incas, oubliée entièrement, dans laquelle on sait
cependant que Cozco avait le sens d’ombilic. Or, cette langue sacrée pourrait bien avoir eu un grand rapport avec le
nahuatl, dans lequel on retrouve l’étymologie de ce mot, qu’on écrirait parfaitement, d’après le système
développé par M. Aubin, avec le signe co redoublé, et la ligature ou consonne
z, exprimée par le poinçon
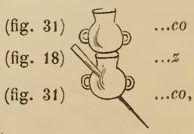
c’est-à-dire dans le vase ou la marmite (Aubin,
Mémoire, etc., pag. 39 et 56. Voir aussi le même dans la
Revue américaine et orientale, torn, iv, pag. 39, 41 et 276).
(1) Velasco,
Histoire du royaume de Quito, liv. n, S 2, n. 4, et § 4, n. 4.
Pachacamac, au dire des uns, était fils de Con ; suivant les autres, il se serait manifesté seulement au moment où celui-ci disparut . Ce qui est certain, c’est que le culte de Pachacamac
continua, malgré les efforts des Incas pour le remplacer par celui du soleil, à garder la suprématie, surtout dans les contrées baignées par
l'Océan Pacifique. Son temple, bâti par la race antique des Chimus, dans la vallée de Lurin, était un des plus anciens de l’Amérique et le plus vénéré de tout le Pérou : à l’instar de ceux de Palenqué et d’Izamal, il était construit sur une éminence artificielle (1), où Von montait par une multitude de degrés. Son enceinte réunissait un grand nombre d’édifices, destinés à divers usages, entre autres un vaste hospice pour les pèlerins et une université où s’enseignaient toutes les sciences ; aussi la cité de Pachacamac passait-elle pour l’Athènes de l’Amérique méridionale, et le collège de ses
Cushipatas ou prêtres était regardé comme la plus savante des corporations religieuses du Pérou. Quant au dieu Con, après qu’il eut doté le pays des institutions dont il était le fondateur, il se retira vers l’ouest, remonta au nord jusque chez les Suyos, dans la province de Manta (Puerto-Viejo), et là, ayant étendu son manteau sur la mer, disparut pour ne plus se montrer (2).
Si, des traditions relatives à cette divinité redoutable, nous passons à celles qui concernent les créations diverses, rapportées dans le
Livre Sacré, nous les reconnaîtrons également au Pérou, où les hommes, alternativement tirés des eaux, des cavernes ou des rochers, sont détruits, changés en chats, ou ruinés par le feu du ciel, que Con ou Viracocha, mécontent d’eux, fait descendre sur leurs têtes : mais il est évident, comme l’observent fort bien Gomara et Velasco (3), que toutes ces traditions furent à dessein altérées et modifiées par la politique des Incas. Un de ces récits, expliquant l’origine des classes diverses de l’antique société péruvienne, disait qu’il était tombé du ciel trois œufs, l’un d’or, le second d’argent et le troisième de cuivre : du premier sortirent les
Caracas ou chefs souverains ; du deuxième les nobles ordinaires et du dernier la masse du peuple (4). Calancha, d’accord avec plusieurs autres, ajoutait (5) que le personnage merveilleux qui avait créé les quatre premiers hommes de la légende citée plus haut, lés avait fait sortir d’une caverne auprès de
Pacaric-Tambo, que les auteurs traduisent généralement par la
Maison de Production. On ne saurait méconnaître ici le
Pan-Paxil du
Livre Sacré, et le
Tonacatepetl des traditions
mexicaines : à ces origines il faut joindre une foule de. variantes, nées sans doute des notions diverses que les populations avaient reçues du mythe primitif, dont le berceau était trop éloigné, pour qu’elles eussent pu se conserver pures de tout mélange ou des superfétations qquichuas.
(1) Velasco,
Histoire du royaume de Quito, liv. n, § 2, n. 5.
(2) Garcia,
Origen de los Indios, lib. v, cap. 3. — Gomara,
Hist. gen. cap. 122. — Velasco,
Hist, du roy. de Quito, liv. 11, § 2, n. 3. —- Acosta,
Hist. nat. y mor. lib. V, cap. 3. — Herrera,
Hist. gen. decad. v, lib. in, cap. 6.
(3) Hist. gen. cap. 122.
(4) Avendano,
Sermones ,en lengua qquichua, Lima, 1649, serm. 9, pag. 100.
(5) Cronica de la Orden de San Agus· , tinenelPéru,Xdû.ï\,c3^. 19.— Garci-laso,
Comm. Heal. lib. 1, cap. 15.— Acosta,
Bist, natur, y mor., lib. 1. cap. 25.— Herrera,
Hist. gen. decad. v, lib. m,cap. 7. Celui-ci, ainsi que Garcia, d’après Acosta qui eut les MS. de Betanços, dit que
Pacdric-Tampu
signifie Maison de la substance ou de la production,
casa de mantenimiento ô de production; c’est exactement le sens que donne le mot
tonacatepetl,
nom do pays d'abondance que les dieux des Nahuas trouvèrent après l’inondation et que le livre sacré appelle
Pan
Paxil pa Cayala (voir p.
lxxxiii).
Pacaric, dit M. Angrand, donne le sens de principe, d’origine, de
commencement, ce qui n’exclut pas le sens antique donné par Herrera et Garcia.
Pacaric-Tampu. devint une ville; elle était située à sept ou huit lieues au sud du Cuzco ; c’était la même que
Tambotoco , dont il est parlé dans Montesinos et qui aurait été probablement une. des plus anciennes capitales du Pérou et peut-être le
berceau de la famille des Incas.
Aux quatre chefs qu’il avait créés, Viracocha donna autant de femmes et leur partagea l’empire du monde. Les auteurs ne sont pas également d’accord sur leurs noms ; on les trouve appelés le plus souvent
Ayar-Manco-Topa, Ayar-Cachi-Topa, Ayar-Auca-Topa et
Ayar-Uchu-Topa (1). Le. premier ayant gravi la montagne de Huanacauti, lança de la cime, avec une fronde qu’il portait roulée autour de sa tête, quatre pierres aux quatre points cardinaux, annonçant ainsi qu’il prenait possession du monde (2). Suivant une autre ·tradition, laquelle rappelle exactement celle de Zipacna, dans le
Livre Sacré, il se servait de sa fronde pour ébranler les montagnes et s'amusait à les entasser l’une sur l’autre jusqu’au ciel. Sous le prétexte d’un sacrifice à Illa-Ticci-Viracocha, ses deux plus jeunes frères l’engagent à entrer dans une caverne dont ils bouchent ensuite l’ouverture : les cris poussés par ce malheureux font trembler le ciel et la terre, et bientôt après, le second, par un châtiment céleste, diversement raconté, sent ses pieds s’attacher au sol où il est changé en rocher (1). Qui ne reconnaîtrait, en effet, dans ces traditions, les notions altérées de l’histoire de Zipacna et de
Cabrakan, dont l’orgueil et la témérité sont punies exactement de la même manière, à la voix de Hurakan, par les deux
frères Hun-Ahpu et Xbalanqué (2) ? Si l’on peut s’en rapporter aux histoires péruviennes, ces mythes seraient des plus anciens de cette contrée, et la source où ils auraient pris naissance seraient les îles du lac de Titicaca ; ils y auraient été apportés par des hommes blancs et barbus, Viracocha, qui s’y substituèrent peut-être à d’autres hommes blancs plus anciens qu’eux, Xibalbaïdes pu Vitznahuas, à une époque rapprochée du commencement de l’ère chrétienne. Des invasions successives où l’on discerne toujours les traits distinctifs de la race nahuatl, au nom de
Car ou de
Cara, dans les régions
méridionales du Pérou, auraient tour à tour modifié ces institutions, jusqu’au moment où, anéanties par des convulsions
intérieures, elles auraient, dans le cours du XIIe siècle, cédé au prosélytisme armé des chefs de la monarchie Qquichua, qui se présentèrent comme les rénovateurs des lois antiques.
(1) Montesinos,
Mémoires, etc.■pag. 3. Le nom de
Topa donné aux quatre frères es! fort remarquable. Dans la langue qquichua il a le sens de roi ou prince.
Tupa (pron.
toupa), chez un grand nombre de tribus de diverses races, signifie sacré, divin;
tupan est Dieu, surtout chez les nations
brésiliennes, guaranies et paraguaies; il exprime l’idée divine dans le tonnerre et la foudre comme le Hurakan de l’Amérique centrale; qu’on le
rapproche de
tabu ou
tabou, et voilà un
enchainement avec les nations polynésiennes, où tout ce qui est
tabou est sacré. Au Chili, chez les Arancans,
Toqui est le chef du monde invisible, appelé aussi
Pillan, la Foudre.
(2) C’est à peu près de cette manière que le prince chichimèque Nopaltzin prend possession de la vallée de l’Anahuac au
xiie siècle. Voir Veytia,
Hist, antigua de Mexico, tom.
11,
cap. 2, et aussi mon
Histoire des nations civilisées du Mexique et de VA-mériqué centrale, tom. n, pag. 227.
(1) Montesinos,
Mémoires, etc., pag. 4 et suivantes. — Balboa,
Hist, du
Pérou, pag. 4 et sniv.
— Herrera,
Hist. gen. decad.
v, lib. 111, cap. 7.
(2) Voir le
Livre Sacré. Dag. 45, 59
et 67.
Aussi, dans les histoires écrites par les Incas ou par leurs
partisans, cette antiquité civilisée, si supérieure à la société péruvienne de l’époque de la conquête et vivante encore, en partie, dans les principautés des Yuncas qui occupaient les bords de
l'Océan Pacifique, est-elle rejetée généralement dans le chaos d’une barbarie abrutissante. Cependant les traces de cette période mystérieuse se retrouvent encore en une foule de lieux ; on les
signale surtout, en remontant vers le nord. A côté du culte du Soleil, que les Incas se virent eux-mêmes dans la nécessité de subordonner à celui de Pachacamac, afin de rendre leur
gouvernement supportable aux Chimus, on voit surgir, dans les contrées septentrionales, soit maritimes, soit antisiennes, une multitude d’idoles et d’attributs divers, dont les autels, réputés impurs au commencement, finirent néanmoins par être tolérés et encensés même par les Fils du Soleil (1). Ce revirement paraît avoir pris naissance avec un Inca, exilé dans sa jeunesse par son père
Yahuar-Huacac, à cause de ses désordres et de son insubordination : il assura qu’étant occupé à garder les troupeaux du soleil, l’antique
Viracocha lui était apparu et lui avait annoncé les malheurs qui menaçaient l’empire. C’est de cette vision que le jeune
Inca prit le nom de Viracocha, qu’il illustra bientôt après, en se mettant à la tête des armées royales et en battant les
Chancas qui s’étaient avancés jusqu’aux portes même du Cuzco. Le premier il rétablit le culte de cette divinité et lui éleva un temple avec
une statue dans la ville de
Con-Cacha (le Messager de Con), à quelques lieues de la capitale. Il y a tout lieu de croire d’après ce détail qu’un sentiment de gratitude l’anima dans cette
occasion pour les services que lui auraient rendus les prêtres aymaras ou les sectaires cachés de l’ancienne religion (2).
(1) Garcilaso et Balboa représentent cet esprit des Incas. Le premier
cherche constamment à les défendre, surtout, de l’idolâtrie commune à tous les Indiens, mais que, dans les
commencements de leur monarchie, les Incas paraissent avoir travaillé à
extirper ou à amoindrir.
(2) Garcilaso,
Coment. Real. lib. 11
j,
cap. 21. Il est bien possible que
l’Inca Viracocha eut, durant sou exil, des entretiens avec les sectateurs du culte antique supplanté par ses ancêtres, et sa prétendue vision où il dit avoir vu le
dieu Viracocha était sans doute un prétexte pour autoriser les modifications qu’il introduisit dans la religion de sa
famille. La révolte des Chancas et la facilité avec laquelle l’Inca Viracocha trouva de l’aide autour de lui pour
repousser l’invasion, semblent dénoter une alliance secrète avec les partisans du culte déchu, dont il releva en partie les autels, après avoir détrôné son propre père.
Si l’on continue à chercher entre les cérémonies religieuses et les rites des Péruviens, on n’y découvre pas moins de traces des institutions toltèques. Nous avons parlé plus haut du temple de Con à Liribamba el de la forme du gouvernement des Chancas.
A Quito, on voyait également des autels dédiés à Con-Ticci-Viraco-cha, à côté de ceux du Soleil et de la Lune. Là, aussi bien qu’au Cuzco, il existait pour les enfants une espèce de baptême ou d’ablution, lavant la souillure originelle, comme le baptême administré à Mexico, au nom de Chalchiuhlicué ou la déesse des eaux. En outre de cette sorte de sacrement venait une confession des péchés, suivie d’une communion de pain et de vin
{chicha), consacrés par le grand prêtre, et à laquelle tous les étrangers même participaient. Ainsi qu’au Mexique, le pain consacré était pétri avec du sang humain, et, bien que Garcilaso assure que ce sang était uniquement celui que les princes et les prêtres se tiraient volontairement, en esprit de pénitence, de certaines parties du corps, il n’en présente pas moins un site entièrement d’accord avec celui dont il est si souvent question dans le
Livre Sacré. Ce rite, qui se pratiquait chez un grand nombre de nations du nouveau et de l’ancien monde, avait évidemment pour objet, au Pérou, ainsi qu’au Mexique, une expiation mystérieuse, où le sang de l’homme, rendu sacré par son immolation, était seul jugé capable d’apaiser la divinité. Des sacrifices et des festins du même genre avaient lieu dans une foule de circonstances : quelquefois,
cependant, le sang des Hamas remplaçait celui de l’homme, notamment aux époques solennelles, où l’Inca recevait dans son ordre les nouveaux chevaliers, après qu’ils avaient subi, ainsi que dans
l’Anahuac, les rudes épreuves de l’initiation (1).
A l’occasion des personnages merveilleux qui, comme
Viracocha, travaillèrent à fonder ou à purifier les autels de l’ancien Pérou,
Gomara rapporte (2) que celui qu’il appelle
Con et
Sahagun
était descendu des contrées situées au nord, en opérant les prodiges dont il est question ailleurs à propos de ce prophète. Ce nom, présenté de cette manière, devient une transition naturelle entre le royaume de Quito, où sans doute il avait apparu d’abord, et le
Cundinamarca (1) ; car il y a tout lieu de supposer que ce n’est là qu’une corruption du nom de
Suha-Con (l’homme blanc
Con),
Suha ou
Suhé étant l’un des titres de
Bochica, l’un des héros mythiques du plateau de
Bogota (2), où on l’appelait aussi
Nemterequeteba, Il était représenté ayant une grande barbe et des cheveux fort longs, revêtu d’une tunique qui lui descendait à mi-jambes, avec un manteau noué par-dessus l’épaule. Sous la dénomination de
Suganmoxi (3) ou
Sugamoso, un autre personnage analogue, si ce n’est le même, apparaît, suivant d’autres traditions, plus de vingt cycles de soixante ans chacun avant l’époque de la conquête espagnole ; il venait de l’est, c’est-à-dire des grandes plaines arrosées par les confluents de l’Orénoque, tels que le
Guaviaré, le
Méta et
l'Arauco, encore aujourd’hui célèbres par les grandes ruines qu’on y découvre à l’approche des
Cordillères et par les rochers sculptés entre les bras de l’Amazone. Il entra au plateau de Bogota par
Pasca, d’où il passa à
Boza et à
Fontivon, en traversant les montagnes qui sont au nord : ce fut lui qui apprit aux
Chibchas à peindre des croix sur leurs manteaux, et sa doctrine entière, à l’instar de celle du Quetzalcohuatl de Tollan, était d’une extrême pureté. On le vit,
à
Zipacon,
enseignant des arts nouveaux aux indigènes, et à
Zuache il laissa la marque de ses pieds imprimée sur un rocher. On le vit à
Hunza (Tunja), et au lieu nommé de lui
Sogamoso, couchant dans des grottes aux bords de la rivière du même nom, où la tradition populaire le fait vivre deux mille ans, après lesquels il aurait été enlevé au ciel.
(1) Garcilaso,
Com. Real. lib. 1, cap. 10. — Velasco,
Hist. du roy. de Quito, liv. 11, § 5, passim.
(2)
Hist. gen. cap. 122.
Sahagun est me corruption évidemment espagnole, ce nom tel qu’il se présente étant celui d’une ville d’Espagne d’où le père Francisco de Sahagun est originaire. Il doit s’écrire probablement
Suha-con.
(1) Cundinamarca, nom peut-être donné improprement au plateau dit de
Bogota, au centre des montagnes de la Nouvelle-Grenade. Ses habitants étaient les
Muyscas, autrement dits
Chibchas.
(2) Plaza,
Memorias para la historia de la Nueva-Granada, cap. 1v, pag. 51.
(3) Ce nom parait composé encore de
Su ou
Suha, de
con et de
moxi.
Voir Zamora,
Hist, delà prov. de N.-Granada, lib. π, cap. 16.
En général ces traditions, comme celles du Pérou, sont extrêmement vagues et obscures, et l’on a de la peine à les discerner les unes d'avec les autres. On y distingue, cependant, quelques traces des institutions politiques et religieuses contenues dans le
Livre Sacre. Trois chefs confédérés gouvernaient souverainement le pays : le
Zipa, qui avait son siège à
Muequeta, aujourd’hui
Funza; le
Zuque de
Ramiriqui qui se transféra plus tard à
Hunza,
et enfin le
Sogamoso, successeur du prophète qui lui avait légué, avec son nom, l’héritage de sa puissance et de sa sainteté. Cette confédération devait évidemment son origine au dernier, et la tradition, en nous disant que le Zaque de Ramiriqui était le neveu de Sogamoso, laisse entrevoir la parenté qui devait exister entre les trois princes. D’accord avec les notions toltèques que nous avons trouvées également au bord du grand lac qui s’étend entre les ruines de Chicuvitu et celles de Tiahuanaco, elle racontait que les hommes avaient eu l’existence longtemps avant le lever du soleil et de la lune : le monde alors vivait dans les ténèbres et dans la nuit, parce que l’astre du jour n’avait pas encore reçu l’ordre de se mettre en marche. Cependant, il n’y avait que deux hommes (de la caste noble et sacerdotale), le Zaque de Ramiriqui et le Sogamoso : ils commencèrent par créer des hommes avec de
l'argile jaune et des’ femmes avec des paquets d’herbes
{zibak} ;
après quoi, voyant la nécessité d’éclairer l’univers, le Sogamoso י commanda à son neveu de Ramiriqui de monter au ciel où il devint le soleil. Trouvant encore cette lumière insuffisante, il s’éleva lui-même ensuite aux astres et devint la lune. Après ce que nous avons déjà dit, ces notions n’ont plus besoin de commentaires. Quelques idées relatives au Grand-père et à la Grand’mère se distinguent encore dans les rares notions qu’on a de ces contrées. On sait en outre qu’au sanctuaire de Sogamoso, où le vicaire du prophète continua à demeurer jusqu’à l’arrivée des Espagnols, on offrait fréquemment des victimes humaines, et que les
Xèques ou prêtres du temple s’obligeaient à une continence perpétuelle et à des austérités aussi rigoureuses (4) que ceux de Quetzalcohuatl à Teohuacan.
(4) Id,,
Ibid.
Cependant, entre les traditions confuses concernant ces divin!-tés ou les personnages merveilleux dont 011 a conservé les noms, on voit s’élever des luttes et des combats, dont les causes se dérobent sous des fables puériles en apparence, mais dont le côté sérieux se retrouve, dès qu’on les confronte avec celles des autres ־ peuples et surtout de la race nahuatl. On en conclut que les missionnaires ou législateurs qui apparurent au Cundinamarca, soit du nord, soit de l’est, y apportèrent, comme tous les apôtres de cette race ambitieuse et turbulente, des dogmes différents ou les semences des hérésies qui bouleversèrent tour à tour et ruinèrent les empires du Mexique et de l’Amérique centrale. Les Chibchas adoraient
Chibchacum (1) comme la divinité protectrice de la nation ; ainsi que Quetzalcohuatl à Cholullan, il était le patron des marchands et des laboureurs.
Nencatacoa était celui des peintres et des tisserands : il présidait aux orgies et s’y montrait sous la forme d’un ours, couvert d’un manteau, qui dansait avec les ivrognes; il portait en outre le nom de
Fo ou le Renard, suffisamment significatif et qu’on retrouve dans la composition des noms de plusieurs localités de ces contrées (2).
(1) Simon, dans Zamora,
ibid. —
Acosta,
Compendio historico del dis-cubrimiento y colonization de la N.-Granada, Paris, 1848, cap. xi, pag. 195.
Chibcha est le vrai nom des peu-pies de celte contrée que nous appelons
Muyscas. Chibcha-Cum parait encore faire allusion au dieu
Con du Pérou.
(2) On sait que
Fox est le renard en anglais,
fugs en allema’nd,
voss eu flamand, etc.
Funza parait en venir, ainsi que
Fuquene, etc. Le renard à jeun ou en deuil
(Nezahuat-Coyotl , nom d’un souverain de Tetzcuco) était un fétiche adoré au Mexique et au Pérou, à qui on offrait de la chicha comme au
Fo du Bogota (Aubin,
Mémoires sur la peinture didactique, etc., pag.
79). Une autre coutume commune aux Nahuas, Toltèques, etc., qu’on trouve encore aujourd’hui jusqu’à la Nouvelle-Grenade, c’est la danse appelée en espagnol
del Palo Volador, et qu’un voyageur moderne a vu exécuter à Angostura, sur les rives du Magdalena (Hippisley’s
Narrative of the expedition to the rivers Orinoco and Apure, pag. 312).
Un souvenir delà trinité nahuatl se représente dans la statue à trois têtes qui existait au temple de
Boyamà près de Tunja ; nous ne saurions affirmer, cependant, qu’il eût un rapport direct avec le Hurakan du
Livre Sacré. Mais la diversité des actions attribuées à Bochica et autres personnages merveilleux confondus avec lui, donne bien à penser que là, comme aux bords du Grand-Fleuve que nous appelons le
Rio-Magdalena, les trois royaumes principaux du
Cundinamarca auraient été fondés simultanément par trois de ces personnages, dont l’origine toltèque ne saurait se révoquer en doute. Cette forme de gouvernement qui était établie au
Zenù, à l’époque où les Espagnols y entrèrent, devait son existence à trois dieux qui y étaient apparus ensemble, suivant la tradition (1), en un temps déjà fort éloigné, et à qui les indigènes des bords du
Rio-Cauca et des contrées adjacentes attribuaient l’origine des royaumes de
Zenù, de
Tinzenù et de
Panzenù, situés entre le Magdalena, les montagnes d’Abibe et le golfe de
Tolu (2). : malgré la rareté des détails laissés par les conquérants, on reconnaît, cependant, partout les traces des institutions toltèques et celles d’un état de société analogue à ce qui se voyait au
Cundinamarca d’un côté et au Darien de l’autre. C’est là que les conquérants de la suite de Quesada découvrirent ces sépultures tant vantées dans les relations et auxquelles seules ce pays doit de n’avoir pas été entièrement oublié. C’étaient des tumuli semblables à des collines, dont
l'intérieur renfermait des tombeaux en pierre de taille et voûtés où l’on trouva, avec les cendres des princes, des trésors considérables. Depuis Caramari (Carthagène) la vallée entière, du Zenù et du Cauca jusqu’au delà d’Antioquia était parsemée de ces tumuli ; de vieux seibas étendaient au-dessus leurs branches entre lesquelles pendaient des multitudes de cloches d’or fin, aussi grosses que des mortiers. Là, ainsi qu’en tant d’autres lieux, la civilisation avilit déchu considérablement, depuis les temps antiques, a la suite de révolutions de toute sorte et d’invasions successives dont les peuples avaient perdu le souvenir : mais on retrouvait ses vestiges dans les monuments en pierre, abandonnés dans l’épaisseur des forêts, et surtout dans les arts admirables que les
Caras de toute dénomination avaient conservés ; on la reconnaissait à la taille des pierres précieuses, au travail de la bijouterie d’or et d’argent, à la richesse et à l’élégance des étoffes qu’ils continuaient à tisser, et même à la structure si remarquable de leurs temples et de leurs palais qui, quoique en bois, présentaient un air de grandeur et de solidité dont s’étonnèrent à juste titre les conquérants (1).
(1) Zamora,
Hist, de N .-Granada,
lib. ii, cap. 3.
(2)
Tolu, ville sur le bord du golfe dit aujourd’hui de Morrosquillo, non loin du Darien. Ce nom, chez ces
nations d’origine caraïbe, rappelle encore celui de
Tula ou
Tolan.
Ainsi, des lacs glacés du nord jusqu’aux extrémités du Chili, sous les couches diverses que le temps, les invasions des tribus barbares ou civilisées, venues par mer ou par terre, de l’est ou du couchant, ont étendues dans les deux Amériques, on reconnaît constamment, à côté d’un sabéisme primitif et d’une religion astronomique, les vestiges des institutions apportées par la race
nahuatl ou développées par elle sur le sol qu’elle avait conquis. Ces
institutions s’étaient mêlées à une foule d’autres, introduites naturellement par des nations qui lui étaient étrangères, ou ennemies, elles s’y sont modifiées à leur contact, ainsi qu’il est arrivé depuis trois siècles que les missionnaires espagnols leur ont annoncé l’Evangile ; mais partout où ·cette race énergique a passé, elle a laissé l’empreinte ineffaçable des superstitions et des rites qui la distinguaient : ni les prédications persuasives des Las Casas, ni le fanatisme brutal des Valverde, n’ont réussi à lui ôter son caractère, pas plus que le prosélytisme armé des Incas qui les précédèrent, à la manière de Mahomet et d’Omar. En comparant les populations agricoles des Andes et les clans vagabonds du Brésil et du Chili, aux habitants du Mexique ou aux tribus guerrières des Etats-Unis, qui en sont éloignés de plus de deux mille lieues, on est surpris d’observer encore une similitude frappante d’idées et d’usages entre l’Araucan qui habite vers le 50e degré de latitude méridionale, et le Chippeway, situé à la même distance de l’équateur dans les contrées du nord. A côté des habitudes agricoles et des traces d’une culture en commun, qui parait avoir été une des lois primitives des sociétés régulières de l’Amérique, on rencontre des maximes de désordre et de dissolution, mêlées aux
simples lois d’une existence paisible : les rites magiques des devins, l’usage de vouer l’enfant dès sa naissance à un génie familier (nagual ou manitou), souvent représenté par un animal, un reptile ou un oiseau, enchaîné plus ou moins à son existence, se retrouvent encore aujourd’hui au fond des coutumes des populations civilisées et chrétiennes, comme dans celles des plus sauvages, d’un bout à l’autre du continent (1).
(1) Herrera,
Hist, gen., decad. v, lib. n, cap. 4. — Zamora,
Hist, de N.-Granada, lib. 11, cap. 3.
(1) Moke,
Histoire des peuples américains, chap. n. —Herrera,
Hist, gen.,
decad. iv, lib. vin, cap. 4 et 5 in fine. —Torquemada,
Monarq. ïnd., lib. xiv, cap. ultimo.— La Peyrcre,
Relation de l’Islande, art. 12. —
Nuñez de la Vega,
Constit. diœces., in Præamb., n. 36. — Smith,
Voyages and discoveries, vol.
1, pag. 140.
D’un autre côté, quelque soit le Contraste de leurs institutions, telles qu’elles se présentent à nous actuellement, elles marquent toutes un état plus avancé que celui où nous voyons encore les peuples barbares, du nord-est de l’Asie. Cette frontière de l’ancien monde, d’où tant d’écrivains prétendent que l’Amérique a dû recevoir sa première population, n’est plus habitée elle-même que par des tribus nomades, refoulées depuis longtemps vers la mer Glaciale, par les grandes hordes des Mongols et des Mantchoux, et si de nouveaux déplacements devaient aujourd’hui les conduire d’un continent à l’autre, ils n’y porteraient avec eux que l’ignorance et l’anarchie. Il restera donc toujours malaisé d’expliquer comment des nations à demi policées sortirent jadis de ces parages pour se répandre dans les contrées américaines, à moins d’admettre qu’un ordre de choses tout différent régnait alors dans le monde asiatique, et que ses vieilles institutions rayonnaient librement jusque dans les steppes du Nord, maintenant livrées aux Tartares : c’est encore ce qu’on peut inférer, jusqu’à un certain point, des monuments pyramidaux et des tumuli qu’on trouve en grand nombre dans la Sibérie, et qui attestent une culture antique depuis longtemps anéantie. Nous ajouterons que le culte d’un dieu invisible, adoré sous trois noms différents, l’art de la magie si universellement
pratiqué chez les Nahuas, et les effets d’hallucination extraordinaires qu’on y observe, rappellent sensiblement le culte de diverses tribus sibériennes et le chamanisme des Mongols (1). Ainsi
auraient pu partir de ces régions aujourd’hui sauvages et inaccessibles des essaims déjà organisés régulièrement; ainsi encore il aurait pu en arriver de très-loin, jusque des confins de l’Inde et de la Chine, comme l’ont cru reconnaître des hommes éminents aux croyances savantes de quelques nations. Mais de quelque part qu’aient pu sortir ces migrations de peuples initiés à l’ordre social, que leur marche ait été. dirigée de l’est à l’ouest ou de l’orient au levant, elles n’appartiennent pas moins à une époque déjà bien reculée, qui répond au développement de la vie
politique dans l’intérieur de l’Asie et qui précède de plusieurs siècles la domination des Mongols dans ces vastes contrées.
(1) Strahlenburgb ,
Hist. Kamtschatka, pag. 16. — Malle-Brun, Géographie, liv. xxxvni. — Sauer’s
Expedition, vol. 1, pag. 116. —Hérodote mentionne également l’ail de la divination chez les Scythes, elc.
(Hist.,
lib. iv, cap 59),