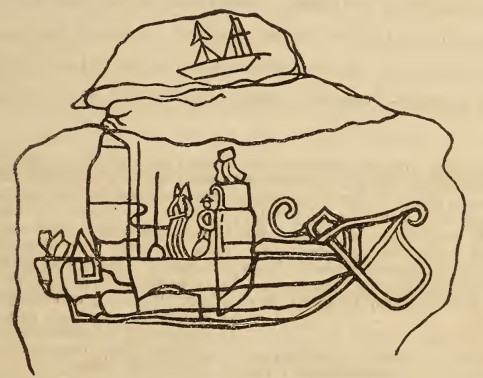
Origine symbolique des Américains. Questions sur leur berceau. Notions de géographie physique américaine. Distances de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique à l'Amérique. Possibilité des voyages anciens des deux premiers continents à l’autre.
Dans un paragraphe d’une extrême concision, qu’on trouve rapporté dans presque tous les auteurs qui ont traité cette matière (4), les vieux chroniqueurs mexicains paraissent avoir voulu résumer en quelques lignes toute l’histoire des anciennes races américaines. Ils disaient que les habitants des pays conquis par Cortès étaient venus successivement des terres lointaines du nord ou de l'orient, en douze ou treize compagnies ou escadres : que les premiers avaient été les Chichimèques (2), qui vivaient de la chasse, abandonnés qu’ils étaient aux instincts de la vie sauvage. Qu’ensuite arrivèrent les Colhuas (3), qui enseignèrent aux Chichimèques à cultiver la terre, à cuire la viande et à se servir des autres choses en usage dans la vie civilisée.; enfin, que longtemps après, vinrent les Nahuas ou races mexicaines et que ce furent eux qui changèrent la religion du pays et introduisirent le culte des idoles. Ils ajoutent que le père des familles nahuas était un vénérable vieillard, nommé Iztac-Mixcohuatl (4), lequel eut deux femmes : de la première, Ilan-cueitl (5), il procréa six fils qui furent Xelhua, père des Tecpanèques (6) ; Tenuch, père des Mexicains (1); Ulmecatl, père des Ulmecas ou Olmecas (2); Xicalancatl, père des Xicalancas (3); Mixtecatl, père des Mixtecas (4), et Otomitl, père des Otomis (5). De la seconde femme Chimalmatl (6) il n’eut qu’un seul fils, lequel s’appela Quetzalcohuatl (7).
(1) Gomara, Cronica, etc. cap 66.— Torquemada, Monarq. Ind. lib. 1, cap. 31.
(2) Chichimèque, prononcez .tchitchimec ; c’est le nom que les auteurs mexicains donnent généralement aux populations aborigènes les plus anciennes du Mexique.
(3) Colhua, ou culhua, culua, de coltic, chose courbée. De là le nom de la cité de Colhuacan, qu’on traduit in■; différemment, ville de la courbe, de choses recourbées (des serpents), et aussi des aïeux, de coltzin, aïeul.
(4) Iztac-Mixcohuatl, blanc serpent nébuleux. Mixcohuatl exprime le tourbillon de nuages, tornado en espagnol, phénomène fort commun et fort remarquable dans le Mexique et l'Α-mérique centrale (Aubin, Mém. sur la peinture didactique, etc., page 54).
(5) Ilan-cueitl, vieux jupon, c’est-à-dire, vieille femme, de ilantli, vieille, et de cueitl, jupon ; enaguas en espagnol. ־
(6) Xelhua, nom d’un de ceux qui se sauva de l’inondation, suivant le Codex Vaticanus, annoté par Rios. Tecpanèques sè prend ici pour les populations anciennes des pays qui relevaient de Tecpantlan, nom mexicain de la ville capitale desZoqui, dans l’Etat de Chiapas, appelée par eux Ohcaray dans leur langue.
(1) Tenuch et les Mexicains représentent ici les ancêtres primitifs de la .race nahuatl, T.01lèques et autres.
(2) Ulmeca, nom des anciennes populations du plateau de Cholula et des pays voisins, dans l’Etat de Puebla: de los Angeles.
(3) Les Xicalancas avaient leur capitale à Xicalanco, ville située naguère à la pointe du même nom, vis-à-vis l’ile de Carmen, entre la mer Atlantique et la lagune de Terminos.
(4) Sous le nom de Mixtecas, on entend les populations de la Mixtèque et peut-être aussi les Zapotèques dans l’Etat d’Oaxaca.
(5) Les Otomis habitaient la vallée de Mexico et s’étendaient surtout au nord et à l’ouest vers le Michoacan ; Otompan, aujourd’hui Otumba, fut leur capitale.
(6) Chimàlman, porte-bouclier, de chimalli, bouclier, et marna, porter.
(7) Torquemada,Monarq. Ind. lib. 1. cap. 12.—Gomara, Cronica, etc., cap. 66..
Ces lignes que nous lisions, en quelque sorte, comme une énigme, il y a vingt ans, jettent aujourd’hui une lumière inattendue sur nos études en débrouillant le chaos de tant d’émigrations diverses qui ont sillonné l’Amérique, et résument avec une étonnante exactitude l’origine et la provenance des principales races qui ont peuplé cet hémisphère. Sous le nom générique de Chichimèques, qui a tant embarrassé les auteurs anciens et modernes, la tradition mexicaine admet l’ensemble des populations aborigènes du nouveau monde, et en particulier les premières peuplades qui colonisèrent ce continent à l'Origine des temps. Ainsi s’expliquent les contradictions apparentes de Sahagun, de Torquemada, etc., dans les récits relatifs à ces Chichimèques, qu’ils représentent tantôt comme , des brutes et des barbares, tantôt comme les plus civilisés des peuples anciens : en effet , si, parmi les innombrables nations désignées sous ce nom si vague, les unes s’abandonnèrent à la vie sauvage, il y en eut d’autres qui se policèrent ou surent améliorer leur condition sociale au contact d’une race nouvelle, désignée dans l'histoire par le nom de Colhua; celle-ci indique à la fois une autorité paternelle et peut-être aussi le culte du soleil et du serpent. C’est cette racé qui serait venue par delà les mers, directement de l’orient, et qui aurait introduit en Amérique, neuf ou dix siècles avant l’ère chrétienne, la civilisation dont Palenqué et Mayapan présentent encore des traces si remarquables : c’est cette race dont les descendants se seraient trouvés ensuite en lutte avec des nations' énergiques, signalées généralement sous le nom de Nahuas, et qui commencèrent à émigrer du nord-est longtemps avant notre ère. Toutes les traditions, toutes les histoires et les théogonies même, l'ensemble des documents originaux que nous possédons en Europe ou en Amérique, dans les collections publiques ou privées, ne seraient, pour ainsi dire, que des commentaires de ce précis et la relation succincte des événements qui furent la conséquence de la dernière invasion, laquelle continua, presque sans interruption, plusieurs siècles avant l’ère chrétienne jusqu’au onzième ou douzième après. D’où venaient ces races guerrières qui, durant tant d’années, fournirent l’émigration américaine, qui bouleversèrent plusieurs fois cet hémisphère, en le renouvelant, en changeant ou en modi-difiant ses institutions, c’est ce que nous examinerons à l’aide des traditions indigènes, après avoir exposé brièvement ce que les modernes ont pensé de la possibilité de leur passage par le nord-ouest, ainsi que les idées reçues à cet égard.
Au commencement de la conquête de l’Amérique, des systèmes de toute nature s’élevaient sur l’origine et l’existence des populations qui venaient de se révéler : en voyant la vie sauvage et abrutie des unes, les mœurs policées et les institutions sociales des autres, on se demanda plus d’une fois s’il était possible qu’elles appartinssent à une même famille et qu’elles eussent eu le même berceau. On oubliait que dans l’ancien continent il existait plus d’un exemple semblable, et que dans des régions naguère réputées pour leur haute civilisation, l’invasion étrangère et la tyrannie en avaient réduit les habitants au dernier degré de l’échelle sociale. Malgré la condition avilie où l’on trouve aujourd’hui un grand nombre de tribus sur le continent américain, il y a de fortes présomptions pour admettre qu’elles descendent de peuples dont l’intelligence comme l’état social a dû être plus développée anciennement. Par les traditions et les monuments épars en tous lieux, on reconnaît sans peine les traces d’une civilisation perdue et qui fut probablement dans les temps passés la condition normale des nations du nouveau monde. « C’est, en effet, une question importante, dit ici Guillaume de Humboldt, de savoir si l’état sauvage qui, même en Amérique, se retrouve à différents degrés, doit être regardé comme l’aurore d’une société à naître, ou si ce ne sont pas plutôt les derniers débris d’une civilisation perdue, disparaissant au milieu des tempêtes, bouleversée et dispersée par d’effroyables catastrophes. Pour moi, ajoute l’éminent écrivain, cette dernière hypothèse me paraît la plus rapprochée de la vérité. »
Voyons maintenant ce qu’à l’appui de cette opinion nous trouvons sous les symboles contenus dans le Livre Sacré. Suivaut les traditions toltèques et mexicaines, le mérite de la civilisation américaine reviendrait entièrement à la race nahuatl, qui ne se serait pas moins distinguée par la supériorité de sa culture intellectuelle que par l’empreinte énergique qu’elle laissa de son existence et de ses institutions dans toutes les nations où elle passa ou qu’elle soumit à sa domination. En supposant maintenant, avec la plupart des auteurs qui ont traité cette matière, que l’Asie ait été le berceau de ces institutions, qui présentent d’ailleurs avec les siennes des analogies si frappantes, on ne se refuserait que difficilement à admettre qu’il eût existé anciennement des communications entre les deux continents, à moins de prétendre que ces analogies soient le simple résultat d’une identité de position, dans laquelle se trouvent les peuples à l’aurore de la civilisation. Dans le premier cas, par quelles voies ces communications lointaines se seront-elles accomplies? Comment la culture intellectuelle se sera-t-elle conservée en traversant les régions boréales où ils se rapprochent l’un de l’autre, si, comme on le prétend, ce passage n’a pu s’opérer que par le nord? Voilà des problèmes qui, depuis trois siècles, n’ont cessé d’intéresser la science, et qui aujourd’hui ne sont pas encore résolus.
L’exposé que nous voulons faire ici des traditions indigènes en regard de celles que l’ancien monde a pu conserver d’une terre lointaine au delà de l'Océan occidental, servira, sans nul doute, à éclaircir cette question : c’est ainsi seulement qu’on commencera à connaître l’histoire des antiques communications entre les deux continents. Les détails des annales des sciences ne sont utiles qu’autant qu’on les réunit par un lien commun. L’accumulation des faits isolés ne produirait qu’une sécheresse fatigante, si l’on ne tendait, tout en y fouillant, à quelque vue générale sur les progrès de l’intelligence et la marche de la civilisation. Ils sont la base principale de toute discussion soumise à une saine critique, et leur indication est indispensable pour faire juger le lecteur du degré de confiance que méritent les résultats obtenus. Dans les développements qui suivent, nous tâcherons de ne pas nous étendre inutilement sur des sujets qui ont été suffisamment traités auparavant, nous nous bornerons à ce qui peut conduire, dans l’état actuel de nos connaissances, à de nouvelles combinaisons d’aperçus historiques, y ajoutant quelques notions d’histoire et de géographie physique puisées à une source sûre (1) et qui pourront, en les éclairant, devenir une mine féconde de rapprochements utiles.
(1) Humboldt, Essai sur l'histoire de la géographie du nouveau continent, Paris 1837.
Lorsqu’on s’élève à des considérations générales de physique du globe et que l’on examine le relief des deux grandes masses continentales qui dépassent aujourd’hui le niveau de la surface de l'Océan, on distingue, soit leur configuration individuelle (articulation, élargissement vers le nord, terminaison pyramidale vers le sud à différents éloignements du pôle, abondances d’îles opposées aux côtes orientales), soit les rapports de proximité ou d’éloignement entre les deux mondes. Ces circonstances auxquelles on lie la position géographique de quelques groupes d’îlots, interposés comme'lieux de passages ou stations intermédiaires, ont nécessairement influé sur les chances qu’ont eues les habitants des deux continents dé se révéler leur existence mutuelle. Par 60° et 70° de latitude boréale, l’accroissement des masses continehtales est tel, que la largeur des mers y forme quelque chose de plus que la huitième partie de la circonférence du globe correspondant à ces parallèles. L’Amérique se rapproche de l’ancien continent, sur trois points, à moins de six cents lieues marines (de 20 au degré équatorial), entre l’Écosse ou la Norwége et le Groenland oriental, entre le cap nord-ouest d’Irlande et les côtes du Labrador, entre l’Afrique et le Brésil. « La première de ces distances, dit ici Humboldt (1), n’est presque que la moitié des deux autres. Le canal de l’Atlantique entre le cap Wrath d’Écosse et Knighton-Bay (lat. 69° 15z), au sud de Scoresby-Sound du Groenland oriental, n’a que 270 lieues de largeur, et l’Islande se trouve dans la direction de cette traversée. La vallée longitudinale de l’Atlantique qui sépare les deux grandes masses continentales, en offrant des angles saillants et rentrants qui se correspondent (du moins de 75° N. à 30° S.), s’élargit vers le parallèle de l’Espagne où, du cap Finistère à Terre-Neuve, il y a 617 lieues marines. Elle se rétrécit une seconde fois dans le voisinage de l’équateur, entre l’Afrique (côte du cap Roxo, près du banc des Bissagos et Sierra-Leone) et le cap San-Roque. La distance de continent à continent, dans une direction N.-E. S.-O. sur laquelle se trouvent les îlots et écueils de Rocas, de Noronha, du Pinedo de San-Pedro et de French-Shoal, est de 510 lieues, en supposant le cap de Sierra-Leone, d’après les observations du capitaine Sabine, lg. 15° 39״24 ׳, et le cap de San-Roque, d’après l’amiral Roussin et Givry, lg. 37° 37״26 ׳. Le point le plus rapproché de l’Afrique est probablement la pointe Toiro, près de Bom-Jesus (lat. 5° 7׳ aust.), tandis que la saillie la plus orientale de l’Amérique est de 2° à 3° plus au sud, entre le rio Parahiba do Norte.et la rade de Pernambuco. »
(1) Id. ibid. tom. 11, pag. 52.
Les traversées si communes de la Méditerranée fournissent là-dessus des comparaisons faciles à saisir. Il y a de l’Ecosse au Groenland oriental (minimum de distance), comme de Gibraltar au cap Bon ; de l’Afrique au Brésil, comme de Gibraltar à Bengasi et aux côtes de Cyrénaïque. Mais le rapport de ces distances change entièrement si on se rappelle que les terres situées au nord du cercle polaire, peuplées par quelques misérables tribus d’Esquimaux, l’immense péninsule du Groenland, les Arctic-Highlands au nord de la baie de Baffin et les terres formant les côtes septentrionales du canal de Barrow, sont entièrement séparées de l’Amérique continentale et l’enveloppent vers le nord. C’est ainsi que sur une moindre échelle, la Scandinavie, habitée par des peuples de race germanique, enveloppe le nord-est de l’Europe et rappellerait un phénomène de configuration semblable, si l’isthme de Finlande, rempli de lacs, était rompu entre le golfe de ce nom et la mer Blanche. La Scandinavie américaine, tout insulaire et circumpolaire, ayant des limites encore peu déterminées vers le nord-est et le nord-ouest, malgré les découvertes récentes de Franklin, de Mac-Clure, de Cane et de Mac-Clintock, appartient à l’Amérique au même titre que l’Archipel de la Terre-de-Feu ; elle lui appartient, comme la Nouvelle-Zemble, le Japon et Ceylan font partie de l’Asie. La direction des côtes orientales de l’Amérique, depuis la Floride jusqu’au 70° de latitude, est, malgré la vaste étendue d’une mer intérieure, communiquant avec l’Atlantique par le détroit de Davis, si uniforme du sud-ouest au nord-est (1), que la partie la plus orientale du Groenland, la terre d’Edam, vue l’an 1665 (2) par les Hollandais, en latitude 77° 25', est de 3°1/2 plus orientale que le cap Blanc d’Afrique, et seulement de la même quantité plus occidentale que le cap Slyne en Irlande. Il résulte de cette direction que la région continentale de l’Amérique reste plus éloignée de l’Europe que la côte déserte du Groenland oriental : aussi la moindre distance de l’Irlande au Labrador est-elle de 542 lieues marines, presque d’une trentaine de lieues de plus que la distance de l’Afrique, au Brésil.
(1) Direction presque parallèle aux côtes occidentales de l’ancien continent (S.. S. O.— N. N. E.) des caps Blanc et Bojador au cap Nord de la Norwége.
(2) Si l’on voulait objecter l’incerti-lude de cette position, ajoute ici Humboldt, je rappellerais que le capitaine Sabine, dans son courageux voyage pour la détermination de la figure de la terre par l’observation du pendule s’est avancé, en 1823, sur celte côte jusqu’à 76° de latitude, au nord de Ro-seneath-lnlet et 1° 1/2 au sud de la terre d’Edam, il se trouvait déjà par long. 21°23’. Des caries plus anciennes avançaient le Groenland encore plus vers l’est, de sorte que la partie la plus orientale était sous le méridien d’Edimbourg. {Essai sur l’hist. de la géog. du N. Continent, torn. 11, note de la pag. 54). On sait que depuis les expéditions chargées de la recherche de Franklin et celle de Kane alteigni-rem presque l’extrémité du pôle.
Mais tel est le froid qui règne sur la côte orientale d’un continent par les latitudes où il tombe de la neige en abondance et où dominent les vents de terre; telle est la différence de position et l’inflexion des lignes isothermes en Amérique et en Europe, que, pour trouver une terre que l’Européen puisse habiter avec quelque agrément, il faut avancer du Labrador vers l’embouchure du Saint-Laurent. Nous marquerons encore cette distance (690 lieues marines) de l’Irlande au Saint-Laurent avec quelque précision, parce que l’embouchure du grand fleuve a été l’objet des premières incursions de colons islandais, plus de cinq cents ans avant les voyages de Colomb et de Cabot.
Dans ces conditions de géographie physique, continue l’auteur de‘ Y Essai sur l' histoire de la géographie du nouveau continent, il ne s’est agi jusqu’ici que d’évaluations de distances directes, non de routes que suivent les peuples à travers l'Océan, favorisés ou contrariés par les vents ou les courants, attirés et déviés par les avantages qu’offrent des îles interposées ou des stations intermédiaires. L’Islande, les Açores, les Canaries, sont les points d’arrêt qui ont joué le rôle le plus, important dans l’histoire des découvertes et de la civilisation, c’est-à-dire de la série des moyens qu’ont employés les peuples de l'Occident pour étendre la sphère de leur activité et pour entrer en rapport avec les parties du monde qui leur étaient restées inconnues. Près de l’entrée de l’antique fleuve Ogenos, océan, les îles Fortunées furent connues aux Phéniciens et aux Hellènes, dès qu’ils tentèrent de dépasser les colonnes de Briarée. La découverte de l’Islande précéda celle des Açores, groupe intermédiaire par sa position en latitude, mais de quelques degrés plus occidentale que l’antique Thulé (1), dont la côte de j’est coïncide presque avec le méridien de Ténériffe. Ces îlots, jetés entre les deux continents (2), ont perdu de leur importance, depuis qu’ils n’ont plus été les avant-postes de la civilisation européenne, ' des points d’attente et d’espérance. Lorsque l’exploration des côtes d’Afrique et d’Amérique a été consommée, ils n’ont plus eu d’intérêt historique. Il ne leur est resté que l'avantage matériel de servir de lieux de relâche et de colonisation agricole.
(1) Dans la supposition’ qu’avec M. de Humboldt 011 admette que Fis-lande soit l'Ultima Thulé, opinion qui est aujourd’hui rejetée de beaucoup de savants.
(2) Il y a de l’extrémité septentrioniale de l’Ecosse à l’Islande 162 lieues marines ; de l’Islande à l’extrémité sud-ouest du Groenland, 240 lieues; de celle extrémité aux côtes du Labrador, 140 lieues ; à l’embouchure du Saint-Laurent,· 260 lieues; de l'lslande directement au Labrador, 380 lieues. Il y a du Portugal (embouchure du Tage) aux Açores (Saint-Michel) 247 lieues ; des Açores (Corvo) à la Nouvelle-Ecosse, 412 lieues; des Canaries (Ténériffe) au continent de l’Amérique méridionale (à l’embouchure de l’Oyapok, dans la Guyane française, en supposant le fort de Cayenne, avec M.Givry, à 3° 38820 ,("35 ׳ lieues marines (Id. ibid, note, page 57).
L’étendue du continent américain est immense dans sa partie boréale, surtout au delà des soixantièmes degrés de latitude, où le maximum de sa largeur continentale de l’ouest à l’est, du cap du Prince-de-Galles à la terre d’Edam, ou, si l’on préfère un point déterminé avec plus de certitude astronomique par le capitaine Sabine, à Roseneath-Inlet, dans le Groenland oriental, où sa largeur, disons-nous, est de 154° 1/4, ou (3) de 148° 20’. A cette hauteur les deux mondes vers l’est de l’Asie sont tellement rapprochés qu’un détroit de dix-sept lieues et demie marines de largeur seulement les sépare (1), et que les Tchouktches d’Asie, malgré leur haine invétérée contre les Esquimaux du golfe de Kotzebue, passent quelquefois aux côtes américaines. Cette grande proximité des continents révèle aussi dans la distribution géographique des végétaux. C’est surtout au nord du détroit de Behring que le Rhododendrum, l’Azelia procumbens, l’Uvolaria asplenifolia, et les Liliacés de la flore alpine du Kamtchatka, couvrent (2) le littoral américain, qui, bas et sablonneux, jouit d’une température plus douce que la côte asiatique.
(3) La différence de longitude de 148° 1/3 offre à peu près 59° 1/2 de moins que le maximum de la largeur de l’ancien continent, entre les méridiens du cap Oriental (détroit de Behring) et le cap Vert d’Afrique. Cette différence se fonde sur les observations de MM. Beechey et Sabine. Si l’on se borne à la masse vraiment continentale depuis le cap du Prince-de-Galles (détroit de Behring) jusqu’au cap de Saint-Louis (Labrador), on trouvera 112° 35׳ (Hum-boldl, ibid, note, pag, 58).
(1) D’après les observations faites pendant l’expédition du Blossom (Bee-chey, tom. ii, page 673), la largeur du détroit de Behring est déterminée par la position du cap Es.t (d’Asie); latitude, 66° 3״10 ׳; longitude, Paris, 172° 4׳14 ׳, et, par celle du cap (américain) du Prince-de-Galles, latitude, 65° 33״30 ׳; longitude, 170° 19״34 ׳. La distance entre les deux caps est, par conséquent, en la calculant, dans la supposition de la terre sphérique, de 52° 9’ 2״. Cook croyait la largeur du détroit de 44 milles seulement. A peu près au milieu du canal se trouvent les iles de Saint-Diomède (lies de Krusenstern, 1, Raunanoff el Fairway-Rock). Ibid, ut sup.
(2) Ad. Chamisso, Bemerkungen auf der Entdeckungs Reise des Rurik, 1821, pag. 166 et 177. La hauteur qu’acquièrent les pins réunis en petites forêts dans la baie de Norton, vis-à-vis du promontoire rocailleux des Tchukotzkoy-Noss et du golfe d’Anadyr, prouve surtout celte différence de température entre les côtes de l’est et celles de l’ouest.
Lorsqu’on considère attentivement la configuration extraordinaire de l’Asie et cette chaîne d’îles qui, presque sans interruption, se prolonge de la péninsule du Kamtchatka, par les Kouriles, Yeso, le Japon, les Lie-ou-Kieou (Loo-Choo), Formose, les Bachis et les Babuyanes aux Philippines, du 20° au de latitude, on conçoit comment cette longue traînée d’îles de grandeurs si diverses, formant avec le littoral du continent diversement articulé quatre Méditerranées à plusieurs issues (3)·, les mers d’Okhotsk, de Taraïkaï, ־du Japon et de la Chine, devait exciter les peuples du continent à former des rapports de commerce, de colonisation et de propagande religieuse avec les habitants des îles opposées. L’étude plus approfondie que, grâce aux travaux d’Abel Rémusat, de Klaproth et de Siebold, et, dans ces derniers temps, de Stanislas Julien, de Landresse, de Léon de Rosny, etc., on a faite de l’histoire de la Chine, du Japon et de la Corée, prouve l’influence que ces rapports ont exercée sur les. progrès de la civilisation et sur l’extension du buddhisme. Dans tout l’est et le nord de l’Asie, cette extension semble liée à l’adoucissement des mœurs et au goût pour les lettres. Deux cent neuf ans avant notre ère, l’expédition mystique de Thzin-chi-Houang-ti parcourut la mer de l’est « pour chercher un remède qui procure l’immortalité de l’âme. » A cette occasion, trois cents couples de jeunes gens se fixèrent au Japon (1). Le caractère particulier du littoral continental, et d’une chaîne d’îles qui s’offre à la vue du navigateur, tantôt comme une longue terre brisée, tantôt comme des soulèvements volcaniques, suivant une même direction (S.S.O.-N.N.E.), donnerait à croire que des nations commerçantes et qui connaissaient très-anciennement l’usage de la boussole, auraient pu être conduites progressivement vers l’Amérique occidentale, par le détroit de Behring, ou par la Ion-gue chaîne arquée des îles Aléoutiennes, qui joint presque les péninsules d’Alaska et du Kamtchatka, par le 60° de latitude. Rien ne prouve cependant jusqu’ici que, dans les temps historiques, la violence d’une tempête soit devenue le motif d’une communication entre les deux continents.
(3) C’est la -nomenclature hydrographique de M. de Fleurieu.
(1) Humboldt, Tableaux de la natare (deuxième édition), tom. 1, pag. 169.
Des savants annonçaient, il y a déjà près de cent ans (2), que les Chinois avaient connu l’Amérique dès le cinquième siècle de notre ère et que leurs navires allaient au Fousang, situé à 20,000 li de distance de Ta-Han ; que le Fousang est la côte nord-ouest du nouveau continent, tandis que le Ta-Han désigne le Kamtchatka. Malgré les judicieuses réfutations que M. Klaproth a publiées contre cette hypothèse (3), elle s’est reproduite à plusieurs reprises sous la plume de savants estimables qui croient retrouver dans ce Vinland d'Asie (4) plus d’un trait caractéristique désignant l’Amérique (1). Si l’on peut d’ailleurs ajouter foi aux cartes des Japonais, leurs voyages se seraient étendus anciennement jusqu’à Java, et vers le nord jusqu’au détroit de Behring ; au sud, leurs navigations étaient longues et dirigées par des cartes marines. Ils recevaient des épiceries des Moluques à une époque fort reculée, et il y eut probablement un temps où leurs entreprises commerciales s’étendaient jusqu’au golfe Persique. Du côté opposé, on croit en trouver des traces jusque sur les côtes de Californie (2), et Gomara assure qu’au temps des expéditions de Cortès dans cette région, on y découvrit les débris d’un navire du Cathay (3) : il existait, du reste, une tradition constante alors parmi les populations américaines de l’océan Pacifique, que des nations lointaines venaient, auparavant d’une région d’outre-mer commercer aux ports de Coatulco et de Pechugui, dépendants du royaume de Tehuantepec. Les Wabi, réduits aujourd’hui à quelques milliers de pêcheurs répandus sur les lagunes voisines de la ville de ce nom, disaient de leur côté y être venus par mer, du côté du sud (4), et il y aurait peut-être quelques points de comparaison à établir entre eux et les׳ Aïno, sujets du Japon (1). Cependant, de toutes les nations asiatiques voisines de l’océan Pacifique, les plus entreprenantes étaient les Matais^ rivaux des Arabes pour le commerce et la navigation dans la mer des Indes. Ils sont encore renommés de nos jours par l’attrait qu’ils éprouvent pour les aventures maritimes. On est tout étonné de voir qu’à l’époque où les Portugais pénétrèrent pour la première fois dans l'Archipel Indien, il soit fait mention de flottes malaises qui, pour le nombre et l'étendue des vaisseaux, annoncent des puissances maritimes du premier ordre. Une de ces flottes, au dire d’un écrivain instruit (2), comptait jusqu’à quatre-vingts navires, dont trente-cinq étaient des galères considérables ; une autre se composait de trois cents voiles, dont quatre-vingts étaient des jonques de quatre cents tonneaux; une autre enfin avait, compté cinq cents vaisseaux de tout bord, portant soixante mille hommes. Devant ces témoignages réunis, ne serait-il pas permis de conclure que, si jusqu’ici aucun fait historique n’offre l’indice d’une communication spontanée des peuples civilisés de l’Asie orientale avec le continent opposé, il n’en est pas moins possible qu’elle ait pu exister dans des temps antérieurs, et qu’en plus d’une occasion la tempête ait pu jeter des Japonais, des Sianpi, de la race coréenne, ou des Malais sur la côte occidentale de l’Amérique (3) ?
(2) Deguignes, le père, dans les Me-moires de l'Académie des Inscriptions, etc., tom, xxviii, pag. 505.
(3) Recherches sur le pays de Fousang, mentionné dans les livres chinois et pris mal à propos pour une partie de l'Amérique (Nouvelles Annales des Voyages, tom. xxi, deuxième série).
(4) Celte expression est de M. de Humboldt, qui ajoute à ce propos : C’est une analogie curieuse qu’offre le pays des vignes de Fousang (l’Amérique chinoise de Dcguignes), avec le Vinland des premières découvertes Scandinaves sur les côtes orientales de l’Amérique.
(1) « Le Fou-Sang est l’objet d’une curieuse notice dans le Wa-kan-san-taï-dzon-yé. ou Grande Encyclopédie japonaise. Cette région énigmatique est située à l’est du Ta-nan-kouëh, à une distance d’environ 20,000 li à l’est, suivant l’autorité de Tong-tien. Ce pays est à l’est de la Chine. Il y croit un grand nombre de fou-sang (hibiscus'rosa sinensis'),dont les fenil-les ressemblent à l’arbre tong. Ses habitants possèdent une écriture et se font des vêtements avec l’écorce de l’arbre fou-sang. Ils élèvent des cerfs comme des bœufs, et se font une boisson avec du lait. Le sol ne renferme point de fer, mais on y trouve du cni-vre. »' — Une autre notice est consacrée au pays des Amazones, Nyo-mi-gok, « le royaume des femmes, » pays situé au sud-est du Grand-Océan et à l’est du pays du Fou-Sang. Je dois ces notes à l’obligeance de M. Léon de Rosny, qui, outre sou savant Essai sur la langue japonaise, a publié des travaux d’un grand intérêt sur le Japon. J’ajouterai que les lecteurs qui voudraient établir· des comparaisons entre la description japonaise du Fou-Sang et quelque région américaine, trouveront d’étonnantes analogies dans Tes pays décrits par Castaneda et Fra Marcos de Niza dans la province de Cibola (Relation du voyage de Cibola, entrepris en 1540. Coll. Ternauxj. Lp royaume des Amazones pourrait se retrouver dans les Etats des Natchez et de la Floride, où les femmes avaient la suprématie. On sait, du reste, que le lait n’était pas inconnu aux peuples du Mexique, qui avaient l’habitude de traire les vaches de bisons et les biches privées, et en faisaient du fromage.
(2) Bradford, Amer.Antig.,pag. 233.
(3) Hist. gen. de las Indias, pag. 117. — Bustamante, Annot. ad Sà-hagun. Hist, gen., etc., post. lib. ni, cap. 9.
(4) Bnrgoa, Géogr. descript, ]list, de la prov. 'de Guaxaca, etc., cap. 72, fol. 367, y cap. 75, fol. 390.
(1) Rosny, L'île de Yéso et ses habitants, dans la Revue Amer, et Orient., tom. 1, pag. 177.
(2) Marsden’s Sumatra, p. 424, etc.
(3) Le lieutenant Maury, de la marine des Etats-Unis, bien connu pour les observations qu’il a faites, affirme que des marins japonais ont été souvent entrainés sur les côtes de l’Amérique; j’étais moi-même en Californie en 1850, lorsqu’une jonque japonaise, recueillie à 100 milles de la côte par un navire américain, fut conduite à San-Francisco avec lés hommes qui la montaient.
Si la grande proximité de l’Asie et de l’Amérique appartient à une zone inhospitalière et glacée, sous la latitude du Labrador, de la baie de Hudson, du lac des Esclaves et du fleuve Anadyr, les côtes des deux continents, en avançant vers le sud, se dessinent, dès le parallèle des 60es degrés, dans une direction tellement opposée et en se fuyant pour ainsi dire, que par les 30 degrés de latitude sous le parallèle de Nanking et de la Nouvelle-Orléans, le littoral de la Chine est déjà éloigné de 123 degrés du littoral de la Basse-Californie, c’est-à-dire trois fois autant que l’est l’Afrique de l’Amérique méridionale. C’est là, dit encore ici Humboldt, un des caractères distinctifs de l’océan Pacifique, appelé avec raison le Grand-Océan. Son bassin n’offre pas la forme d’une vallée Iongitudinale à angles saillants 'et rentrants qui se correspondent comme dans celui de l’Atlantique. Depuis le détroit de Behring les côtes opposées s’écartent avec une égale rapidité, celles de l’Asie étant dirigées S.O.-N.E., celles de l’Amérique S.E.-N.O. On dirait que, dans le soulèvement des deux masses continentales, il y ait eu, du côté oriental américain, une connexité de forces qui ait déterminé simultanément les contours des masses du nouveau continent et ceux du vieux monde, tandis que, dans le bassin plus vaste de l’océan Pacifique, des causes plus indépendantes entre elles ont produit des effets entièrement dissemblables. En rattachant des vue§ de géologie ou plutôt de géographie physique aux chances qui se sont présentées aux races humaines d’entrer en rapport les unes avec les autres, il faut encore signaler cette zone d’îles élargie vers l’Asie, qui s’étend de l’est à l’ouest par Juan Fernandez, Salas et Gomez, Pile de Pâques, la métropole de Taïti, les Fidji et les Hébrides, vers la Nouvelle-Calédonie, puis, comme une circonstance bien importante (1) pour les besoins de la navigation, celle d'un courant qui porte entre les parallèles de 35° et de 40° Sud, du méridien de Taïti aux côtes du Chili, dans une direction O.S.O.-E.N.E., et se trouve par conséquent opposé au courant équatorial.
(1) Carte du mouvement des eaux à la surface de la mer dans le grand Océan austral, par l’amiral Duperrey, 1831. Le courant qui porte à l’est-nord-est, vers les côtes de Concepcion et de Valdivia, se divise, en suivant les côtes du Chili, à la fois vers le sud et le nord. C’est un point de partage analogue à ceux que l’on connaît sur les côtes occidentales d’Afrique, entre la baie de Biafra et le cap Lopez, sur les côtes du Brésil, au sud du cap San-Boque (Rennell, Invest, of the Currents of the Atlant. Ocean, 1832, pag. 136 et 288). La branche septentrionale du courant de Chili est celle dont M. de Humboldt a fait connaître l’abaissement extraordinaire de température. Le thermomètre centigrade marque dans le courant 15° 7, et hors du courant, 26° 4 à 29° 7 (Relation historique, tom. m, pag. 508).Comme le mouvement partiel des eaux, dans l’océan Pacifique, a exercé une influence marquante sur la distribution d’une même race d’hommes et la filiation des idiomes (dialectes), M. de Humboldt rappelle encore ici l’existence des courants vers le nord-est, I observés quelquefois dans la région tropicale, même sur la limite des vents alizés du sud-est et du nord-est (Beechey, tom. 11, pag. 676. — Moyen, Rei'se um die Erde auf der Princessin Luise, 1835, torn. 11, pag. 84-88).
Si de l’océan Pacifique nous passons à l’autre, on remarquera que dans la vallée longitudinale de l’Atlantique, l’ancien continent s’approche deux fois et presque à la même distance (de 510 à 542 lieues marines) des côtes du continent américain. La vallée a le minimum de largeur, dans une direction S.S.O.-N.N.E.,près de l’équateur, entre l’Afrique et le Brésil. Du cap Roxo (entre l’embouchure de la Gambie et les Bissagos) au cap San-Roque, il n’y a que dix lieues marines de moins que de ce dernier cap à Sierra-Leone (1). En Europe, c’est l’Irlande occidentale qui, dans le promontoire entre Tralee et Dingle-Bay, avoisine le plus l’extrémité S.E. du Labrador, un peu au nord de Terre-Neuve. L’Atlantique n’a, sous ce parallèle (et les. deux points ont à 9’ près la même latitude), qu’une largeur de 542 lieues (2). La différence des largeurs entre l’Europe et l’Amérique continentale du nord, entre la Guinée et l’Amérique du Sud, n’est donc, malgré l’accroissement de plus de 40 degrés de latitude, que de 94 milles de soixante au degré équatorial. Ces rapports de proximité des deux mondes changent considérablement, lorsqu’on considère comme partie de l’Amérique la vaste, île du Groenland, dont le prolongement vers le nord-ouest, au delà de la mer de Baffin et du détroit de Barrow, commence à peine à être connu. En effet cette contrée septentrionale semble être une dépendance naturelle du continent occidental, d’après l’identité de direction (S.O.-N.O.) de ses côtes orientales, depuis la Géorgie jusqu’à la terre d’Edam, des 30 aux 77 degrés 1/2 de latitude. Le Groenland oriental, dans les terres de Scoresby, s’approche tellement de la péninsule Scandinave et du nord de l’Ecosse, que de cette dernière au cap Barclay (1° 1/2 au sud du parallèle de l’île volcanique de Jan Mayen) il n’y a que 269 lieues marines (1), ce qui est à peu près la moitié de la largeur de l'Atlantique entre l’Afrique et le Brésil. Par un vent frais et continu de N.O. on franchirait cet espace en moins de quatre jours.
(1) En calculant dans l'hypothèse de la terre sphérique, il y a du cap San Roque (latitude 5° 28' '17" austr. ; longitude, 37° 37' 26") au cap Roxo (latitude, 12° 20' nord; longitude, 19° 14'), 1531, 2 milles nautiques. Du cap San Roque à Sierra-Leone (latitude, 8° 20' 55" bor. ; longitude, 15° 39' 24"), 1558, 7 milles (Humboldt, Essai sur l'hist. de la géogr. du N. Continent, tom. ii, pag. 74, note 1). (2) Du promontoire d'Irlande au sud de Tralee (lat., 52° 20'; long., 12° 40') au cap Charles du Labrador (lat., 52° 11'; long., 57° 40), 1025, 7 milles (ld. ibid., n. 2).
Le rapprochement de toutes les masses continentales vers le cercle polaire arctique et au delà se révèle aussi, comme le prouvent les recherches les plus exactes sur la géographie des plantes, dans le grand nombre des végétaux propres à l’Europe, à l’Asie et à l'Amérique boréale (2). L’Amérique du Sud et, en général, toute la portion tropicale du nouveau monde, porte un caractère différent. La grande ־loi de la nature reconnue par Buffon dans la disparité de la création animale qui est propre à ces régions et à l’Afrique peut s’appliquer, sous de certaines restrictions, au règne végétal. Les exceptions à la loi sont rares, mais elles existent, non-seulement dans les plantes monocotylédones, surtout dans les familles des graminées et des cypéracées (3), mais encore dans les dicotylédonées en arbres et qui ne sont pas des espèces littorales ou aquatiques (4).
(1) Cap Wreath (extrémité nord-ouest de l’Ecosse),lat. 58° 39"; long., 7° 18״. — Cap Barclay, au sud dé la. baie de Scoresby, lat., 69° 10"; long., 26° 4׳. Distance, 807 milles nautiques (Id. ibid.).
(2) Les bruyères que l’on croyait manquer à toute l’Amérique, comme au nord-est delà Sibérie, ont été trouvées dans l’intérieur de l’île de Terre-Neuve.
(3) Humboldt, De dist. geogr. plant, secundttm coeli temperiem et altit. montium, 1817, pag. 61-67.
(4) Comme Avicennia tormentosa, Suriana maritima, Jussiena erec-ta, etc., etc. Il est bien remarquable sans doute, ajoute ici l’illustre écrivain, que, d’après les travaux de M. Robert Brown sur la flore du Congo, et, d’après les discussions de MM. Perrottet et Guillemin sur la flore du cap Vert et dela Sénégambie, ce soient princi-paiement les côtes africaines et celles du Brésil et de la Guiane qui offrent ces analogies avec l’Afrique équinoxiale. H suffit de citer des espèces du Rio-Zabir et du Sénégal, dont les noms spécifiques mêmes indiquent le lieu où les voyageurs botanistes les ont recueillies pour la première fois : Schwenkia, americana, Urena americana, Cassia occidentalis, Ximenia americana, Waltheria americana, qui est identique avec le Waltheria indica. D’autres exemples de dicotylédonées communes aux côtes équinoxiales d’Afrique et d’Amérique sont : Sida juncea, Pterocarpus lunatus, OEschinomene sensitiva, Scoparita dulcis et le Dodonœa viscosa, que j’ai recueillies, continue Humboldt, au Mexique, sur le plateau de Guauaxualo et sur 1rs collines de ponces agglomérées près du Rio Mayo, dans le chemin de Po-payan à Paslo, tandis que M. Perrot-tel l’a trouvé au Sénégal (Essai sur l’hist. de la ge'ogr. du nouveau continent, tom. 11, pag. 77.—Robert Brown, Remarks on the botany of the Congo river, pag. 57. — Perrottet, Guillemin et Richard, Flore de la Sénégambie pag. 18, 41, 73).
Les courants portent du Congo à l’ouest vers le Brésil, tandis que, à l’embouchure du Sénégal et au delà jusqu’à la baie de Biafra, le mouvement des eaux est au S. et au S. E., par conséquent entièrement contraire au transport de fruits et de graines aux côtes américaines. Ce que nous savons de l’action délétère qu’exerce l’eau de mer dans un trajet de cinq ou six cents lieues sur l’excitabilité germinative de la plupart des graines n’est, d’ailleurs, pas en faveur du système trop généralisé sur la migration des végétaux au moyen de courants pélagiques. Nous ne saurions terminer cet aperçu de la grande vallée atlantique, au point où elle offre le moins de largeur entre des masses de terre entièrement continentales, sans ajouter aux traits du tableau physique l’indication d’un petit nombre de faits, généralement négligés par les historiens modernes de l’Amérique, mais que l’éminent écrivain que nous suivons dans cette partie de nos études a recueillis pour expliquer comment des causes, peu importantes en apparence, ont pu servir à Christophe Colomb pour lui inspirer une si grande confiance dans son premier voyage vers le nouveau continent encore inconnu.
Vents et courants entre l’Afrique ou l’Europe et l’Amérique. Exemples tirés des anciens. Voyages des Irlandais, des Normands en Islande et en Amérique. Recherche du paradis terrestre. Rêves des voyageurs à ce sujet. Légendes du moyen âge.
Dans l’état moyen des mouvements de l’Atlantique, les fleuves pélagiques, que nous distinguons sous les noms un peu vagues de Gulf-Stream, de courant équinoxial, de courants du golfe de Guinée, des côtes du Brésil et d’Afrique méridionale, sont séparés par des eaux tranquilles. ou stagnantes qui n’obéissent qu’à l'impulsion locale des vents ; mais par la réunion fortuite des causes météorologiques, quelquefois très-éloignées, les fleuves pélagiques s’élargissent ou se prolongent, en inondant pour ainsi dire des espaces de mer dépourvus de mouvements de translation propre. Alors les courants de différentes dénominations communiquent temporairement entre eux et produisent des phénomènes qui ont dû surprendre à une époque où la géographie physique du bassin de l’Atlantique était moins avancée. On lit, dans une Histoire des îles Canaries, de George Glas, imprimée en 1764׳, que, peu d’années avant la date de cette publication, un petit bâtiment chargé de blé et destiné à passer de Lancerote à la rade de Santa-Cruz de Ténériffe, fut poussé au large par une tempête qui l’empêcha de regagner le groupe des îles d’où il s’était éloigné. Emporté vers l’ouest par le courant équinoxial et les vents alizés, il se vit, à deux journées de distance de la côte de Vénézuela, hélé par un navire anglais, qui s’empressa de porter secours aux Canariens qui avaient survécu, et les amena au port de la Guaira (1). En 1731, un accident analogue arriva à un bateau chargé de vin qui faisait route de Ténériffe à la Gomera. Après avoir, durant plusieurs jours, lutté contre les vents contraires, il aborda avec six matelots à l’île de Trinidad, où la foule avide accourut pour le voir (2).
(1) Glas, History of the discovery and conquest of the Canary lslands, part. v. —Vieira, hist. gen. de las islas Canarias, tom. n, page 167. (2) Gumilla, Orinoco Ilusirado , cap. 31.
La communication établie entre le courant de l’Afrique septentrionale, dirigé vers le sud, et le courant équinoxial, dirigé vers l’ouest, agissait ici dans un sens diamétralement opposé à celui qui, du temps de Colomb, transporta un morceau de bois artistement sculpté, et que Martin Vicente, pilote du roi de Portugal, lui dit avoir trouvé à plus de quatre cents lieues du cap Saint-Vincent. Pedro Correa, beau-frère du grand navigateur, racontait avoir tiré de l’eau, près de l’île de Madère, un morceau de bois en tout semblable, ajoutant qu’il avait entendu, de la bouche même du roi, qu’on avait recueilli dans ces parages de gros bambous qui, d’un nœud à l’autre, pouvaient mesurer neuf garrafas de vin (1). Les habitants des Açores disaient que lorsque le vent soufflait de l’ouest, la mer portait sur la plage, principalement à Graciosa et à Fayal, des pins d’une espèce étrange; d’autres joignaient qu’on trouva un jour, sur les sables de^l’île de Florès, deux cadavres d’hommes, dont la large face et la physionomie, tout autre que celle des chrétiens, indiquaient une race étrangère. Une autre fois on vit deux canots ou almadies, à couvert mobile, remplies d’hommes dont on n’avait jamais ouï parler, et qui, chassés par le vent, passèrent d’une île à l’autre (2).
(1) Herrera, Hist, general, decad. 1, lib. I, cap. 2. L’historien des Canaries, Vieira, raconte qu’à plusieurs reprises, des fruits et des grains, provenant d’arbres indigènes aux Antilles, ont été jetés par la nier sur le rivage des îles de Fer et de la Gomera. Avant la découverte de l’Amérique, les Canariens regardaient ces fruits des tropiques comme provenant de l’île de St-Brandan. Rien ne prouve mieux les ramifications temporaires des fleuves pélagiques que le phénomène du transport de productions végétales des Antilles aux côtes de Norwége, des Hébrides, d’Irlande et des Canaries.
(2) Herrera, Hist. gen.,‘dec. I, lib. 1, cap. 2. Ces larges faces d’hommes morts rappellent celles des Mayas d’Yucatan. Un bateau à couvert mobile, et probablement dans le genre de ceux qui se virent aux Açores, fut arrêté par Colomb sur la côte du Honduras; c’était une grande barque qui marchait à voile et à rames, et contenant vingt-cinq Indiens d’Yucatan (Herrera, Hist, gen., dec. 1, lib. v, cap. 5. .— Cogolludo, Hist, de Yucatan, lib. I, cap. 1).
Le transport de ces objets, bambous, troncs de pins, cadavres humains, bateaux remplis d’hommes vivants à faces étrangères, rejetés par les flots sur la plage des Açores, est attribué par Herrera à l’action des vents d’ouest. Mais cette explication ne serait pas suffisante Aujourd’hui : la véritable cause de ce phénomène ne peut être que le grand courant d’eau chaude, connu des marins sous le nom de Gulf-Stream (3). Le vents d’ouest et du nord-ouest contribuent simplement à augmenter la vitesse moyenne de ce fleuve pélagique, à prolonger son action vers l’est, jusqu’au golfe de Biscaye, et à mêler les eaux du Gulf-Stream à celle des courants du détroit de Davis et de l’Afrique septentrionale (4). Le même mouvement océanique vers l’ouest qui portait, dans le quinzième siècle, les bambous et les pins sur le littoral des Açores, dépose annuellement en Irlande, aux Hébrides et en Norwége des graines de plantes tropicales (1), quelquefois même des tonneaux de vin de France, parfaitement conservés, épaves de navi-res qui ont fait naufrage aux Antilles. Des barils remplis d’huile de palmier, faisant partie d’un chargement de navires anglais naufragés au cap Lopez, sur les côtes d’Afrique, ont été recueillis en Ecosse, après qu’ils eurent traversé deux fois l’Atlantique, ־ une fois de l’est à l’ouest, entre le 2e et le 12e degré de latitude, à la faveur du courant équatorial ; une autre fois de l’ouest à l’est, au moyen du Gulf-Stream, par les 45e et 55e degrés de latitude. Par les temps calmes, ce dernier courant, venant du cap Hatteras, se termine sous le méridien de la grande bande de Sargasso (Fucus natans), qui est placée un peu à l’ouest de Corvo; mais dès que les vents d’ouest commencent à dominer, ou que, par d’au-très causes météorologiques, le courant élève le niveau des eaux dans le golfe du Mexique ou dans le canal de Bahama, les îles Corvo ou Florès se trouvent enveloppées par le Gulf-Stream, qui se partage alors en deux branches, dont l’une se porte vers le nord-est, et l’autre sur le sud et le sud-est (2).
(3) Humboldt,Relation hist.,tom. 1, page 71.
(4) Rennell, Investig. of the Currents of the Atlant. Ocean., page 20.
(1) Le Mimosa scandens, Guilandina bonduc, Dolichos urens.
(2) Voir le témoignage de M. Boid (Description of the Azores, page 96). Au commencement de son voyage en Amérique, Humboldt lui-même dit avoir vu la preuve que, de temps en temps, le Gulf-Stream des Açores communique avec le Courant de Guinée ou du nord de l’Afrique, la mer ayant alors porté׳ sur la rade de Santa-Cruz un tronc de Cedrela odorata, couvert d’écorce et de lichens, arbre américain qui ne peut être confondu avec aucun autre, et qui, sans doute, avait été arraché de la côte du Paria ou du Honduras.
L’histoire, tant ancienne que moderne, signale d’ailleurs un grand nombre de faits analogues à celui des objets transportés aux Açores, et qui durent faire une si forte impression sur l’esprit observateur de Colomb. On sait que des Groënlandais ont été poussés souvent par les courants et les vents du nord-est vers les Orcades ; en 1682, on en vit un à la pointe méridionale de l’île d’Eda, qui se déroba aux poursuites lorsqu’on chercha à le prendre. Dans l’église de l’île de Burra, on conserve un canot des Esquimaux, arrivé par une tempête (3). Dans l’histoire de Venise de Bembo (1), on trouve l’exemple d’un bateau rempli d’indigènes américains, rencontré en 1508 par un vaisseau français qui naviguait dans l'Océan, non loin des côtes d’Angleterre. D’autres exemples de translations involontaires ont été souvent cités à l'occasion d’un morceau célèbre des fragments historiques de Cornelius Nepos (2), sur lequel la recherche d’un passage au nord-ouest, dans la navigation de l’Inde, avait gravement fixé l'attention publique au moyen âge.
(3) Wallace, An account of the Is-lands of Orkney, 1700, page 60.
(1) Bembo, Hist. Ven., lib. vu , page 257.'
(2) Bosius, In Corn. Nep. Fragm., torn, ii, page 356. — Pline, 11, 67. « Idem Nepos de septentrionali circuitu tradit, Quinto Metello Celeri, L. Afranii (sic Jul. Sillig. C. Afranii Sal-mant.) in consulatu collegæ, sed tum Galliæ proconsuli, Indos a rege Sue-vorum (ita omnes Plinii Cod.·) dono datos, qui ex India commercii causa navigantes tempestatibus essent in Germaniam abrepti. « — Pomp. Mela, lib. in , cap. 5, § S : « Ultra Caspium sinum quidnam esset, ambiguum ali-quandiu fuit; idemnc Oceanus, an Tellus infesta frigoribus, sine ambitu ac sine fine projecta. Sed praeter physicos, Homerumque, qui universum orbem circumfusum esse dixerunt, Cornelius Nepos, ut recentior, ita auctoritate certior; testem autem rei Q. Metellum Celerem adjicit, eumque iia retulisse commemorat: Cum Galliæ pro consule praeesset, Indos quondam a rege Boiorum (Bolorum, Boetorum, Gelorum , inepte Lydorum., Codd.) dono sibi datos ; unde in eas terras devenissent, requirendo cognosse , vi tempestatum ex Indicis aequoribus abreptos, emensosque, quae intererant, tandem in Germaniae littora exiisse. »
Humboldt, commentant ce passage, ajoute : « Pomponius Mela, qui vivait à une époque assez rapprochée du temps de Cornelius Nepos, raconte, et Pline répète, que Metellus Celer, tandis qu’il était proconsul dans les Gaules, avait reçu en cadeau, d’un roi des Boii ou Boeti (le nom est assez incertain), et Pline le nomme roi des Suèves (3), quelques Indiens qui, chassés des mers de l’Inde par des tempêtes, avaient abordé sur les côtes de la Germanie. Il est inutile de discuter ici si Metellus Celer est le même qui fut préteur de Rome l’année du consulat de Cicéron, et dans la suite consul avec L. Afranius, ou si le roi germain était Arioviste vaincu par Jules César. Ce qui est hors de doute, par la liaison des idées qui conduisent Mêla à citer le fait, regardé comme certain, c’est que l’on croyait alors à Rome que ces hommes basanés, envoyés de la Germanie dans les Gaules, étaient venus par l'Océan qui baigne l’est et le nord de l’Asie, en faisant le tour du continent au delà de l’embouchure de la mer Caspienne. Une telle supposition était entièrement conforme aux idées géographiques de cette époque, c’est-à-dire aux fausses idées que, depuis l’expédition d’Alexandre, on se formait sur la communication de la mer Caspienne avec l'Océan septentrional, et que l’on substituait malencontreusement à celles qu’Hérodote avait recueillies à Olbia et sur les bords de l’Hypanis (1).
(3) C’est à tort que Pelloutier fait dire à Pomponius Mela : Sueiorum rex. Aucun manuscrit de Pomponius Mela n’a la leçon Suevorum ( Voir Tzchukke, Ad Mel., vol. Il, part, ni, page 147).
(1) Humboldt,־ Essai sur l’hist. de la géogr. du N. Continent, tom, ii, page 264, note 2.
« La mer Baltique était encore, du temps de Ptolémée, une mer ouverte à l’est ; la péninsule scandinavienne était une île qui n’empêchait pas de naviguer vers l’est, à partir de l’extrémité de la Chersonèse cimbrique et de l’ile Scandia. « Ces bouches sont, selon Strabon, le point le plus septentrional de la côte qui s’étend de là jusqu’à l’Inde, et auxquelles on ne peut arriver de ce pays par mer, comme l’atteste Patrocle, qui commanda dans ces contrées. » Dans un autre endroit, Strabon revient sur cette possibilité. « Le fait, dit-il, que certains navigateurs se soient rendus par mer, de l’Inde dans l'Hyrcanie, n’est pas regardé comme certain, mais que cela soit possible, Patrocle nous l'assure. » Strabon qui, en général, consultait peu les auteurs latins, n’avait donc aucune connaissance de ce prétendu voyage des négociants indiens amenés dans les Gaules. Pline, souvent très-inexact dans les notes qu’il recueillait presque en courant (adnotabat et quidem cursim, dit son neveu), convertit la conjecture de Patrocle en un fait circonstancié (2). Les idées géographiques ayant changé toutes ces théories, surtout depuis la découverte de l’Amérique, « on a soulevé la question de savoir de quelle race peuvent avoir été les hommes de' couleur que le proconsul Metellus Celer a pris pour des Indiens. La supposition que ces hommes étaient des pêcheurs esquimaux du Labrador et du Groenland, jetés par les vents du nord-ouest sur les côtes britanniques, remonte jusqu’à la première moitié du xvie siècle. L’analogie du fait non contesté de l’arrivée de Groënlandais aux îles Orcades, semble jeter une vive lumière sur celui que nous examinons ici ; et quand on considère les nombreux exemples d’individus tombés entre les mains de barbares et traînés comme captifs de nation à nation, loin du lieu du naufrage, on trouve moins surprenant que des étrangers aient été conduits dans les Gaules, en passant des îles Britanniques en Batavie et en Germanie : mais ce qui est bien étrange, c’est que dans des événements semblables, et également énigmatiques, du moyen âge, il ne soit toujours question que des côtes germaniques. »
(2) Il existe au musée du Louvre un buste en bronze antique, présentant des caractères de tête fort analogues à ceux des indigènes de l’Amérique, et un savant de grand mérite, M. Egger, croit y avoir reconnu un des Indiens dont parle Pline, et dont la tète aurait été moulée alors.
En rapprochant ces faits de ceux qui concernent la découverte de l’Amérique, dans les temps antérieurs à Colomb, il est intéressant de remarquer que les premières notions que nous en donne aujourd’hui l’histoire, sont dues à des populations septentrionales ou d’origine germanique. Deux circonstances ont pu favoriser cette découverte qui coïncide avec le dixième siècle de notre ère. La première appartient encore à la géographie physique. Entre les parallèles de 58° 1/2 et de 64°, le canal de l’Atlantique, déjà très-rétréci, est parsemé de plusieurs groupes d’îles, les Orcades, les Fœroé, l’Islande, qui offrent comme une série de stations intermédiaires, et conduisent, par d’autres soulèvements volcaniques, aux côtes de l’Amérique insulaire du nord. La seconde circonstance favorable tient à l’activité et à l’esprit d’entreprise des peuples de l’Europe qui avoisinaient, au moyen âge (1), cette même région d’une mer boréale couverte d’îles, théâtre de leurs exploits. C’est à la réunion de ces causes physiques et morales qu’est due la découverte du continent occidental par les Scandinaves.
(1) Le précieux ouvrage du moine Dicuil, De mensura orbis terrœ, dont nous devons (et seulement depuis 1807) l’édition princeps à M. Walckenaer, est devenu d’une haute importance pour éclairer l’histoire de ces diverses expéditions. Voir Humboldt, Essai, etc., tom. 11, page 88.
Les Normands et les Arabes sont les seules nations qui, jusqu’au douzième siècle, aient partagé la gloire des grandes expéditions maritimes, le goût des aventures étranges, la passion du pillage et des conquêtes éphémères. L’histoire nous dit que les Normands ont successivement occupé l’Islande et la Neustrie, ravagé les sanctuaires de l’Italie, conquis la Pouille sur les Grecs et la Sicile sur les Sarrasins. Ce qu’elle n’a pas encore été à même de révéler, ce sont leurs expéditions en Amérique, avant le temps assigné à leurs voyages par les Sagas, ce sont les bouleversements que cette race turbulente et inquiète a dû causer dans des royaumes, dont on commence à peine à connaître les noms et dont l’existence remonte à une haute antiquité.
Si l’on veut suivre avec précision la série des faits qui ont conduit aux côtes boréales de l’Amérique, il ne faut pas oublier que, dans les îles placées entre l’Ecosse, la Norwége et le Groenland, les expéditions des missionnaires irlandais ont rivalisé avec celles des Normands; Dans le nord de l'Europe, des anachorètes chrétiens, comme dans l'intérieur de l’Asie des religieux buddhistes, ont exploré et mis en rapport de civilisation les contrées les plus inaccessibles. L’esprit de propagande et le désir de répandre des croyances religieuses ont également préparé les voies aux invasions hostiles, comme à l’échange paisible des idées et des productions. Cette ferveur propre aux religions de l’Inde, de la Palestine et de l’Arabie, si différente du polythéisme des Grecs et des Romains, a donné une physionomie particulière aux progrès de la géographie dans la première moitié du moyen âge. En corn-mentant deux passages importants de Dicuil (1), Letronne a prouvé d’une manière également ingénieuse et satisfaisante que les îles Fœroé, habitées depuis une centaine d’années par des ermites sortis de Scottia (2), furent abandonnées par eux, dès l’an 725, époque de la première invasion des Scandinaves dans les îles Britanniques ; et que l’Islande a été visitée, peut-être même colonisée parles Irlandais en 795, c’est-à-dire soixante-cinq ans avant qu’elle le fût par les Scandinaves. Le Landnamabok, publié de nouveau dans une collection de Sagas historiques (1), rapporte textuellement que les Norwégiens trouvèrent en Islande des livres irlandais, des sonnettes et .d’autres objets que les Papœ (Papar), hommes d’occident qui professaient la religion chrétienne, y avaient laissés, surtout dans les deux cantons de Papeya et Papyli, sur la côte orientale.» Or il est constant, d’après les Sagas des Orcades (2), que ces îles étaient habitées vers la fin du neuvième siècle par deux nations, les Peti, probablement descendants des Pictes, et les Papœ (3). D’après Snorro Sturlœson, l’Ecosse même portait le nom de Pettoland.
(1 ) Recherches géographiques et cri tiques sur le livre De mensura orbis terrœ, !8l4,pag. 129-I46.
(2) L'Irlande porta le nom de Scot tia jusqu'au règne de Malcolm II.
(1) Voir l,Histoire d'Islande dans le Islendenga-Sagur, l,Histoire des îles Fœroé dans le Fœreyinga-Saga.
(2) Lettonne, Additions, etc., pag. 90-93. On peut faire un rapprochement fort curieux entre ce nom de Papœ ou Papar et le même litre donné en plusieurs provinces mexicaines aux prêtres du pays. On appe-lait aussi Papahua-Tlamacazque les anciens prêtres du soleil à Teotihuacan. Faudrait-il attribuer à d’anciens moines irlandais les traces de christianisme et de staurolâtrie qu’on a rencontrées depuis dans les religions américaines?
Les îles Fœroé et l’Islande devinrent des stations intermédiaires, des points de départ pour arriver à la Scandinavie américaine. C’est ainsi que l'établissement de Carthage servit aux Tyriens pour atteindre le détroit de Gadira et le port de Tartessus, et que Tartessus conduisit ce peuple navigateur de station en station jusqu’à Cerné, le Gauléon (île des vaisseaux) des Carthaginois. Lorsqu’on ne peut suivre une même côte, l’agroupement et le voisinage des îles déterminent souvent la direction de découvertes géographiques. Celles des Scandinaves ont été exposées si souvent en diverses langues, depuis quelques années, et si victorieusement démontrées par les travaux de la Société royale des Antiquaires de Copenhague, qu’il serait superflu de les reproduire ici de nouveau (4). Il suffit de rappeler que l’Islande, visitée, après les moi-nés irlandais, par les Peti, et par le pirate Naddoc, vers l’an 860, ne reçut de colonie norwégienne stable qu’en 874 et que la véritable colonisation du Groenland ne remonte pas au delà de 986. On place à quelques années plus tard la découverte du Vinland, qui paraît avoir été la même région que la Nouvelle-Angleterre ; mais quoique les Scandinaves aient poussé leurs explorations au sud des Etats-Unis, aussi loin que la Caroline du Nord, les stations principales de ces intrépides navigateurs auraient été à l’embouchure du Saint-Laurent, surtout dans la baie de Gaspé, en face de l’île d’Anticosti, où l’abondance et la facilité de la pêche pouvaient les attirer.
(3) Papœ, pères, prêtres, religieux, probablement les clerici de Dicuil. Olassen et Povelsen affirment déjà que le Bygde Papyle, dans le Horne-fiord, porte ce nom à cause des Papar, premiers prêtres irlandais (Reisc durch Island, tom. 11, page 124).
(4) Antiquitates americanœ sive scriptores septentrionales rerum ante-columbianarum in America, etc. Hafniæ, 1837. M. Beauvois a donné de ces écrivains et dès Sagas islandaises plusieurs analyses fort intéressantes dans divers articles qu’il a publiés dans la Revue orientale et américaine de 1858.
En examinant le concours de faits qui tendent à éclaircir la question d’une communication ancienne de l’Europe au continent américain, on ne saurait se mettre trop en garde contre les systèmes et les théories que cette matière féconde a enfantés, depuis trois siècles, ou renouvelés d’après les rêveries du moyen âge et des temps antérieurs : le devoir de l’historien impartial n’est pas cependant de repousser entièrement ces idées, mais de les réduire à leur juste valeur par une saine critique, en cherchant à découvrir les vérités qu’elles pouvaient cacher. Par la liaison intime qui existe entre tout ce qui tombe sous l’empire de l’intelligence, les erreurs mêmes des âges éloignés ont coopéré souvent à la recherche de la vérité. Lorsque Colomb, l'imagination remplie d’idées bibliques, parlait de la côte du Paria, qu’il venait de découvrir, comme du site du Paradis terrestre, où il avait trouvé les richesses du pays montagneux d’Ophir (1), ces idées, au lieu d’être le reflet d’une fausse érudition, étaient le résultat d’un système compliqué de cosmologie chrétienne, exposé par les Pères de l'Eglise et qu’on retrouve avec étonnement dans les traditions même des peuples américains. «Ceux qui placèrent le Paradis dans notre terre habitable, dit Letronne (2), supposèrent qu’il en occupait la partie la plus orientale; ils se fondaient sur l’expression des Septante : «Dieu avait planté vers l’orient un jardin délicieux. » C’est en conséquence de ce texte que Josèphe et les premiers Pères grecs s’accordèrent à mettre le Paradis vers les sources de l'Indus et du Gange. Cette opinion devint générale dans tout le moyen âge. On la retrouve dans l’anonyme de Ravenne, elle est clairement exprimée dans la carte d’André Bianco ; et c’est par suite de cette idée si répandue que Christophe Colomb, parvenu sur la côte de l’Amérique méridionale, crut toucher au Paradis terrestre (1). » Mais par suite de la difficulté qu’il y avait à découvrir le site du Paradis dans les régions connues de l’Asie, «on. fit revivre, continue Letronne (2), l'antichtone ou terre opposée des anciens, située dans la zone australe. Cette notion, qui se lie à celle des zones, des terres océaniennes et des antipodes par des rapports curieux à observer ; cette notion, dis-je, de l'antichtone, fut toujours, au moins depuis Platon, distinguée de celle des îles plus ou moins éloignées qu’on supposait répandues dans l'Océan. La grande terre méridionale, proprement l'antichtone, habitable comme la nôtre, dont elle est séparée par l'Océan, est admise par Aristote et Eratosthène ; Virgile, dans les Géorgiques, n’a fait que Traduire les vers de l’Hermès du philosophe alexandrin..... Mais ceux qui plaçaient le Paradis dans l’antichtone, pour expliquer comment il était resté inconnu depuis le déluge, n’auraient pas beaucoup gagné à cette hypothèse, s’ils n’avaient pas en même temps supposé innavigable la mer qui séparait cette terre de la nôtre. C’est à quoi Cosmas (Indicopleustes) a pris soin de pourvoir. Et encore ici il n’a été que l’écho d’une des opinions les plus anciennes parmi les géographes grecs.
(1) Navarrete , Colec. de documentos, etc., tom. 1, pag. 70 et 244.
(2) Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions, etc., en 1826. Voir aussi Humboldt, Essai sur Îhist. dè là yébgr. du N. Continent, Tom. 111, page 119.
(1) Conf. Lud. Vives Ad S. Aug. de Civitate Dei, tom. 11, page 50, dans le savant Mémoire de Letronne.
(2) Ibid.
» Car une fois que l’existence des terres hyperocéaniennes eut été admise, il fallut trouver une cause qui empêchait les navigateurs d’y parvenir. Voss croit que les Phéniciens avaient beaucoup contribué à répandre cette opinion, pour détourner les navigateurs des autres nations de suivre leurs traces. Cela se peut. Mais ce qui est certain c’est qu’on voit cette opinion se montrer à presque toutes les époques. Déjà Sésostris, dans les navigations lointaines, avait été arrêté par les bas-fonds de l'Océan extérieur-Selon Pindare, la mer est innavigable au delà des Colonnes; Euripide le dit également... Une notion aussi répandue chez les savants du paganisme ne pouvait manquer d’être adoptée par ceux des Pères qui croyaient en avoir besoin pour lever certaines difficultés d’interprétation. Saint Clément de Rome, au dire d’Origène et de Clément d’Alexandrie, croyait qu’il existait un Océan impossible à traverser au delà duquel il y avait d’autres mondes ! etc. Ainsi, comme on le voit, l’opinion que nous a transmise Cosmas, ainsi que beaucoup d’autres des Pères de l'Eglise que j’ai expliquées ailleurs, avait sa racine dans des hypothèses fort anciennes, fort répandues, presque populaires, et qui devaient leur paraître tout à fait raisonnables et concluantes (1). »
(1) Letronne, ibid.
On voit donc par les éclaircissements qui précèdent comment l’idée du site du Paradis terrestre avait pris naissance dans l’esprit de Colomb : « II en résulte, ajoute l’amiral lui-même, dans une de ses־ lettres, que les saints théologiens et les philosophes ont eu raison de dire que le Paradis terrestre est situé à l’extrémité de l’orient, parce que c’est un lieu fort tempéré, et les terres que je viens de découvrir (les grandes Antilles) forment cette fin de l’orient. » Il répète encore une fois à la fin de sa lettre de 1498 : « J’ai dans l’esprit l’assurance que là (dans ces terres de Paria nouvellement découvertes) est le Paradis terrestre, » celui que saint Isidore, Beda, Strabon et saint Ambroise placèrent en orient (2). Humboldt, commentant à ce sujet le poëme admirable du Dante, ajoute avec lui que « au-dessus des eaux se montre la montagne du Purgatoire, couronnée par le Paradis des bienheureux, qui est aussi la montagna bruna vers laquelle Ulysse navigua d’abord de l’est à l’ouest, dietro al sol, et puis au sud, « vers l’hémisphère sans habitants; » et l’on peut être surpris, ajoute-t-il (1), qu’un commentateur si ingénieux que M. Ginguené ait pu reconnaître dans cette montagne le Pic de Ténériffe. »
(2) Navarrete, Colec. de document., tom. 1, page 244.
(1) Essai sur l'hist. de la géographie, etc., tom. 111, page 134. Comment, dit-il, □ne navigation de cinq mois, dans laquelle on contemple les stelle del altro polo, et où l’on voit s’abaisser jusqu’à l’horizon la constellation de la Grande-Ourse, pourrait-elle ne pas conduire plus loin qu’aux îles Canaries?
Ainsi que nous le remarquions plus haut, ces idées se retrouvent partout dans les traditions de l’Amérique ancienne comme dans celles du vieux monde. Sahagun, parlant des premières tribus de la race nahuatl, dit de son côté (2) : « De l’origine de cette » nation, la relation qu’en donnent les anciens est qu’ils vinrent » par mer du côté du nord, et il est certain qu’il vint quelques » vaisseaux ; de manière toutefois qu’on ne sait comment ils » étaient travaillés, sinon qu’on conjecture par une idée qu’ils » ont que tous ces naturels sortirent de sept grottes, et que ces » sept grottes sont les sept navires ou galères dans lesquelles vinrent les premiers qui peuplèrent cette terre, selon des conjectures fort vraisemblables. Ces gens vinrent d’abord peupler, » cette terre du côté de la Floride; ils vinrent en côtoyant et » débarquèrent au port de Panuco, qu’ils appellent Panco (3), ce » qui veut dire lieu où arrivèrent ceux qui passèrent l’eau. Ces » gens venaient à la recherche du Paradis terrestre et avaient » pour nom Tamoanchan, ce qui veut dire cherchons notre de» meure, et ils s’établirent auprès des plus hautes montagnes » qu’ils trouvèrent (4), En venant vers le sud, à chercher le Paradis terrestre, ils ne se trompaient certainement point,parce que » c’est l’opinion de ceux qui savent, qu’il est situé sous la ligne » équinoxiale : et en pensant que ce devait être quelque très» haute montagne, ils ne se trompaient pas davantage, parce que, » ainsi le disent les écrivains, que le Paradis terrestre est sous la » ligne équinoxiale et que c’est une montagne fort élevée dont la » cime touche presque à la lune. Il paraît que ces gens ou leurs » ancêtres eurent quelque oracle sur cette matière, ou de Dieu ou » du démon, ou par une tradition des anciens qui de main en » main arriva jusqu’à eux. »
(2) Hist. gen. de las cosas de Nueva-Espana, Prolog., page xviii.
(3) Panuco, aujourd’hui village sur la rivière du même nom, l’un des affluents du fleuve qui se décharge au port de Tampico, dans le golfe du Mexique, et situé à huit ou neuf lieues dans l’intérieur, au-dessus de cette ville.
(4) D’après le même Sahagun (lib.x, cap. 29), ces tribus s’établirent au lieu qu’elles appelèrent Tamoanchan, au pied des montagnes qui s’élèvent vers les frontières guatémaliennes, c’est-à-dire de la chaîne des monts de Tumbala, qui couvre lés abords des ruines de Palenqué. Des allusions ont lieu fréquemment encore sur une sorte de paradis terrestre, et les commenta-leurs des livres mexicains ont cru en voir la trace dans le Tlallocan, l'Omeyocan et le Tonacatepetl, dont nous parlerons plus loin.
Voilà comme on retrouve jusque chez les Américains eux-mêmes ces traditions d’un monde idéal, et aujourd’hui ils ne les ont pas encore perdues. Il est si naturel à l’homme de rêver quelque chose au delà de l’horizon visible, de supposer, en voyant la vaste étendue de l'Océan, d’autres îles, d’autres continents semblables à celui qu’il habite. Dans l’Atlantique, les groupes des Canaries et des îles Britanniques dirigeaient de préférence l’imagination Vers de certains parages. On se plaisait à multiplier conjecturalement ce que l’on ne connaissait que d’une manière confuse. Au sud-ouest des colonnes d’Hercule, la difficulté de saisir avec précision le vrai nombre et la position relative des îles Fortunées donnait lieu à de vagues fictions. L'Aprositos de Ptolémée ne justifiait son nom (inaccessible) ,'que parce que c’était une terre introuvable (1) ; elle n’existait point dans le lieu où elle était indiquée aux navigateurs. Vers le nord, Albion et Jerne, entourés d’îles nombreuses plus petites, offrirent très-anciennement un champ aux conjectures, comme on le verra quand nous parlerons des mythes de la terre Cronienne. L’importance donnée à des îles qui étaient sinon la source, du moins l’entrepôt du commerce de l’étaim, les opinions erronées, longtemps conservées sur le gisement des côtes et la configuration de l’Europe péninsulaire, enfin l’agroupement des îles et leur disposition par série presque continue, depuis les Cassitérides jusqu’aux Orcades, aux Shetland et aux Fœroé, donnèrent lieu de bonne heure à des hypothèses et à des mythes adaptés à la nature des régions boréales.
(1) Plol., IV, 6.
Dicuil (1) et Adam de Brême, l’un du commencement du neuvième, l’autre de la seconde moitié du onzième siècle, prouvent bien, cependant, par leurs écrits, que, dans le nord de l’Atlantique, le zèle religieux des missionnaires de l’Irlande et de la Frise avait fait connaître de nouvelles terres. Mais ces voyages et ces découvertes, que le prosélytisme chrétien avait produits dès la première période du moyen âge, même avant les expéditions des pirates normands sur les côtes de la France, d’autres causes pouvaient y avoir donné lieu antérieurement, et le Thylé lointain, où les Hérules, sortant du Danemark, avaient abordé, selon Procope (2), était peut-être le même que d’anciennes cartes Scandinaves placent à l’occident sur la terre américaine. Le même auteur, qui était contemporain de saint Brandan, prouve, ainsi que plusieurs autres, que les anciennes croyances aux merveilles de la mer Britannique s’étaient conservées dans les lieux mêmes où le christianisme avait pénétré. Sous ce rapport l’ouvrage de Dicuil est un monument très-remarquable : il témoigne avec quel enthousiasme un moine, né en Irlande, dans la seconde moitié du viiie siècle, étudiait Pline, Solin, Orose et les autres auteurs anciens. Les traditions des Grecs et des Romains, les mythes qui‘ offraient un caractère local, pouvaient donc se mêler dans le nord aux légendes historiques de la vie des saints.
(1) L’auteur de l’ouvrage De mensura orbis terrœ. Voir Letronne, dans le remarquable Mémoire qui traite de cette matière, pages 25 et 139.
(2) Procop., De Bello Gothico, lib. ii, 15.
Les voyages de deux saints, de l’abbé irlandais de Cluainfert, Brandamis, et de Maclovius ou saint Malo, la persuasion répandue dans le vie siècle de l’existence d’une île des Bienheureux dans le nord-ouest de l’Europe, sont un reflet des traditions de l’antiquité sur les merveilles de la mer Cronienne. Les moines cherchaient le paradis de l’île Ima dans le mare Pigrum et Cœnosum des Romains, qui est leur Klebersee ou océan visqueux. Plutarque nous dépeint les îles Sacrées de la mer Cronienne, près de la Bretagne, « où règne une douce température, où Saturne, enfermé dans un antre profond, sommeille sous la garde de Briarée.» Ce tableau rappelle la fertilité d’Eden et les délices du Paradis (1). La première position géographique assignée à l'île qui est marquée sur toutes les cartes du moyen âge, est dans le parallèle de l’Irlande et même dans une latitude plus septentrionale. Saint Brandan, avec les soixante-quinze moines qui l’accompagnent pendant sept ans, revinrent par les îles Orcades (2). On sait qu’avant ses courses il avait habité les îles Shetland.
(1) Traditions recueillies par M. de Murr, Diplom. Gesch. von Martin Behaim, page 33.
(2) Johan, a Bosco,Bibliot. Floriae., page 602.
Lorsque les Arabes, après la victoire de Guadelète où périt Roderic, envahirent presque toute la péninsule ibérienne, il se répandit une croyance populaire suivant laquelle six évêques, conduits par l’archevêque de Porto (3), s’étaient réfugiés avec de grands trésors dans une île de la mer de l’ouest. Ils y fondèrent, dit la tradition, sept villes (4) où s’établirent des émigrés espagnols et portugais. Cette île des évêques prit le nom portugais de Septe Cibdades, nom qui a été singulièrement déformé sur les cartes du xve siècle. Les érudits y virent le reflet de cet asile que, selon Aristote et Diodore de Sicile, les Carthaginois s’étaient préparé au sein de l’Atlantique. Cette tradition, confondue avec celle des sept îles ou Antilles (5), le fut également avec l’histoire de saint Brandan qui concerne l’île des Bienheureux, et on en chercha alternativement la réalisation aux Canaries, aux Açores et enfin aux Antilles même qui en reçurent leur nom. Au milieu de tant de traditions plus ou moins fondées sur des mythes ou sur la vérité, on ne saurait cependant révoquer en doute que les Basques et les peuples d’origine celtique de l’Irlande, exerçant la pêche sur des côtes lointaines, n’aient constamment rivalisé dans le nord de l’Atlantique avec les Scandinaves, et que ces derniers, au huitième siècle, n’aient même été précédés, dans le groupe des îles Fœroé et en Islande, par des navigateurs irlandais. Malgré ces preuves d’activité nautique, il ne paraît pas moins extraordinaire de voir Madoc et ses partisans chercher des aventures en mer, en voguant vers l’ouest, laisser les côtes d’Irlande tellement au nord, qu’il ait pu aborder à une terre inconnue et inhabitée où ils virent des choses très-étranges. Il serait donc vrai que ce prince aurait évité alors les stations intermédiaires qui avaient favorisé les découvertes des Scandinaves et aurait pu pousser ses courses aventureuses jusqu’aux Etats-Unis, d’où il serait retourné, dit-on, dans le pays de Galles pour chercher de nouveaux colons.
(3) Letronne a. rendu ce fait très-probable par l’interprétation d’un pas-sagé de Solin, qui prouve que ce groupe d’iles était habité du temps des Romains (Dicuil, dans les Additions, page 134).
(4) Les sept villes rappellent curieusement les sept villes du pays de Cibola, dont il sera question plus loin, ainsi que les sept grottes des traditions toltèques, citées dans le passage de Sahagun, et dont nous aurons occasion de reparler assez souvent. Les sept évêques rappellent également les sept tribus si souvent mentionnées dans les mêmes traditions, chacune avant son chef.
(5) Voir Humboldt, Essai, etc. tom, iii, page 173, article Antillia et Ile des Sept-Villes.
« Il serait vivement à désirer, de nos jours où la critique est sévère sans être dédaigneuse, dit judicieusement Humboldt (1), en parlant de ces voyages curieux, qu’on voulût, sur les lieux mêmes, se livrer à de nouvelles recherches et recueillir dans les traditions et les vieux chroniqueurs gallois ce qui est relatif à la disparition de Madoc ap Owen Guineth. Je ne partage aucunement le mépris avec lequel ces traditions nationales ont trop souvent été traitées: j’ai au contraire la ferme persuasion qu’avec plus d’assiduité la découverte de faits entièrement inconnus aujourd’hui éclaircira beaucoup de ces problèmes historiques, relatifs aux navigations du moyen âge, aux analogies frappantes qu’offrent les traditions religieuses , les divisions du temps et les ouvrages de l’art en Amérique et dans l’est de l’Asie, aux migrations des peu-pies mexicains, à ces anciens centres de civilisation d’Aztlan, de Quivira et de la Haute-Louisiane, comme des plateaux du Cundinamarca et du Pérou. »
(1) Id. ibid., page 149.
Idées des indigènes de l’Amérique sur leur origine. Histoire du déluge, suivant le Codex Chimalpopoca. Antique éruption des volcans. Traditions sur les Quinamés ou Géants. Patrie ancienne des Américains, suivant le Livre Sacré.
Au temps de la découverte de l’Amérique par Colomb, aucune contrée au nord du Rio-Gila ne présentait de traces considérables de culture intellectuelle, et, à l’exception des peuples du Nouveau-Mexique et de quelques autres nations des bords du Mississipi et de la Floride, les Européens ne découvrirent que des tribus nomades, en général peu nombreuses et bien inférieures aux races éteintes qui ont laissé, au sud des grands lacs, jusqu’aux bords même du golfe du Mexique, ces terrasses pyramidales et ces circonvallations polygones qui étonnent encore toujours les voyageurs. Nous venons de voir un peu plus haut que c’est de ces régions que les notions, conservées par Sahagun et Ixtlilxochitl, font arriver les premières peuplades de la race nahuatl, dont le caractère énergique a laissé son empreinte à toutes les nations avec qui elle fut en contact ou par lesquelles elle passa dans le cours des siècles. Les traditions écrites ou orales des peuples conquis par les Espagnols en Amérique viennent presque unanimement à l’appui de cette observation ; mais elles proclament en même temps que leurs ancêtres étaient sortis du nord, ainsi que des contrées où le soleil se lève. Plusieurs écrivains, néanmoins, ont exprimé l’opinion que ces populations, soit nomades ou civilisées, seraient venues du nord-ouest, en passant d’Asie en Amérique, plusieurs siècles avant notre ère (1), et les faits qu’ils signalent semblent corroborer cet avis ; d’autres encore en montrant des peuplades qui abordèrent par mer aux côtes occidentales du Mexique , et du Pérou, élargissent la voie aux écrivains qui, comme Clavigero et Acosta (1), cherchent à découvrir, dans les premiers habitants de l’Amérique, des Asiatiques et des Malais, aussi bien que des naturels sortis de l’Afrique.
(1) Herrera, Hist. gen. de las Ind. 1 quemada, Monarq. Znd.,lib. 1, cap.il Oc., decad. 1, lib. j, cap. 6. — Tor-I et 12.
(1) Hist. nat. y moral de las Indias, etc., lib. 1, cap. 20. — Storia antica di Messico, tom. 11, dissert. 1.
On a donc pu voir par ce qui précède que notre étude ne tend en aucune manière à présenter un système conçu à l’avance sur l’origine des Américains; ce que nous cherchons uniquement, c’est d’éclaircir une matière encore fort obscure, et de réunir, dans un tableau d’ensemble, les traditions et les faits conservés par les indigènes, en les mettant en regard des faits corrélatifs qui se présentent dans l’histoire de l’ancien monde. Notre objet est de classer après cela les groupes les plus importants, en les accompagnant dans leurs migrations diverses, selon les routes qu’eux-mêmes signalent dans leurs livres et cartulaires, et qu’ils parcoururent avant de se fixer aux localités où les conquérants espagnols les trouvèrent au seizième siècle.
En remontant dans les tables chronologiques des Mexicains, par les périodes de treize en treize ans, on trouve marqué à un signe Ce-Tecpatl, Un Silex, le récit encore fort obscur du voyage des Chichimèques (2) au pays de Tlapallan, Terre colorée, ou Huehue-Tlapallan (3), Terre colorée des Anciens, dont la situation a été, depuis l’époque de la conquête, une source d’incertitude et d’embarras pour les auteurs qui se sont occupé de cette question. Les opinions contradictoires qu’ils ont émises à ce sujet, donnent à penser que des contrées fort distinctes auraient été autrefois désignées de cette manière, et que les populations les plus anciennement civilisées de l’Amérique auraient eu pour berceau primitif une région appelée Huehue-Tlapallan, située aux latitudes les plus septentrionales du continent (1). Sans, chercher à nous appesantir sur une matière encore enveloppée de trop d’obscurité, nous ajouterons que la géographie mexicaine, contemporaine de la découverte, n’appliquait alors cette dénomination qu’aux provinces situées au nord de Guatémala, entre les affluents du fleuve Uzumacinta et le Honduras (2). Aussi, de quelque manière qu’on interprète les traditions indigènes, c’est dans l’Amérique centrale qu’il faut chercher les traces de l’empire primitif qui donna naissance, sinon à toutes les nations antiques, au moins à la civilisation d’un grand nombre de celles qui fleurirent sur le continent occidental. La chronologie mexicaine remontait par des séries périodiques à une antiquité fort reculée, et « un calcul très-simple pouvait leur faire trouver l’hiéroglyphe de l’année qui précédait de 5206 ou 4804 ans une époque donnée (3). » Au signe Ce-Tecpatl correspondait une date, antérieure de plus de trois mille ans à l’ère chrétienne, qui fixait l’arrivée des Chichimèques en Huehue-Tlapallan avec la fondation de leur empire : des écrivains qui se sont occupé de ces annales, frappés de l’analogie qu’offrent au premier abord diverses peintures indigènes avec l'histoire mosaïque, ajoutent que cet événement eut lieu cinq cents ans environ après le déluge universel, rattachant ainsi les traditions du nouveau monde à celles de l’ancien. Mais il est constant qu’on n’y trouve rien de bien précis à cet égard, le déluge dont il est parlé au Livre Sacré étant plutôt une inondation locale, accompagnée, à la vérité, d’une grande commotion des éléments, et qui se serait fait sentir à la fois dans plusieurs portions considérables de l’Amérique : c’est aussi de cette manière que se présentent la plupart des événements analogues qu’on lit dans presque toutes les traditions. En ce qui concerne l’Amérique centrale, le déluge paraît appartenir à une période qui touche à de grands événements historiques dont il sera question plus loin.
(2) Le nom de chichimec, suivant Betaucurt, aurait été donné par mépris aux populations sauvages ou barbares, chichime étant le pluriel de chichi, chien en mexicain; de là, chichimecatl, de chichimeca-tlacatl, homme-chien (Teatro Mexicano, torn. 1, part, ii, cap. 3). D’autres font venir ce nom de la ville de Chichen, dans l’Yucatan, d’où serait sortie une nation chichimèque pour aborder aux côtes de Tampico. Mais l’une et l’autre étymologie paraissent arbitraires. Veytia ajoute ailleurs qu’il serait venu d’un chef chichimèque, nommé Zichen. Ce mot chichimec viendrait peut-être aussi de chichiltic, rouge, ce qui pourrait s’appliquer à toute la race indienne en général.
(3) Tlapallan, de tlapalli, couleur pour peindre ou chose teinte (Molina, Vocab. de la leng. mex.). Le mot tlapalli a aussi le sens de noble, d’ancien; tlapalli eztli, mot à mot sang de couleur, et, métaphoriquement, noblesse de sang et de famille (Molina, ibid.), comme la sangre azul en Espagne. M. Aubin croit que le nom de Tlapallan avait un sens mystérieux et sacré comme berceau de la race antique des Chichimèques. Nous ajouterons que c’est peut-être à cette origine que faisaient allusion les onctions de peinture d’ocre rouge et jaune, dont les indigènes se servaient au sacre de leurs rois. Elliot {Polynesian Researches, tom. 1, page 180) dit que les Areois de la Polynésie se peignaient le visage de rouge, dans leurs cérémonies religieuses, et qu’une tradition polynésienne, d’accord avec celle de plusieurs nations du continent américain, disait que l’homme avait été créé de terre rouge, araea (Ibid., page 95). Dans les ruines de Palenqué, diverses figures sont peintes en rouge brun. Les Égyptiens sur les murs des tombes royales sont aussi peints en rouge. Dans les grottes et les tombes des Hindous et des Etrusques, on retrouve plus ou moins la même chose, et, dans Ezéchiel, on parle d’hommes peints de vermillon sur les murs des temples de Babylone. Au dire de Pline {Hist. nat., xxxiii, 7), Camille n’entra triomphant dans Rome qu’après s’être peint le visage et le corps de rouge, et l’un des premiers actes des censeurs, au moment d’entrer en charge, était de taire peindre le visage de Jupiter avec du minium. Ajoutons que, chez nous encore, le rouge ou l’écarlate est la couleur sacrée des pontifes et des princes.
(1) Belancurt, Teatro Mexicano, tom. i, part, ir, cap. 4. — Veytia, Hist, antigua de Mexico, tom. 1, cap. 2. — Ixtlilxochitl, Hist, des Chichimèques, tom. 1, ch. 2. Ce dernier auteur donne le nom de Huehue-Tlapallan à la côte de Sonora, voisine de la Californie.
(2) Les auteurs voisins de la conquête appellent ces contrées Tlapallan de Cortès, parce que ce conquérant y pénétra. Hibueras ou Honduras est aussi appelé Tlapallan par Ixtlilxochitl, Decimatercia Relation, Horribles Crueldades , etc. , édit. Bustamante; Mexico, 1829 ; page 112.— Pedro de Alvarado, Seconde lettre à Cortès, en parle également sous ce nom.
(3) Humboldt,· Vues des Cordillères, tom. h, page 132. — Fabregat, Espo-sizione del Codice Borgia, MS. in præf.
C’est peut-être à tort, donc, qu’on a cherché à comparer l’époque de l’inondation, ainsi que les trois ou quatre autres catastrophes mexicaines, aux quatre âges ou cataclysmes des peuples de l’Asie. Le nombre de ces périodes varie d’ailleurs dans la plupart des documents, et l’ordre dans lequel ces catastrophes se sont succédées y a été entièrement confondu (1) : elles semblent, du reste, avoir eu pour but de rappeler des séries de générations détruites ou qui, à la suite de Convulsions de la nature ou de grands bouleversements politiques, enchaînés à dessein les uns avec les autres dans les mythes religieux, se seraient éloignées vers d’au-très climats. Dans une partie du Codex Chimalpopoca, exclusivement consacrée aux mystères de la théogonie antique et de l’histoire primitive de la race nahuatl, l'Atonatiuh, ou Soleil d’Eau, n’est présenté que comme la quatrième époque. La première est appelée Ocelo-Tonatiuh ou Soleil de Tigres et fait allusion à une famine, commencée en l’année Ce-Acatl, ou Une-Canne, au jour Nahui-Ocelotl, ou Quatre-Tigres, et qui fit périr tout le monde. Une variante qu’on trouve dans les annales historiques du même document (1), rapporte au même jour une éclipse de soleil et dit qu’alors vivaient les Quinamés, nom qu’on traduit ordinairement par celui de géants (2). Le récit de la période suivante est remarquable à cause des détails qu’on y trouve sur la formation volcanique des montagnes : & Le troisième soleil qui se déroule, » est-il dit, du jour Nahui-Quiahuitl, Quatre-Pluie, est appelé » Quia-Tonatiuh, Soleil de Pluie, parce qu’en ce jour tomba une » pluie de pierres de sable (xaltetl). On dit que pendant que ces » pierres se répandaient ainsi, le tetzontli (amygdaloïde poreuse) » bouillait et les rochers de couleur rouge se formaient (1). Or » c’était en l’année Ce-Tecpatl, Un-Silex; c’était le jour Nahui-Quiahuitl et le troisième Nahui-Quiahuitl ou Quatre-pluie (2). » Or, en ce jour, les hommes furent perdus à cause de la pluie de » feu et ils furent changés en oisons, le soleil même brûla et tout » se consuma avec les maisons (3). »
(1) Id. ibid. Fabregat et Rios, l’un dans le commentaire du Codex Borgia, l’autre dans ses annotations au Codex du Vatican, trouvent également de la confusion dans l'ordre de ces diverses catastrophes; mais je crois qu’elles sont en sens inverse de l’idée qu’ils s’en étaient formée. Dans leur opinion, le déluge ou l’inondation mexicaine devrait être la première époque après la création de l’homme; parce qu’ils s’imaginaient y voir une tradition certaine du déluge de Noé; mais l’examen attentif des documents semble partout impliquer un déluge partiel, qui aurait eu lieu un an ou deux avant ou après l'ouragan, qui est une autre des époques mentionnées. Humboldt , qui donne les quatre époques d’après le Manuscrit du Vatican, s’est trompé, je crois,’ en expliquant les signes numéraux qu’il y a trouvés indiqués: se-Ion lui; le chiffre 5206 ans serait la durée de la première, appelée Tlal-Tonatiuh, soleil de la terre ; le chiffre 4804, celle de la seconde, appelée Tletonatiuh, soleil de feu (ailleurs Quiatonatiuh); le chiffre 4010, la durée de la troisième, Eheca-Tonatiuh, soleil de vent (ouragan); et le chiffre 4008, celle de la dernière époque, Atonatiuh, soleil d’eau (le déluge); ce qui donnerait aux quatre âges l’ensemble fabuleux de dix-huit mille vingt-huit ans. Je crois voir, dans le premier chiffre, une date chronologique, indiquant le nombre d’années écoulées depuis la première catastrophe jusqu’au temps où le Codex fut peint ou écrit. Or, en supposant que ceci eût eu lien en l’an 1500 de notre, ère, le soleil de la terre (peut-être le commencement de la colonisation de la terre mexicaine) remonterait à 3706 ans avant noire ère; l’éruption des volcans, à l’an 3304 ;le grand ouragan, à l’an 2510, et l’inondation à l’an 2508. Mais je donne cette idée comme une simple hypothèse et sous toutes réserves.
(1) Dans le Codex Chimalpopoca (Histoire des Soleils), les époques se suivent ainsi: Ocelo-Tonatiuh, soleil de tigre (différente du Tlal-Tonatiuh du Cod. Vat.)·, Eheca-Tonatiuh, soleil de vent; Quia-Tonatiuh , soleil de pluie (de leu); Atonatiuh, ou soleil d’eau. Dans la partie historique de ce même document, la première époque est l'Atonatiuh ; la seconde , Ocelo-Tonatiuh; la troisième, Quia-Tona-tiuh ; la quatrième, Eheca-Tonatiuh, et la cinquième, Ollin-Tonatiuh, soleil du mouvement, c’est-à-dire celui qui était alors en marche.
(2) Quinametin, pluriel de quinametl, en langue nahuatl ; c’est le nom générique donné à la race qui occu-paît le Mexique et l’Amérique centrale avant les Nahuas. Peut-être vient-ïl de quinan, qui ferait au pluriel quinanme. Le mot quinan, dit M. Aubin (Mémoire, etc.), prétérit inusité des fréquent, quiquinaca, gémir, grogner; quiquinatza, bramer, ri far el cavallo (Molina, Voc. Hex.); grunir el perro (Hor. Car., Arte, etc., fol. 75). De ce même mot est dérivé le nom de Quinantzin, le seigneur bramant, l’un des plus grands rois de Tetzcuco. Les Quinamés jouent partout, dans les traditions, le même rôle que Vucub-Cakix et ses fils, ainsi que les rois de Xibalba, comme aussi les Géants ou Chimus, aux côtes du Péroti.
(1) Le tetzonlli, appelé par Humboldt amygdaloïde poreuse, est la pierre dont sont bâtis la plupart des édifices de Mexico. Suivant Bustamante, commentateur de Sahagun, ce seraient les petits volcans qui environnent la vallée de Mexico au sud-ouest, qui auraient formé le tetzontli: et le volcan d’Axuzco, de Quauhnexac, suivant Belancurt (Teatro Mexicano, part, i, trat. 2, cap. 4), appuyé sur les traditions de quelques vieux Indiens, aurait donné naissance à la célèbre couche de lave, appelée El Pedregal de San-Agustin, et Vomi les vastes torrents de lave qui s’étendent jusqu’à Acapulco ; ce serait encore, d’après Bustamante, le volcan du Coffre de Perote qui aurait couvert de lave toute la contrée qui s’étend au sud-est jusqu’au golfe du Mexique.
(2) Le troisième Nahui-quiahuitl, c’est-à-dire le troisième de la treizaine commençant par Ce-Tecpatl, I. Silex. Si l’on peut s’en rapporter aux tables coordonnées par Veytia, on trouve que l’éruption de ces volcans a commencé le douzième jour du vne mois, Huei-Tozcoztli, de l’an III Tochtli, 3e de la treizaine Ce-Tecpatl, et fini le 20e jour du mois Pachtzintli, quinzième de l’année mexicaine, et qu’elle dura juste sept mois.
(3) Le soleil désigne-t-il ici un prince qui aurait porté ce titre, comme on le voit ailleurs ? Le texte ajoute plus loin que tous les seigneurs périrent; on comprend ce qu’une telle éruption dut jeter d’épouvante et occasionner de destruction. Une preuve singulière de l’existence de villes antiques ensevelies alors sous la lave, se retrouve au Pedregal de San-Agustin, ainsi nommé de la ville de ce nom qui est près de Mexico ; car, de dessous la lave qui l’entoure, sort un large ruisseau qui roule avec ses eaux des débris de poteries et de vases de terre cuite, provenant indubitablement des habitations ensevelies sous les masses de lave qui coulèrent dans la vallée. Combien d’Herculanum et de Pompéia ont recouvert les laves des volcans mexicains! Le Livre Sacré fait également allusion à cette catastrophe, mais il la mêle au récit du déluge (page 27); on en trouve également des traces dans les traditions péruviennes (Merrera, Hist. gen. decad. v, lib. m, cap. 6).
Ces circonstances, ainsi que celles qui viennent d’être relatées ailleurs, prouvent bien qu’il ne s’agissait pas d’époques purement allégoriques : les Quinamés, dont il est parlé fréquemment, soit sous ce nom, soit sous celui de Tzocuilloque, qu’on a traduit également parle mot géants (4), n’étaient pas non plus des êtres fictifs, quoiqu’on ·puisse le supposer au premier abord : par une lecture attentive des traditions anciennes, on reconnaît encore en eux ces nations puissantes des premiers temps qui, plusieurs siècles avant la face nahuatl, arrivèrent par mer aux provinces méridionales du Mexique (1), dont elles subjuguèrent les habitants, tout en leur apportant les bienfaits d’une vie policée, Ixtlilxochitl les appelle indifféremment Quinamés et Chichimèques, identification importante, et tout porte à croire que c’étaient les mêmes que le texte, cité plus haut, désigne sous le nom de Colhuas, d’où serait venu, à la première cité bâtie par eux, celui de Colhuacan, appelée par d’au très Nachàn (2), c’est-à-dire Cité des Tortueux, des Serpents ou des Aïeux, et que plusieurs auteurs identifient avec les ruines de Palenqué. Ainsi que les Géants que les traditions péruviennes font également aborder par mer à la côte de Manta, plusieurs siècles avant l’ère chrétienne, les Quinamés se distinguèrent par la grandeur et la solidité de leurs œuvres, plus encore que par les débordements de tout genre que leur attribuent les populations de race nahuatl : c’est donc probablement moins à cause de leur taille gigantesque et de leurs vices contre nature, qu’en raison de leur puissance et de la difficulté que les Nahuas eurent à les vaincre, que ceux-ci leur infligèrent4e sobriquet méprisant de Tzocuilloque. Ce qui démontre, d’ailleurs, la haute antiquité des uns et des autres, tout en établissant comme un fait historique la période marquée par l’éruption des volcans, c’est que les Nahuas, qui n’entrèrent au Mexique que fort longtemps après les Colhuas, s’y trouvaient déjà fixés alors, et qu’au rapport d’Ixtlilxochitl (3), ils profitèrent de l’épouvante et de la désolation que cette catastrophe répandit dans ces contrées, pour travailler à s’affranchir du joug auquel les Quinamés les avaient soumis en leur qualité d’étrangers.
(4) Ce mot tzocuilloque , qu’on trouve écrit dans Ixtlilxochitl tzocuil-hioxime, par corruption ou par la faute du copiste, est probablement un sobriquet qui vient de tzocuitlayoa; henchi'rse el cuerpo, ό el vestido de mugre ό de suciedad de sudor (Molina, Vocab. Hex.), se gonfler, s’épaissir le corps ou le vêtement de crasse ou de malpropreté, de sueur ; ou bien de zo, piquer, saigner, et de cuilontia, comeler pecado nefando (Molina, ibid.), à cause du péché contre nature qu’on leur reprochait.
(1) Ixtlilxochitl, Sum. Bel. ap·. Kingsborough , tom. ix , suppl. — Carta al muy noble senor Gonzalo Fern, de Oviedo, ibid., tom. viii. — Torquemada, Jion. Ind., lib. I, cap. 11, 12 el 13.
(2) Ordoñez, Hist. del cielo y de la tierra, etc., MS. Cet écrivain identifie Colhuacan avec les ruines de Palenqué, qu’il appelle Nachan, j’ignore sur quel fondement; Nachan signifie lieu des serpents, dans un dialecte maya qu’on parle près de Palenqué. Les Tzendales appellent ce lieu Hochàn, qui a le même sens. Dans le dernier siècle, il existait encore parmi les Lacandous une tribu du nom de Chan ou Serpent.
(3) Ixtlilxochitl, Hist, des Chichimèques, tom. 1, chap. 1.
Cependant au milieu de l’obscurité qui environne le berceau de ces différents peuples, quelques lueurs éclatent de loin en loin dans les écrits des premiers écrivains espagnols, et viennent à l’appui des traditions indigènes. Lizana (1), parlant des populations civilisées de l’Yutacan, affirme, d’après les documents qu’il eut entre les mains, qu’elles étaient passées originairement de Haïti à Cuba, et de là à la péninsule yucatèque, ajoutant que, suivant l’exposé de leurs relations, elles auraient traversé des côtes d’Afrique aux Canaries, d’où elles se seraient transportées aux Antilles. Herrera, traitant la même question (2), écrit : « Un » grand nombre d’indiens instruits disaient avoir appris de leurs» ancêtres que cette terre (d’Yucatan) avait été peuplée par des » nations venues du côté de l'Orient, que Dieu avait délivrées des » autres, en leur ouvrant un chemin sur la mer. » Ordoñez, commentant les traditions de Tzendales, cherche à établir la parenté des fondateurs de la monarchie « palenquéenne des Serpents (Chanes ou Colhuas) » avec les Chananéens chassés par Josué de la Palestine. Après avoir parcouru successivement les rivages de l’Afrique septentrionale, ils auraient été refoulés sur les côtes voisines des colonnes d’Hercule, d’où ils auraient cherché un refuge aux Canaries et ensuite aux Antilles (1).
(1) Hist, de Nueslra Setïora de tzamal, pari. 1, cap. 3.
(2) Hist. qen.. decad. iv, lih. x, cap. 8.
(1) On sait combien Colomb lui-même fut surpris de la ressemblance qu’il trouva entre les premiers indigènes qu’il vit à Haïti et ceux des îles Canaries qu’il venait de quitter. Un voyageur instruit trouva la même analogie entre les noms des personnes et des localités et ceux des Canaries (Berthelot, Hist. nat. des Canaries, t. 1,' page 23).
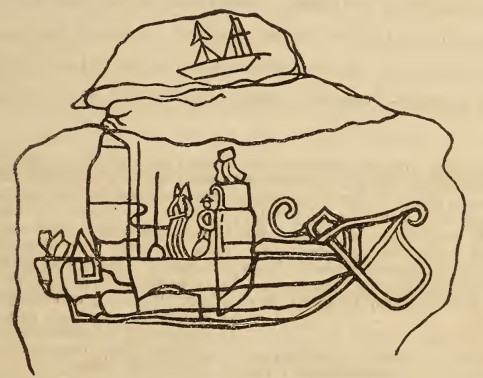
Galère antique sculptée sur un rocher de l'île de Pedra, dans le Rio-Negro, affluent de l'Amazone.
Sans nous arrêter de préférence à aucune de ces opinions, contentons-nous de citer ici un passage fort curieux du Livre Sacré des Quichés, qui semble venir à l’appui de l’origine orientale des premières tribus, en les rattachant aux peuples sabéens de l’ancien monde : « Ils vivaient tous ensemble, est-il dit (2), et grande » était leur existence et leur renommée dans les contrées de » l'Orient. Alors ils ne servaient pas encore et ne soutenaient » point (les autels des dieux) : seulement ils tournaient leurs visages vers le Ciel et ils ne savaient ce qu’ils étaient venus » faire si loin. Là vivaient alors dans la joie les hommes noirs » et les hommes blancs (3) : doux était l’aspect de ces gens, doux» le langage de ces peuples..... Or tous n'avaient qu'une seule» langue ; ils n’invoquaient encore ni le bois ni la pierre ; ils ne » se souvenaient que de la parole du Créateur et Formateur, du » Cœur du ciel, du Cœur de la terre. Ils parlaient, en méditant » sur ce qui cachait le lever du jour, et remplis de la parole sacrée, » remplis d’amour, d’obéissance et de crainte, ils faisaient leurs, prières, puis levant les yeux au ciel, ils demandaient des filles » et des fils. »
(2) Page 209.
(3) Cette diversité de couleurs est certainement fort remarquable ici; car, avec les Indiens qui rapportent cette tradition, cela faisait trois, le blanc, le noir et le rouge, ou plutôt le cuivré, qui est la leur. On sait qu’un grand nombre de traditions anciennes, talmudiques et autres, font allusion également à ces trois couleurs, caractères distinctifs, suivant plusieurs,, des trois races noachiques, et au sujet desquelles il est notoire que les Juifs avaient anciennement des croyances très-arrêtées. Ce qu’on trouve de plus curieux à cet égard, ce sont les détails que donne le Livre apocryphe du prophète Enoch, ouvrage qui parait avoir été écrit quelque tempe avant l'ère chrétienne. Ce livre fut traduit d’un manuscrit de la Bibliothèque bodléienne (d’Oxford), par Richard Lawrence, archevêque de Cashel, et imprimé à Oxford, en 1833. Nous ne pouvons nous empêcher d’en donner ici les passages suivants : « Et voilà qu’une » vache surgit de la terre (ch. lxxxiv, » sect. 17, v. 2), et cette vache était » blanche (v. 3). Après cela, une génisse surgit, et, avec elle, une autre » génisse; l’une d’elles était noire, et » l’une était rouge , etc. (v. 4). » — « Alors un de ces quatre alla aux vaches blanches, et leur enseigna un » mystère. Tandis que la vache tremblait, il naquit et devint un homme, » et il se bâtit un grand vaisseau. Il » demeura dedans et trois femmes demeurèrent avec lui dans ce vaisseau, » qui les couvrit (chap. Lxxxviii, v.1).» Après cela, vient en substance le récit du déluge ; puis l’allégorie continue : « Le vaisseau resta sur la terre; les » ténèbres s’éloignèrent et il se fît de » la lumière (v. 11). Alors, ]a vache » blanche, qui était devenue un homme, » sortit du vaisseau, et les trois vaches » allèrent avec lui (v. 12)., L’une » des trois vaches était blanche, ressemblant à cette vache-là ; l’une d’elles » était rouge connue du sang, et l’une d’elles était noire: et la vache blanche le laissa (v. 13). »
Le texte du Livre Sacré, en rapportant cette tradition, indique constamment l'Orient. Cependant, il est bon d’observer qu’à l’époque où l’écrivain la consignait dans ces antiques annales, l'Orient pouvait être ailleurs qu’en Afrique relativement à celui qui les rédigeait. Quoi qu’il en soit, elle remonte évidemment à un temps fort ancien : remarquons ici que le verset qui le précède énonce que le peuple qui en est l’objet aurait été chassé de l'Orient par des nations nomades qu’il avait insultées, ce qui ajouterait sans nul doute quelque poids à l’opinion d’Ordoñez, citée plus haut. Est-ce la présence de ce peuple qui aurait développé les germes de la civilisation qu’on voit naître en Amérique, ainsi que le culte du soleil, identifié dans quelques contrées avec le culte de l’Ara, ailleurs avec celui du Serpent, et qui répandit ses dogmes dans un si grand nombre de contrées ? Malgré la distance et l’intervalle des mers, c’est vers l’Asie qu’on tourne involontairement les regards, en voyant l'Orient si clairement indiqué dans les souvenirs primitifs des Américains, c’est en Asie qu’on cherche le berceau de cette religion et des institutions sociales qu’elle consacrait. Aussi est-ce de là que la plupart des écrivains qui ont traité cette matière font venir par des routes plus ou moins directes les premiers législateurs de l’antiquité américaine. Cependant, il est bien difficile aujourd’hui de discerner les dogmes qu’enseignèrent les Colhuas ou leurs prédécesseurs de ceux qu’apportèrent les chefs de la race nahuatl, et c’est avec peine que l’on parvient à faire sortir quelque clarté de cet antique chaos.
Premiers mythes nahuas. Arrivée des Toltèques. Leur caractère septentrional. Ils paraissent de la Floride à Panuco. L’empire primitif de Xibalba. Second cataclysme, ouragan et inondation. Traditions sur l’existence première des Nahuas et sur Tamoanchan. Voyages de Votan. Notions sui- les divers Tula.
A l’époque de la conquête, on conservait encore à Xicalanco et dans les régions voisines (1) la tradition des vingt chefs qui avaient abordé dans plusieurs navires, venant de l'Est, avec une colonie nombreuse d’étrangers, ayant à leur tête celui qu’on appelait tantôt Quetzalcohuatl, Cuculcan ou Gucumatz, suivant l’idiome où ce nom est énoncé (2). Ces vingt sont ceux dont les noms furent depuis placés dans les divers calendriers du Mexique et de l’Amérique centrale, et c’est d’après eux ou d’après les signes qui les distinguaient, que furent marqués les vingt jours du mois nahuatl ou toltèque, universellement suivi dans ces contrées. Dans plusieurs de ces calendriers, le personnage placé le premier est ordinairement Imox, regardé comme le père de la race indigène, vénéré dans l’arbre Ceiba (3), que l’on continue à encenser encore de notre temps, qu’on orne de fleurs à certains jours de fête et à l’ombre duquel se font aussi quelquefois les élections d’alcades. Or Imox est le même que le Cipactli du calendrier mexicain'; il est représenté par le même signe,*traduit par Espadarte en espagnol, c’est-à-dire par une sorte de serpent ou de monstre marin (1). Ce mythe est suivi de celui d’Zgqen mexicain Ehecatl, l’un et l’autre signifiant également le souffle, le vent ou l’esprit ; puis vient Votan, dont le nom se retrouve souvent entre les traditions tzendales et celles du pays d’Oaxaca. Dans le mexicain, c’est le signe. Calli, maison, à côté duquel vient se placer, dans les anciennes peintures (2), le symbole de Quetzalcohuatl, personnage moitié historique et moitié mythique, auquel se rattachent les notions primitives des peuples de race nahuatl, contemporaine des Colhuas, Chanes ou Serpents en Amérique, si l’on en croit Ordoñez (3).
(1) Las Casas, Hist. apol. de las Ind. occid., 10m. nr, cap. 124.
(2) Quetzalcohuatl, en langue na-huall signifie Serpent (recouvert) de plumes de quetzal (vertes et azur), serpent empanaché ou orné d’une aigrette de plumes. Le même mot en langue maya est Cuculcan; en tzen-dal, Cuchulchan, et, en quiché, Gucu-mat z.
(3) Nunez de la Vega, Constit. dio-ces. del obispado de Chiappas, præ-ambul., n. 33. Dans chaque localité, on von encore généralement un ceiba planté au milieu de la place, devant l’église ou la municipalité; c’est encore aujourd’hui l’arbre sacré des Américains, comme l’arbre bo à Ceylan et en d’autres endroits de l’Inde, où il est consacré à Buddha ; comme l’arbre toujours terd qui existait jadis près du temple de la vieille Upsala, en Suède, et comme il y en a.encore en Norwége (Holmboe, ״Traces du bud-dhisme en Norwége avant Tinlroduc-tion du christianisme , pag. 46 et suiv.).
(1) Ne serait-ce pas ie Cipadli ou Imox, qu’on voit représenté sur le beau vase rapporté du Pérou, que nous montra le savant conservateur du Mu-sée américain ? M. de Longpérier en a fait l’acquisition pour le compte de ce Musée; mais on regrette de ne pas l’y voir non plus que les autres beaux vases péruviens, etc. Les scènes eu-rieuses, peintes sur ce vase, parais-sent appartenir à l’ordre des faits que nous traitons ici; on y trouve, entre autres choses, le signe de l’eau, ail, figuré deux fois.
(2) Fabrégat, Esposizione del Co-dice Borgia, manuscrit de ma collée-tion.
(3) Hist, del cielo y de la tierra, etc., MS. de ma collection.
Ce qui parait certain c’est que cette race, personnifiée dans les vingt chefs dont nous venons de parler et dont Quetzalcohuatl aurait été le principal, arriva du nord-est : elle aborda pour la première fois à Panuco, port intérieur situé sur la rivière du même nom, à quelques lieues plus haut que son embouchure sur le golfe du Mexique (4). La description que nous en a laissée Torquemada mérite d’avoir ici sa place tout entière. « Ces gens, » dit-il (5), étaient des hommes de bonne apparence et bien vêtus » d’habits longs d’étoffe noire, comme des soutanes de prêtres, » ouverts par devant ; mais sans capuchons, au col échancré, les » manches courtes et larges et qui n’arrivaient pas aux coudes, » comme ces vêtements dont les indigènes usent encore aujourd’hui dans leurs ballets, en imitation de cette nation.
(4) La rivière de Panuco est un affluent du fleuve de Tampico, fort rap-proché de son embouchure ; celui-ci entre dans la mer auprès du port de Tampico, qui est situé au nord de la Véra-Cruz.
(5)Torquemada, Monarq. tnd., Lin, cap. 7.
Ces gens » passèrent, en avant de Panuco, usant de bonnes manières, sans » aucune occasion de guerre ni de combat, et venant d’étape en » étape jusqu’à Tullan (1), où ils furent reçus et hébergés des naturels de cette province qui les accueillirent de fort bonne grâce, parce que c’étaient des gens parfaitement entendus, ha» biles, de beaucoup d’ordre et d’industrie : ils travaillaient l’or » et l’argent, étaient de grands artistes en tout art, grands lapidaires par-dessus tout, autant dans ces choses délicates que » pour produire d’autres industries par rapport à la sustentation » de l’homme, pour travailler et rompre la terre. En sorte qu’à » cause de leur bon gouvernement, de leurs grandes industries » et habiletés, ils reçurent un fort bon accueil, et partout où ils » arrivaient on les tenait( en grande estime, leur faisant beau» coup d’honneur. Mais cette nation, on ne sait pas d’où elle » avait pu venir, ajoute Torquemada, parce que de cela il n’y a » d’autre notion que celle que nous avons dite d’abord, qu’ils vinrent débarquer en la province de Panuco. Quelques-uns prétendent que ce seraient des Romains ou des Carthaginois, que des » tempêtes et des vents contraires auraient poussés à quelque » côte vers le Nord, et qui, n’ayant pas trouvé le moyen de s’en » retourner par une mer si vaste, se seraient aventurés à cher» cher à l’intérieur du pays. D’autres prétendaient que ce seraient » des Irlandais (2)...., et la raison qu’ils donnent pour que ce » soient des Irlandais, c’est qu’ils se rayaient le visage comme· ». ceux-ci et qu’ils mangeaient de la chair humaine (3), qu’ils » étaient d’ailleurs rapprochés des îles où l’on [pêche la morue » (Bacallaos ou Terre-Neuve), et qu’il n’y a là qu’un détroit fort » restreint (celui de Belle-Isle) par où ils pussent passer et s’en » venir. »
(1) Jusqu’à la province où depuis s’éleva Tulan. La diversité des personnages qui portèrent le nom de Quetzalcohuatl cause ici quelque difficulté; mais il est bien probable, et le texte en suivant l’indique bien, que cette description de la nation toltèque et de son arrivée se rapporte évident-ment à la race nahuatl, lors de sa première apparition au Mexique.
(2) 11 ne manque pas de légendes ou de traditions sur le passage des Irlandais en Amérique et sur leurs communications habituelles avec le nouveau monde, bien des siècles avant Colomb. 011 doit se souvenir que l’Irlande ancienne avait été colonisée par . des Phéniciens. Un saint irlandais nommé Vigile, vivant au viiie siècle, accusé près du pape Zacharie d’avoir enseigné des hérésies au sujet des antipodes, lui écrivit d’abord, et ensuite alla en personne se justifier à Rome, où il prouva que les Irlandais communiquaient habituellement avec un monde transatlantique..
(3) Strabon (Géogr., lib. iv) appelle les' habitants de l’Angleterre et de l’Irlande des Mangeurs d'hommes, et saint Jérôme écrit (Contra Jovinian., lib. 11) qu’étant jeune homme, il vit, un Ecossais manger de la chair humaine; il ajoute que les parties du corps que les Hiberniens aimaient le plus manger, étaient le postérieur des bergers et les seins des femmes. Au dire de Strabon et de Solin., les Messagètes avaient la même coutume (Géogr., lib. iv et vu, et Solin, n. 25 et 26). Il ne manque pas d’autres exemples de peuples anthropophages en Asie et en Europe, d’où très-probablement ce vice abominable peut être passé en Amérique.

Peinture antique à Chichen-Itza, dans l'Yucatan.
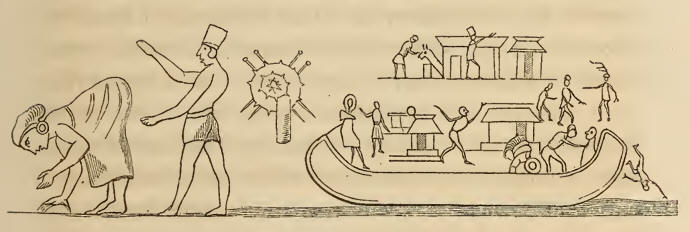
Peinture antique à Chichen-Itza, dans l'Yucatan.
Un peu plus bas l’auteur ajoute que leur chef était un personnage considérable du nom de Quetzalcohuatl, homme de bonne mine, rond de visage, blanc et barbu, aux cheveux longs et noirs* suivant Las Casas (1), blonds au dire de Torquemada, et dont la robe noire était parsemée de petites croix de couleur rouge (1). Or, si Quetzalcohuatl est le même que Votan, « ceux qui ont étudié l’histoire des peuples Scandinaves dans les temps héroïques » seront moins frappés peut-être que ne le fut Humboldt (2)‘, « de trouver au Mexique un nom qui rappelle celui » de Wodan ou Odin. qui régna parmi les Scythes et dont la race, »־ d’après l’assertion remarquable de Beda (3), a donné des rois » à un si grand nombre de peuples. » Ce nom se retrouve en effet d’une manière bien plus complète et plus significative dans celui d'Odon, qui est en tète du calendrier toltèque au Michoacan (4), et dans celui d’Oton, dieu et chef primitif des Otomis, qui, ainsi que les Oton-Chichimèques, tiraient de lui leur nom (5) : ajoutez qu’avec Odon ou Oton, les Tarascas adoraient aussi un autre dieu, dont ils prenaient leur appellation, Tor-as, qui emporte également, ainsi que le Teutl des Mexicains, un souvenir de l’Europe septentrionale : mais Toras avait en outre le nom de Mixcohuatl (6), Serpent-Nébuleux, ou d'Iztac-Mixcohuatl, le Blanc Serpent-Nébuleux, qui peut-être ferait allusion à la contrée septentrionale et nébuleuse dont il serait sorti (7) . De sa femme Ilancueitl, ainsi que nous le remarquons plus haut, il avait eu six fils, pères d’autant de races, et un septième d’une autre femme : Oton ou Otomitl et Quetzalcohuatl étaient de ce nombre. Cela voudrait-il dire que ces six nations fussent sœurs dans un sens absolu, et que, sous le titre commun de Nahuas, les annalistes· mexicains eussent prétendu les donner comme une seule et même race? Nous ne le croyons pas : mais en disant qu’elles sortaient d’Iztac-Mixcohuatl, ils auraient signifié simplement, ce nous sem-ble^ que leur émigration avait eu lieu d’une contrée également nébuleuse, ou peut-être encore qu’elles seraient apparues après l’ouragan et qu’elles se seraient répandues comme la tempête et le tourbillon, dont on les faisait naître, en les disant issues d’Iztac-Mixcohuatl, dont le nom a également ce sens. Sans chercher à découvrir ici les affinités qu’il y aurait entre leurs langues et leur constitution physique, contentons-nous de remarquer que si les six premières nations, nées d’Ilancueitl, et la septième, symbolisée dans Quetzalcohualt, sont sorties d’une région nébuleuse, on en trouverait peut-être la confirmation dans le texte du Livre Sacré, dont le dernier rédacteur énonce, sans amphibologie qu’après l’établissement du christianisme, « on ne vit plus le Livre national ■ » (Popol Vuli), où l’on voyait clairement qu’on était venu de » l’autre côté de la mer, et que ce livre était le récit de notre existence dans le pays de l'Ombre, » pays que l’on serait tenté de chercher dans le Skuggam des Scandinaves (1).
(1) Hist, apolog., etc., tom. 111, cap. 124. Torquemada, qui généralement conserve peu d’ordre dans ses récits, confond probablement le portrait de deux des personnages les plus célèbres connus sous le nom de Quelzalcohuatl; le premier, d’un caractère plus ou moins mythique et le prototype des autres, et celui qui fut roi à Tollan vers le 1xe siècle de notre ère; les légendes qui concernent l’un et l’autre sont, d’ailleurs, fréquemment confondues.
(1) Id. ibid. '
(2) Vues des Cordillères, etc., t. 1, pag. 208. .
(3) Beda, Hisl. Ecclesias., lib. 1, cap. 15.
(4) Veytia, Hisl. antig. de Mexico, tom. i, cap. 12.
(5) Sahagun, Hist., de las cosas de Nueva-Espana, lib. x,. cap. 29, § 4, 5, 11.
(6) Id. ibid.
(7) Le nom de Mixcohuatl est appliqué au tourbillon de nuages, tornado, phénomène commun au Mexique, et peut-être aussi à ce vent violent des mers des Antilles, nommé ouragan, du mot espagnol huracan, qui, lui-même, vient de hurakan, sous lequel les indigènes de ces contrées désignaient ces ouragans formidables qu’ils regardaient comme l’expression delà puissance divine, et ils n’avaient pas tort. Or, il est à remarquer ici, comme on le verra tout a l’heure, que c’es t à la suite du grand ouragan, signalé comme la quatrième époque de la nature, que les Nahuas commencèrent à s’étendre dans le Mexique et que les pères des sept familles de cette race sont nommés fils de Mixcohuatl. Est-ce parce qu’ils vinrent d’un pays nébuleux on parce qu’ils ne commencèrent à s’étendre qu’à la suite de l’ouragan ?
(1) En 1857, époque où parut mon premier volume de [,Histoire des nations civilisées du Mexique, etc., une note à propos du Pays .de l’Ombre disait, page 50 : «Le français rend difficilement tout le sens quiché. Nous al-Ions tâcher de le rendre en latin : « Jam non videndus est Liber Dominorum (vel concilii), in quo videbatur clare transfretavisse ex altero littore maris, quod dicitur Obumbraculum, etc. » A cette époque je n’avais pas encore été à même de consulter le savant ouvrage intitulé Antiquitates Americanœ, etc., édité par la Société Royale des Antiquaires, du Nord. Ce n’est que depuis peu qu’ayant parcouru les intéressants détails qu’il contient sûr le passage des Scandinaves en Amérique, j’y lus, non sans surprise, à la page 290, note b, ces paroles curieuses ausujetdu Helluland, traduites d’une antique Saga : « Navigant deinde donec in oceanum » Grœnlandiæ pervenerint, lune versus » meridiem et occidentem præter ter» ram iter vertunt.... Navigant jam » donec venirent ad Hellulandiam » cursu ad sinum Skuggam(Umbram, » i. e. Umbratilem) directo. » C’est presque l'Obumbraculum, que je traduisais du mot Muhibal, pays ou lieu où se fait l’Ombre.
La famille dont Quetzalcohuatl est désigné comme le symbole, parait avoir été des premières entre les tribus étrangères à se fixer dans les contrées occupées primitivement par les Chichimèques et les Golhuas : suivant une tradition, conservée par Las Casas (2), il serait arrivé vers le même temps que les Olmecas et les Xicalancas qui s’établirent au lieu, appelé encore aujourd’hui Punta de Xicalanco, en face de l’île de Carmen, sur le détroit qui réunit la lagune de Terminos au golfe du Mexique : leur débarquement aurait donc concordé, à peu d’années près, avec la quatrième époque de la nature, signalée comme un ouragan par les histoires et dont nous donnerons plus bas les détails.
(2) Hist, apolog. etc., tom. Ill, cap. 123.
Sahagun, qui recueillit tant de choses intéressantes sur l'histoire du Mexique, raconte ainsi le voyage des Nahuas (1}. « A l’égard de leur origine, leurs relations disent qu’ils vinrent par .» mer, et ce qu’il y a de certain c’est qu’ils arrivèrent dans des navires, quoiqu’on ne sache pas toutefois de quelle manière ils » étaient fabriqués : c’est ce qui a fait croire, d’après la tradition » que ces Indiens ont conservée, que les sept cavernes dont ils » sortirent (2) ne sont autre chose que les sept navires ou galères avec lesquels vinrent les premiers qui colonisèrent cette » contrée, et l’on regarde comme bien avéré qu’il y a plus de » deux mille ans qu’ils habitent cette terre qu’on appelle mainte» nant la Nouvelle-Espagne (3)... Comme ils étaient venus par » mer, dans des navires, ajoute pilleurs le même historien (4), » ils abordèrent à un port qui se trouve au Nord (Est de Mexico), » et comme ce fut en cet endroit qu’ils débarquèrent, on lui donna » le nom de Panutla, qui vient' de Panoaia, le lieu où l’on dé» barque en venant de mer, dont on a fait par corruption Pantlan... Cette nation venait à la recherche du paradis terrestre, » auquel elle donnait le nom de Tamoanchan (3)... A commencer » de ce port, ils vinrent cheminant le long du rivage de la mer, » regardant les hautes montagnes couvertes de neige, ainsi que » les volcans jusqu’à ce qu’ils entrassent dans la province de » Guatemala (1). Ils avaient leur prêtre qui les guidait : il portait » avec lui son dieu et le leur, dont il prenait conseil pour tout ce » qu’ils entreprenaient, et c’est ainsi qu’ils allèrent demeurer et » coloniser en Tamoanchan. »
(1) Hist, de las cosas de N. Espana. Introd, ad lib. 1, page 18. .
(2) C’est à quoi paraît faire allusion également un texte du Codex Chi-malpopoca, dans l’histoire des Soleils, où il dit qa’Iztac-Chalchiuhlicué (la Blanche jupe verte ou d’émeraude, la déesse des eaux) fit entrer les 400 Mixcohuas dans une caverne, qu’ils descendirent sur l’eau, qu’ils s’y étendirent et qu’ils y restèrent quatre *jours; qu’après cela ils en sortirent et qu’on leur donna à sucer une plante de maguey (allusion peut-être un à voyage par mer, et à leur arrivée au Mexique où ils inventèrent Yoctli (pulqué), ou jus du maguey (aloes americana).
(3) Sahagun, ibd. page 16.
(4) Hist. gén. lib. ni, cap. 10, §28.
(5) Ce mot est d’une étymologie difficile, ou bien il est très-ancien. J’ajouterai ici seulement qu’étant au mois de juillet dernier (1860) à Totonicapan dans l’Etat de Guatémala, j’entendis répéter à un Indien le mot tamainchan; lui en ayant demandé l’explication, il me répondit, après quelque hésitation, que ses ancêtres appelaient ainsi le paradis terrestre.
(1) Xicalanco où ils abordèrent est dans l’Etat de Tabasco : au temps de la conquête c’était le port où l’on débarquait en venant d’Yucatan pour aller au Chiapas, qui appartenait au royaume espagnol de Guatémala.
Dans une de ses
relations, Ixtlilxochitl dit qu’ils étaient venus de l’extrémité de la Floride. Dans une autre il ajoute, en désignant nommément les
Olmecas et
Xicalancas (2) : « On infère » de leurs histoires qu’ils vinrent dans des navires ou barques du » côté de
l'Orient jusqu’à la terre de
Papuha (3), d’où ils
commencèrent à la peupler, ainsi que les terres qui sont baignées » par la rivière Atoyac, qui est celle qui passe entre la Ville des » Anges et celle de Cholula. » C’est donc bien dans les contrées basses entrecoupées par les branches nombreuses des fleuves de Tabasco et de l’Uzumacinta, que s’établit la première colonie nahuatl. En ce temps-là, ajoute Ixtlilxochitl, vivaient les
Quinamés,
peuple de géants, qu’il représente comme livrés à d’affreux débordements (4) : on sait déjà que les Quinamés étaient les Chichimèques, policés par les Colhuas, également puissants par leur nombre et par l’étendue de leur empire. Dans le
Livre Sacré, dont nous nous occupons ici, cet empire porte le nom de Xibalba (5), et l’un des princes du pays paraît personnifié dans le caractère de
Vukub-Cakix (1), dont
l'histoire se présente à la suite de la Genèse des Quichés. Les Nahuas, réduits
peut-être à un petit nombre, auraient été circonscrits d’abord dans les provinces limitrophes de la mer et de la lagune de Terminos (2) : mais quelques expressions que l’annaliste quiché met dans la bouche de Vukub-Cakix prouvent que leur industrie et leur habileté dans les arts, non moins que l’influence qu’ils avaient acquise dès lors sur les populations, commencèrent de bonne heure à exciter la défiance des Quinamés. Au milieu de leurs travaux ils furent surpris par le déluge dont il est parlé dans toutes les histoires, et qui survint à la suite d’un ouragan terrible, dont la mémoire a été conservée comme celle de la quatrième époque de la nature, dans les armales des peuples américains.
(2) Sum aria Relation de la hist, tulteca, etc.
(3) Papuha est un nom de la langue quichée qui signifie sur l’eau de boue on de matière; il convient au pays où roulent les embouchures du Tabasco et de l’Uzumacinta.
(4) Ixtlilxochitl, Novena Relation, ap. Kingsborough, tom. IX. —Veytia, Hist, antigua de Mexico, tom. 1, cap. 12,13.
(5) Xibalba, donné dans le Livre Sacré comme le nom de l’empire primitif, paraît être un sobriquet plutôt qu’un nom propre : son étymologie est assez difficile, Xib signifie la crainte, l’épouvante, c’est le monosyllabe radical du verbe craindre dans le quiché, le cakchiquel, le tzulohil et dans la plupart des autres langues de l’Amérique centrale : de là Xibih, effrayer, répandre la crainte; xibyin, avec quoi l’on épouvante, épouvantail, un fantome. Xibalba, composé de Xïbal, qui est l’adjectif, plus régulier, xïbil, terrible, effrayant, déguisé, et de ba (en cakchiquel bay), taupe; ce qui serait donc la Taupe-déguisée ou effrayante, nom qu’on pourrait avoir appliqué à un empire dont les chefs se peignaient le visage ou se masquaient pour tenir leurs assemblées secrètes dans des lieux souterrains.
(1) Vukub-Cakix, signifie Sept-Aras. Peut-être est-ce à lui que fait allusion la légende maya du dieu Kinieh-Kakmô, le prêtre ou le devin Ara de Feu, qui faisait descendre le feu du soleil sur l’autel des sacrifices.
(2) Peut-être aux environs de Champoton, dont l’ancien nom Potonchan (Serpent habillé d’une robe) faisait allusion aux Nahuas, représentés comme habillés de longues robes à l’instar des femmes. On voyait encore, au temps de la conquête, dans une île de la baie de Potonchan un temple érigé anciennement en mémoire du séjour que Cuculcan (Quetzalcohuatl) fit en ce lieu (Herrera, Hist. gen. decad. iv, lib. 10, cap. 2).
Voici comment le Codex Chimalpopoca s’explique à ce sujet : « Au quatrième soleil et au jour Nahui Ehecatl, IV. Vent, eut » lieu l’enlèvement par le vent et la métamorphose (des hommes) » en singes : les bois furent arrachés et les hommes changés en » singes. Les maisons, les bois, tout fut enlevé par le vent, et le » soleil même fut enlevé dans les airs par des tourbillons, au » jour appelé Nauh-Ehecalt, IV. Vent. » On reconnaît sans peine dans cette description un de ces ouragans dont les Antilles et les alentours du golfe du Mexique offrent de temps en temps l’effrayant. spectacle, à l’approche des équinoxes (3) ; son nom même exprimait, dans l’antiquité américaine, l’idée de la divinité suprême, symbolisée dans la puissance de la nature et des éléments. Villes et maisons, champs et forêts furent arrachés et détruits par la violence de la tempête dans les terres basses occupées par les tribus nahuas : les eaux de la mer envahirent leurs demeures; rappelant ainsi à leur souvenir un cataclysme primitif dont ils avaient peut-être apporté la tradition de l'Orient. Dans le Livre Sacré, ainsi que dans le Codex Chimalpopoca ,il n’est question cependant que d’une seule catastrophe qui paraît avoir été postérieure de. plusieurs siècles au déluge de Noé et à laquelle la nature volcanique de ces contrées ne fut probablement pas étrangère : couvrant d’un voile symbolique les pertes auxquelles avaient été exposés les chefs de leur race dans leurs tentatives de colonisation, les rédacteurs de ces livres mystérieux décrivirent ce phénomène comme un châtiment imputé à des populations rebelles à leurs enseignements, et représentèrent les hommes de cette époque comme ayant été changés en singes (1) ; mais, en réalité, ils en avaient été eux-mêmes les victimes et l’on voit par les histoires qu’un grand nombre de Nahuas périrent par suite de l'inondation et de l’ouragan (2). Des vingt chefs qui avaient accompagné les tribus des contrées du nord-est aux rivages de Tamoanchan, sept seulement s’en étaient échappés, en se réfugiant dans des grottes au penchant des montagnes (3) ; ce sont eux dont les noms personnifiés, peut-être, avec des mythes antérieurs, astronomiques ou élémentaires, se retrouvent partout comme les sept grands dieux de là théogonie toltèque.
(3) La description de ce phénomène mérite sa place ici. a El huracan (est» il dit) es el fenomeno mas horroroso » de cuantos se observan en esta isla, » y aun creo qué en toda la America. » Es un viento furioso acompanado de » lluvia, relampagos, truenos y las mas » vezes de temblores de tierra ; circunstancias todas las mas terribles y » devastadoras que pueden unirse para » arruinar un pais en pocas horas,' los » torbellinos delayrey torrentes de las » aguas, que inundan 10s pneblos y » campinas cou un diluvio de fuego, » parece anuncian las ultimas convul-» siones dei universo. מ (Soto-Mayor, Hist, geograph, civil y politica de la isla de Puerto-Rico, 1831, page 74.) C’est exactement la description que nous en donne le Livre Sacré, et le lec-teur comprendra ce qu’une tempête de ce genre dut produire sur les esprits des premiers civilisateurs de ce pays.
(1) Ils furent changés en singes, c’est-à-dire qu’ils se réfugièrent dans les bois où ils vécurent peut-être quel-que temps comme des singes, c’est-à-dire des fruits spontanés de la terre. ! Veytia crut qu’il s’agissait de bandes de singes apportés par l’ouragan comme des fruits d’automne. Voir Hist, antigua de Mexico, tom. 1, cap. 3.
(2) Suivant Ixtlilxochill, un grand nombre de Toltèques (Nahuas) péri-' rent.dans ce déluge ou huracan (Su-maria relation, e׳c, Suppl, dans Kingsborough, tom. IX).
(3) Cod. Vatic, annot. Rios et Cod. Borgia. Ces grottes où ils se réfugiérent seraient-elles les sept grottes dont il est toujours question dans les histoires, et l’usage de bâtir des pyramides pour y placer leurs édifices viendrait-il de la crainte des inondations causées par ces ouragans dans des parages comme ceux de Champolon, de Xicalanco et de Palenqué? Les anciennes histoires semblent le dire, en rapportant que Xelhua, l’un des sept échappés au déluge et chef des Olmecas, bâtit la pyramide de Cholula eu souvenir de cette catastrophe.
L’ensemble du rituel mexicain est fondé en entier sur ces événements, que la tradition semble confondre encore avec des événements plus anciens : mais ils marquent d’une manière singulière l’arrivée de la race nahuatl dans ces contrées. Ce sont ces souvenirs augustes que les prêtres et les nobles conservaient dans le chant mystérieux, commençant par ces paroles Tulan yan hululaez, dont le langage vieilli n’était plus compréhensible que pour eux seuls (1). Ce chant, qui leur rappelait la puissance divine se manifestant dans les forces redoutables de l’ouragan, leur apprenait en même temps l’unité de Dieu : il leur expliquait les symboles des sept héros échappés au naufrage, et sous l’image d’une quatrième création du genre humain, les initiait aux causes mystérieuses qui avaient amené la destruction de la société antique. Il les instruisait de l’origine de la caste sacerdotale et militaire, destinée à conduire la société nouvelle. Tout ceci découle naturellement du Livre Sacré et des chapitres les plus anciens du Codex Chimalpopoca. Ce sont les mêmes personnages qui reparaissent là et ailleurs à la tête du système religieux de la race nahuatl, des Toltèques et des Mexicains, au Mexique et dans l’Amérique centrale. Les fêtes du rituel, les observances, les rites, si compliqués dans leurs détails, sont institués en leur honneur ou en mémoire des compagnons de leur émigration (1); tous rappellent avec plus ou moins ^’exactitude les événements de leur vie, et les mortifications si pénibles exercées par leurs prêtres, les plus longs jeûnes, sont destinés à commémorer les dures épreuves et les dangers, surtout ceux de l'inondation, auxquels avaient échappé les grands dieux (2).
(1) Parlant des annotations de Rios au Cod. Vüt., relatives à l’inondation, Fabregat ajoute : « Egli dice d’averne )) imparate queste tradizioni da un « cantico, che principia Tulan yan » hululaez, quale .cantare solevano .» menlre danzavano. Questo principio » di cantico poco n’ha del Messi cano; » e queste tradizioni troppo sono indi» viduate ed intéressant! per non pas» sarle sotto silenzio : esse meritavano » una piu diligente ricerca e maggiore » sviluppamento dalle melafore e fa-מ vole fraie quali erano inviluppate. » (Esposizione dei Codice Borgia.) Ce sont les mêmes chants dont parle Saha-gun (Hist, de las cosas de N. Espaiïa, lib. X, Relation del autor), disant que personne ne les entend que les chefs et les prêtres à cause de leur difficulté, por ser sus cantares muy cerrados-, ce sont ceux dont il est question dans le Livre Sacré, commençant par ces paroles Ka muku, et qu’ils appelaient le Chant du départ de Tulan.
(1) Il paraîtrait, cependant, qu’en outre des chefs ou dieux nahuas, il s’y trouve également quelques-uns des principaux personnages du pays où ils s’établirent d’abord, ainsi que nous le verrons plus loin.
(2) Rios in Cod. Vatic. — Fabregat va Cod. Borg.— Cod. Tel-Rem. de la Bibliothèque Impériale.
La plupart des documents qui servent à compléter ici le récit du Livre Sacré, placent, ainsi que dans cet ouvrage, à la suite de l’ouragan et de l’inondation, l’invention du maïs, que tous attribuent à l’un de ceux qu’ils appellent du nom de Gucumatz ou Quetzalcohuatl. Les documents les plus importants que nous possédions sur les origines américaines, le Livre Sacré des Quichés, le Manuscrit Cakchiquel et le Codex Chimalpopoca. en langue nahuatl, donnent là-dessus des détails fort curieux dont, le fond est le même et qui se complètent l’un par l’autre. Les dieux, remplis de tristesse, sont à la recherche de ce qui peut nourrir le corps de l’homme, et plusieurs se mettent en chemin dans l’espérance de découvrir, une substance, propre sans doute à remplacer le froment qui leur manque dans ces contrées. Gucumatz arrive à la fin de ,la saison des pluies au lieu nommé Pan-Paxil-Pa-Cayala (3), où il rencontre des hommes chàrgés de gerbes de maïs : les aliments de toute sorte qu’il· y voit sont énumérés avec complaisance dans les textes quiche et. mexicain. Dans ce dernier, le pays est appelé Tonacatepetl ou Montagne de notre subsistance : les souvenirs de l’antiquité américaine sont unanimes pour le représenter comme un séjour enchanteur; il était habité par une population laborieuse et agricole, à laquelle, cependant, les histoires (1) donnent le nom d’animaux sauvages ou barbares, et dont le chef s’appelait Utïu (chacal). S’étant instruit de ce qui pouvait l’intéresser, Gucumatz s’en retourne en Tamoanchan où son arrivée remplit les autres d’allégresse. Les cornmunications ensuite s’établissent avec les indigènes qui se laissent gagner par la supériorité de ces étrangers. Dans le Codex Chimalpopoca, ce sont des fourmis, symboles du travail et de l’industrie, qui introduisent Quetzalcohuatl à Tonacatepetl. Il est difficile de séparer dans ce qui suit l’allégorie de la réalité : ce qui est certain, c’est que les Nahuas s’étendirent rapidement jusqu’aux fertiles contrées de Paxil, et qu’ayant épousé des femmes du pays, ils se multiplièrent au point d’acquérir une puissance considérable, soit par leur nombre croissant, soit par de nouvelles immigrations, soit même parleur influence personnelle. Une tradition conservée par Ordonez (2) rapporte à cette époque le souvenir de trois villes importantes qui auraient surgi à la suite de l’union dès deux peuples ; Mayalpan, dans l'Yucatan (3), Chiquimula ou Copan, dans les montagnes guatémaliennes, au sud du lac d’Izabal (4), et Tula ou Tulau (1), dont les mines se trouveraient dans une des vallées intermédiaires entre Palenqué et Comitan, dans l’Etat de Chiapas. Celle-ci aurait été la première cité des Nahuas, et son nom lui aurait été donné en souvenir d’un autre Tulan, situé dans les régions du nord-est d’où ils étaient sortis et avec laquelle ils n’auraient cessé de communiquer durant plusieurs siècles.
(3) Le MS. Cakchiquel dit Paxil seulement. Il existe une montagne de ce nom aux confins occidentaux du Guatémala et de l’Etat de Chiapas, et le fleuve de Chiapas, appelé plus loin Tabasco, en arrose en partie le pied. PanPaxil, pan Cayala, paraît signifier Entre les Eaux partagées et amères ou fétides, nom qui convient au pays arrosé, par les bouches du Tabasco et de l’Uzumacinta. Si l’on n’était en Amérique, on croirait, en lisant ces descriptions, voir là un souvenir de la fable de Prométhéè introduisant Hercule au jardin des Hespérides.
(1) Le mot chicop, employé.dans le texte quiché, veut dire littéralement brute, animal; ici il y a le sens que nous donnons à barbare et sauvage. Dans le Codex Chimalpopoca, ce sont des fourmis, symbole de l’industrie et du travail, qui introduisent Quetzalco-huatl à Tonacatepetl.
(2) Hist, del cielo y de la tierra, etc.
(3) Mayalpan est !’orthographe du MS. Chronologique en langue maya. Les auteurs espagnols écrivent May a-pan. Suivant Ordonez, Mayapan, Ohi-quimula et Tulan étaient les capitales des trois royaumes tributaires de Na-chan ou Pa’lenqué. Au rapport d’Her-rera, Mayapan fut fondé par Cuculcan (Quetzalcohuatl), à la suite de Chichèn-Itza (Hist. gén. decad. IV, lib. 10. cap. 2). Cogolludo donne pour fonda-leur à Mayapan le prêtre Zamna(peut-être le même qu’un Quetzalcohuatl), lequel fonda aussi Izamal (Hist.· de Yucatan, lib. IV, cap. 3, 8). Ce qui est certain, c’est que Mayapan était une ville fort ancienne.
(4) Le royaume de Chiquimula est ,appelé de Payaqui, c’est-à-dire Entre Toltèques on Nahuas, dans Vlsagoge historico, MS. cité par Mgr Garcia Pelaez, archevêque de Guatémala (Memorias para la historia del antiquo reyno de Guatemala, tom. 1, pag. ï5), et il ajoute que la capitale en était Copan, écrit ailleurs Copantli : ce mot qui appartient à là langue nahuatl fait allusion à un mythe ancien delà théogonie toltèque et signifie littéralement Sur la Marmite ou le Vase. La grande bourgade de Chiquimula de la Sierra paraît avoir succédé à Copan, d’après l’usage où étaient les Espagnols de transporter les habitants d’une ville conquise à une autre localité; Chiquimula était le nom indigène de Copan où l’an parlait la langue chorti, dialecte du pokomam. Cette ville était renommée pour la grandeur et la magnificence de ses temples, suivant Herrera, et elle contenait le plus grand de tous ceux du royaume de Guatémala (Hist. gén. decad. III, lib. 4, cap. 19).
(1) Ordonez, suivi par divers au-très, écrivains place ce Tula, à deux lieues nord-est de la grande bourgade (TOcocingo, célèbre déjà dès le χνΐΊ siècle pour ses grandes et magnifiques ruines (Garcia, Origen de los Indios, lib. 11, cap. 4), visitées depuis par Dupaix, Waldeck et Stephens, et que nous avons vues aussi en septembre 1869. Les Indiens de la langue (zeti-dale donnent à ces ruines le nom de Tonina, Maisons de pierre ; celui de Tula y est inconnu, et jusqu’à présent rien ne vient à l’appui de l’assertion d’Ordonez, toutes les vallées entre les monts de Tumbala, au sud-ouest de Palenqué jusqu’au delà de Comitan, étant remplies de ruines analogues plus on moins considérables.
Malgré l’obscurité qui environne cette époque intéressante, en comparant entre elles les diverses traditions transmises par les livres mexicains et quichés, on en tire encore des données qui jettent plus ou moins de lumière sur l’origine et la colonisation de ces peuples. Le trait saillant, toutefois, dans ces divers récits, c’est la jalousie que la présence des Nahuas excita parmi les chefs des nations où ils s’implantèrent. On saisit, dès le berceau, les incidents de la lutte qui devait tôt ou tard s’engager entre les deux races et qui, après plusieurs siècles de péripéties de toute sorte, devait finir par le triomphe des idées et des institutions apportées par les étrangers. L’heureuse situation de Paxil paraît avoir été la cause de la première collision. Utïu, qui ‘ avait reçu Gucumatz dans cette province, aurait été tué d’abord (2), d’où serait venu à son meurtrier le nom de Hun-Ahpu-Utïu, Un-Tireur de Sarbacane au Chacal, sous lequel il est désigné dans le Livre Sacré. Paxil paraît être devenu dès lors la proie des Nahuas, et c’est peut-être dans ce pays que surgit la ville de Tulan. Ce que l’on trouve ensuite est plein d’incertitude : on croit entrevoir que celui d’entre les chefs étrangers qui se distingue plus particulièrement sous le nom de Gucumatz (Quetzalcohuatl), après les bienfaits dont il avait doté ses compagnons, se serait trouvé en butte à leur envie, et de vagues traditions donneraient à penser même que l’un d’eux aurait cherché, pour se débarrasser de lui, à attenter à sa vie (1). Pour ce motif ou pour d’autres, il se serait alors séparé des Nahuas, et les histoires ajoutent que ce fut pour s’en retourner aux régions orientales d’où il était venu.
(2) Tok x-camizax qa ri chicop Utiuh x-pochel chupam ri ixim: « Alors donc fut tué le barbare (animal) » Utïu, faisant la moisson dans le mais. » (MS. Cakchiquel.)
(1) Codex Chimalpopoca, dans l'Hist. des Soleils. Peut-être trouverait-on dès le berceau de la race nahuatl en Amérique l’origine des dissensions et des schismes qui existèrent entre les deux grandes sectes de la religion toltèque, personnifiées dans Quetzalcohuatl et Tetzcatlipoca, qui tout en se revêtant parfois des symboles l’un de l’autre, représentent cependant deux ordres d’idées distinctes. Hun-Ahpu-Utïu, le meurtrier d’Utïu, qui est bien le même que Cipactonal, est représenté souvent comme mi serpent engloutissant le symbole de Quetzalcohuatl. 11 pouvait y avoir d’autres can-ses à ces antiques dissensions. Le nom de Chimalman donné à la mère de Quetzalcohuatl indique assez une autre race, peut-être le produit d’une première colonisation unie aux femmes du pays. Ailleurs il est dit que Quetzalcohuatl fut le père et le chef des Chichimèques (RiosinCod. Fat.). Une autre tradition énonce que le nom de Chichimèque vient de Chichen (ville de l'Yucatan), fondée par un Quetzaîco-huatl.
C’est le même qui serait, dans Sahagun, l’objet d’un passage qui fait suite à celui de l’arrivée des Nahuas en Tamoanchan (2): « Ils demeurèrent, continue cet écrivain, fort longtemps en Tamoanchan, mais sans cesser d’avoir leurs sages ou devins que » l’on appelait Amoxoaque, c’est-à-dire hommes entendus dans » les peintures antiques (3). Quoiqu’ils fussent venus ensemble, » ils ne restèrent pas, toutefois, ■avec le reste du peuple en Tamoanchan : mais ils y laissèrent les autres, et ils s’en retournèrent pour se rembarquer,' emportant avec eux toutes les » peintures qui avaient trait aux rites et aux offices mécaniques.
(2) Hist. gen. dé N. Espana, lib. x, cap. 29.
(3) Awoxoaque, pluriel d’amoxoac, celui du livre, en langue nahuatl.
» Cependant, avant de partir, ils firent à ceux qui restaient le » discours suivant : « Sachez que le Seigneur notre Dieu vous » commande de demeurer dans ces terres dont il vous rend les » maîtres et qu’il vous donne en possession. Pour lui, il s’en retourne d’où il est venu, et nous autres nous l’accompagnons : » mais il ne s’en va que pour revenir plus tard ; car il retournera ' » vous visiter, lorsque le temps viendra que s’achève le » monde (1). En attendant, demeurez, vous autres, dans ces » terres, dans l’espérance de le revoir. Jouissez de ce que vous » possédez et de toutes les choses que ces régions renferment; » car c’est pour les prendre et les posséder que vous êtes venus en » ces lieux. Ainsi, demeurez en bonne santé, tandis que nous » partons avec notre dieu. » Et ainsi ils se mirent en route avec. » leur dieu, qu’ils portaient roulé dans une enveloppe d’étoffe, et » il continuait à leur parler, leur indiquant ce qu’ils avaient à » faire. Et ainsi ils s’en furent vers l'Orient. »
Que ceux-ci fussent ou non des personnages identifiés avec Quetzalcohuatl, il n’en est pas moins certain qu’un grand nombre d’histoires sont unanimes à déclarer que ce chef principal devait retourner un jour, et, qu'en effet, il revint, soit lui-même, soit par un de ses représentants : c’est de la bouche de Montezuma que nous en avons le détail (2). Mais avant de le rapporter et de chercher par où ils se seraient éloignés, en se séparant de leurs compagnons, il nous paraît intéressant de rapprocher ici les fragments conservés par Ordoñez (3), concernant les voyages de Votan, que tout concourrait à identifier avec Quetzacohuatl. « Votan, est-il dit, écrivit un recueil sur l’origine des Indiens (4) » et leur transmigration à ces contrées. Le principal argument » de son ouvrage se réduit à prouver qu’il descend d’Imox, qu’il » est de la race des Serpents (Chan) et qu’il tire son origine de » Chivim (1); qu’il fut le premier que Dieu envoya à cette région » pour partager et peupler les terres que nous appelons aujourd’hui Amérique (2). Il fait connaître la route qu’il suivit et » ajoute qu’après avoir fondé son établissement, il entreprit différents voyages à Valum-Chivim. Ces voyages, dit-il, furent au » nombre de quatre. Dans le premier, il raconte qu’étant parti » de Valum-Votan (3), il prit sa route par le parage qu’on appelait Demeures des Treize Serpents (4). De là, il alla à Valum-Chivim, d’où il passa à la grande ville, où il vit la maison de » Dieu, que l’on était occupé à bâtir (5). Il alla ensuite à la cité » antique, où il vit, de ses propres yeux, les ruines d’un grand » édifice que les hommes avaient érigé par le commandement de » leur aïeul commun (6), afin de pouvoir par là arriver au ciel.
(1) Ceci aurait l’air de faire allusion à la ruine d’une patrie lointaine et s’accorderait avec le passage de Diodore (lib. tv, cap. 19 et 20) où il rapporte que les Carthaginois ayant découvert une île magnifique à l’occident de l'Océan Atlantique, s’en réservaient le monopole , espérant que si jamais leur ville était détruite, encore maîtres de l'Océan, ils y trouveraient un refuge contre leurs vainqueurs.
(2) Cartas de Hernan Cortes, ap. Lorenzana, pages 8t et 96.
(3) Hist, del Cielo, etc., fragm. du tome h.
(4) Dans un autre fragment, Ordoñez dit que ce ne fut pas ce Votan qui écrivit ce livre, mais un autre qui était le huitième ou neuvième descendant du premier. Quetzalcohuatl est donné également comme le premier historien de l’antiquité américaine. (Ixtlilxochitl, Hist, des Chichimèque*, tom. 1, ch. 1.) Voir aussi Nunez de la Vega, Constitui. Diœces. in Præamb. n. 34.
(1) Ordonez lire un argument du mot chivim, qu’il écrit aussi hivim, pour rappeler le chivim du pays des Hévéens de la Palestine, d’où il fait sortir les ancêtres de Votan. Dans la langue izcndale, qui était celle du livre attribué à Votan, la racine du mot chivin pourrait être chib ou chiib, qui signifie patrie, ou ghib qui veut dire armadille.
(2) Un passage fort curieux avec lequel commence l'Histoire des Soleils, duos le Codex Chimalpopoca, fait remonter d’une manière fort exacte l’époque de ce partage à l’an 955 avant l'ère chrétienne, comme on le verra plus loin,
(3) Valum-Votan, ou Terre de Votan, serait suivant Ordoñez file de Cuba. Mais dans mon dernier voyage, en contournant les montagnes qui envi-ronncnl le plateau élevé où est situé Crudad-Real de Çbiapas, j’ai visité de grandes ruines qui portent le nom de Valum-Votan , à deux lieues environ du village de Teopixça, situé à 7 I. de Ciudad־Real, et où Nuñez de la Vega dit avoir encore trouvé, en 1696, des familles du nom de Votan.
(4) Ordonez place les Demeures des Treize Serpents aux îles Canaries qui, dit-il, sont au nombre de treize : mais ces treize pourraient bien être treize chefs du pays même où était Xibalba.
(5) C’était, suivant Ordoñez et Nuñez de la Vega, le temple que Salomon était occupé à bâtir à Jérusalem. Le MS. Cakchiquel, parlant des quatre villes qui portaient le nom de Tulan, dit que l’une d’elles était la cité où était Dieu ou le dieu (la maison de Dieu ?).
(6) Ordoñez commentant ce passage y trouve tout ׳naturellement la tour de Babel : mais il s’indigne contre les Babyloniens, de ce qu’ils avaient eu la mauvaise foi de dire à Votan que la tour avait été bâtie par ordre de leur aïeul commun (Noé) : « Il faut rcmarquer ici, dit-il, que les Babyloniens » n’ont lait que tromper Votan, en lui » assurant que la tour avait été cons-» truite par ordre de leur aïeul Noé, » afin d’en faire un chemin pour arriver » au ciel : jamais certainement le saint » patriarche n’eut la moindre part » dans la folie arrogante de Nemrod. » (Mémoire MS. sur Palenqué.) Nuñez de la Vega rapporte la même tradition sur Votan et ses v0yages (Constitut. Diœces. in Præamb n. 34).
» Il ajoute que les hommes avec lesquels il y conversa lui assurèrent que cet édifice était le lieu où Dieu avait donné à chaque » famille un langage particulier. Il affirme qu’à son retour de la » ville du temple de Dieu, il retourna une première et une seconde » fois à examiner tous les souterrains par où il avait déjà passé, » et les signes qui s’y trouvaient. Il dit qu’on le fit passer par un » chemin souterrain qui traversait la terre et se terminait à la » racine du ciel. A l’égard de cette circonstance, il ajoute que ce » chemin n’était autre qu’un trou de serpent où il entra parce qu’il » était fils de serpent (1). »
(1) Ici le commentateur se lait: il n’y comprend tien. Ce trajet souterrain, cette qualité de serpent pour arriver au ciel (à la sagesse?) n’indiquerait-il point quelque initiation analogue à celles de l’Egypte ?
Nous avouons que ce n’est, maintenant, qu’avec une extrême défiance que nous accueillons ce récit, dont nous n’avons pu voir l’original indigène ; et quoique le fond nous paraisse véridique, les détails nous en semblent bien évidemment altérés. Cependant, on ne peut plus aujourd’hui révoquer en doute la réalité des communications qui existèrent anciennement entre les deux continents : à la vue des traditions si nombreuses et si significatives où les indigènes de l’Amérique affirment que leurs pères y abordèrent de l'Orient, venant par mer, il faut bien se décider à en admettre la véracité, et tout ce qui reste à faire à cet égard, c’est de discuter les moyens qu’ils employèrent et de rechercher de quels lieux ils sortirent pour s’y rendre. On revient alors, malgré soi, aux anciennes théories relatives à l’existence du continent occidental, renouvelées au temps de Colomb, et que Humboldt a résumées d’une manière si remarquable dans son Examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent. C’est dans cet ouvrage que nous puiserons au besoin les citations dont l’objet concorderait ici avec les traditions américaines.
Disons d’abord que s’il est un fait acquis à l’histoire, et dont on ne saurait plus révoquer en doute l’authenticité, ce sont, comme on l’a vu, les relations des Scandinaves avec l’Amérique dès le neuvième siècle, ce Sont leurs voyages du nord de l’Europe en Islande, de là encore au Groenland et jusque sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, durant les siècles suivants. Les détails de ces voyages sont connus par les Sagas islandaises (1), par les chroniques de plusieurs monastères du Nord et même de la France (2). Mais dans ces chroniques il ne peut être question, naturellement, que des voyageurs qui eurent la chance de revoir leur patrie ou de renouer des communications avec elle : elles ne sauraient nous entretenir de ceux qui, antérieurement aux voyages de Biarne, fils de Heriulf, auraient entrepris d’émigrer en Amérique et qui y seraient restés indéfiniment. On ignore de que] côté les Irlandais poussèrent leurs migrations : on ne sait pas davantage en quels lieux abordèrent les nombreux bateaux qui, chaque année, partaient de nos côtes et des côtes de la Grande-Bretagne pour la pêche à la morue, portés parles vents elles flots; mais si les Islandais et les Scandinaves furent assez heureux pour fonder des colonies au Groenland au neuvième siècle, il n’y a rien qui puisse nous prouver qu’eux ou d’autres n’aient pu en établir ailleurs dix siècles auparavant. Les phénomènes qui ont occasionné le refroidissement progressif du Groenland n’avaient pas encore eu lieu alors, et il est avéré, par des observations récentes, que les terres arctiques étaient anciennement plus habitables qu’aujourd'hui : on sait, d’ailleurs, que les voyages par l’Islande aux contrées adjacentes, étaient extrêmement fréquents aux premiers siècles ‘de notre ère (1).
(1) Antiquitates americanœ , sive scriptores septentrionales rerum ante-colombianarum in America, opéra et studio Caroli G. Rafn ; Copenhague 1837. Cet ouvrage malheureusement trop rare, et dont nous ne connaissons que l’exemplaire de la Société de géographie de Paris, renferme des détails d’un très-grand intérêt. Dans une suite d’articles publiés dans la Revue Américaine et Orientale (torn. 1er et suiv.), notre confrère Μ. E. Beauvois a donné une traduction des fragments les plus curieux des Sagas {Découvertes des Scandinaves en Amérique, au xe et au xiiie siècle).
(2) Dans les fragments d’Ordéric Vital, écrivain du xiie siècle, édités par Duchesnc à Paris en 1619, nous avons des preuves touchant le Vinland (la Nou-velle-Angleterre) et Je Groenland : « Orcades insulæ, dit-il, et Finlanda » (Vinlanda) , islanda quoque et » Grenlanda, ultra quam ad septentrionem terra non reperitur, aliæque plures usque in Gotlandam » Regi Noricorum subjicitur et de toto » orbe divitiæ navigio illuc advehuntur. » Notre savant confrère M. delà Roquette a communiqué dans le temps à la Société des Antiquaires du Nord la traduction de ce fragment faite par M. Guizot (Voir les addenda et emendanda de l’ouvrage Antiquitates Americanœ, pag. 461).
(1) Antiq. Americ. passim:
C’est dans ces régions septentrionales qu’existait l'Ultima Thule, dont parlent tous les géographes anciens, longtemps avant l’ère chrétienne, et que les commentateurs modernes ont placé alternativement au Danemark et en Islande. Les relations indigènes de l’Amérique prouvent, d’une manière irrécusable, que ce nom avait été donné à plusieurs localités tout à fait distinctes, et que chacune d’elles avait pu jouer un rôle à part dans l’histoire. « Dans une mappemonde islandaise datant du milieu du douzième siècle, que j’ai fait inscrire dans les Antiquités russes, » rédigées par moi, nous écrit le savant Cari Rafn (2), on rencontre au nord-ouest, loin des autres pays de l’Europe, le nom » d'Island, et plus loin vers l’ouest, on trouve le nom de Tila. Il » s’ensuit donc que l’ancien géographe islandais a appliqué le nom » de Tyle ou de Tula à une des contrées américaines découvertes par les habitants du Nord. » C’est de Tula qu’un grand nombre de traditions indiennes font également sortir la race nahuatl, et voici ce que dit à ce sujet le MS. Cakchiquel : «Quatre » personnes [vinak, gentes) vinrent de Tulan, du côté où le soleil » se lève, c’est un Tulan. Il y en a un autre en Xibalbay (3) et un » autre où le soleil se couche, et c’est là que nous vînmes, et du » côté où le soleil se couche il y en a un autre où est le dieu (4) : » c’est pourquoi il y a quatre Tulan ; et c’est là où le soleil se couche que nous vînmes à Tulan, de l’autre côté de la mer où est ce » Tulan,· et c’est là que nous avons été conçus et engendrés par nos » mères et nos pères. » De ces deux textes qui viennent se rencontrer de si loin, comme pour mettre toutes les opinions à leur aise, il résulte donc qu’il existait plusieurs Tula : il y en avait un à l'Orient, de l’autre côté de la mer (1), origine probablement du nom des trois autres qui auraient existé en Amérique, et dont le plus septentrional devait être l’Ultima Thule des ■anciens, situé dans le pays de l'Ombre, dont il est fait mention plus haut.
(2) Lettre particulière du 23 février 1861, datée de Copenhague.
(3) Tulan en Xibalbay, c’est-à-dire la cité bâtie par les Nabuas après leur colonisation en Tamoanchan.
(4) Un troisième Tulan, à l’occident, du côté américain de l'Océan, peut-être le Tile désigné par M. Rafn, qu’il faudrait placer au nord des Etats-Unis, et enfin le Tulan où est le dieu, qui correspondrait à Tula, ou Tollan, l’une des capitales tchèques de l’Anahuac, à 14 lieues au nord de Mexico, aujourd'hui la petite ville de Tula, rouie de Queretaro.
(1) Ces quatre villes ou localités du nom de Tula, sans compter peut-être encore deux ou trois autres, expliqueraient jusqu'à un certain point les dissentiments entre les divers auteurs anciens, et même la différence de leur orthographe, les uns écrivant Τουλη, les autres Τυλη, d’où Thyle et Thule, etc. Voir Cluveri Germania Antiqua, cum Vindelica et Norico, etc., contracta opera Joannis Bunonis, Guelferbyti, 1663, pag. 667 et suiv. Colomb, ‘ qui raconte avoir été plusieurs fois à Thule, environ vingt ans avant la découverte de l’Amérique, et qui désigne la situation dç ce lieu assez loin au nord-ouest de la Grande-Bretagne, ne se doutait pas alors qu’il avait touché cette même terre, objet de ses espérances et de ses vœux. Bolturini, Veylia et d’antres auteurs voient dans le premier Tulan, la Babylonie et la tour de Babel ; parce que ce fut là qu’eut lieu le changement des langues, tradition que semblerait confirmer au premier abord un verset du Livre Sacré (voir pages 217 et 221 ) D’autres ajoutent que Tulan est la prononciation nahuatl de Turan l(Touran), la Mongolie et la | Tartarie, ainsi appelées d’après Tur, fils de Féridoun, ancien roi de Perse (Malcolm’s Hist, of Persia, vol. 1, pag. 2, note). — Drummond’s Origines , etc. vol. I, pag. 298.'Ce n’est pas absolument invraisemblable.