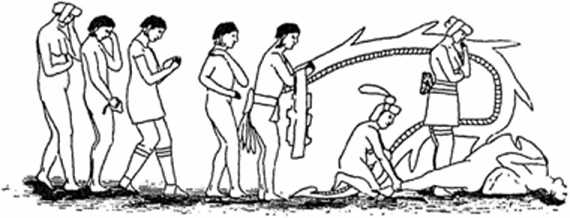
Lorsque Colomb découvrit les indigènes du Nouveau Monde en 1492, il n'y avait aucun doute dans son esprit qu'il s'agissait d'Asiatiques de l'Est, et il commença aussitôt à les appeler Indiens. Il aurait emporté cette croyance avec lui dans sa tombe. Mais bien avant sa mort, un certain nombre d'Européens soupçonnèrent que les nouvelles terres n'étaient pas du tout Cathay, suspicion fortement renforcée lorsque Balboa atteignit la côte du Pacifique en 1513 et confirmée sans l'ombre d'un doute par le voyage de Magellan six ans plus tard.
La découverte de l’existence d’une autre vaste mer au-delà des limites occidentales de l’Amérique a immédiatement suscité des spéculations sur l’origine de l’Indien d’Amérique. Était-il originaire de ce nouveau continent et l’avait-il toujours été ? Sinon, d’où venait-il et comment ? Ainsi commença un grand débat qui dure depuis plus de quatre siècles et qui a impliqué non seulement des universitaires, mais aussi des organisations, des nations et même des religions. Car l’origine de l’Indien d’Amérique, qui, avec l’Égypte antique, Stonehenge et les monuments de l’île de Pâques, a toujours fasciné les mystiques, est un sujet hautement chargé d’émotion, comme le sont tant d’autres sujets où science et religion, ou amateur et professionnel s’affrontent, et où se mêlent valeurs racistes, nationalistes et ethniques. Bien qu'il s'agisse d'un corps de théorie bien plus ancien que celui de l'évolution biologique, il a suivi un parcours curieusement similaire, les scientifiques adoptant souvent une position générale opposée à la plupart des hypothèses profanes et à presque toutes les hypothèses religieuses, sans pour autant trouver d'accord exact entre eux, tandis que les profanes, unis pour caractériser tous les savants professionnels comme étant soit des athées, soit des idiots, soit les deux, sont à leur tour accusés de s'élancer dans toutes les directions théoriques à la fois.
De même que la controverse sur l’évolution a attiré des adversaires inattendus comme Clarence Darrow et William Jennings Bryan, les débats sur les Indiens d’Amérique ont opposé prêtres et professeurs, médecins et avocats, hommes d’affaires et artistes, et même un président et un vice-président des États-Unis. Les professeurs les plus dignes qui se sont laissés entraîner semblent s’adapter rapidement au sarcasme mordant et au langage décomplexé qui animent ce qui pourrait autrement être un domaine d’investigation assez ennuyeux. Par exemple, le professeur Ralph Linton, ancien éminent anthropologue de Yale, a déclaré dans une critique de livre publiée dans American Antiquity, la revue officielle de l’archéologie américaine, à propos de Harold S. Gladwin, qui avait écrit un livre suggérant, entre autres choses, que les survivants de la flotte naufragée d’Alexandre le Grand avaient trouvé le chemin de l’Amérique au IVe siècle avant J.-C. et étaient à l’origine de certaines des grandes civilisations préhistoriques de cet hémisphère : « M. Gladwin aborde le problème des origines américaines avec la plaisanterie hésitante d'un vieux monsieur tapotant les fesses d'une nouvelle secrétaire. Si elle s'y oppose, il peut se plaindre de son manque d'humour ; si elle ne s'y oppose pas, les prochaines étapes sont évidentes.
Outre les personnes qui ont défendu les différentes théories sur l’origine indienne, certaines institutions et organisations célèbres s’y intéressent de manière plus que occasionnelle – par exemple les Rosicruciens, les Théosophes, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les Mormons) et bien sûr la profession anthropologique elle-même. En plus des positions institutionnelles, il y en a beaucoup d'autres qui ont été défendues en prose éloquente dans des centaines de livres au cours des quatre derniers siècles, ou lues solennellement devant des congrès de sociétés savantes ici et en Europe, par des érudits qui étaient sûrs que nos Peaux-Rouges étaient autrefois des Phéniciens de Tyr, des Assyriens, des anciens Égyptiens, des Cananéens, des Israélites, des Troyens, des Romains, des Étrusques, des Grecs, des Scythes, des Tartares, des Bouddhistes chinois, des Hindous, des Mandingues ou d'autres Africains, des Malgaches, les premiers Irlandais, Gallois, Scandinaves, Basques, Portugais, Français, Espagnols, Huns, ou des survivants des continents perdus de Mu ou de l'Atlantide, cette dernière étant une théorie particulièrement difficile à débattre, puisque leurs prétendues grandes civilisations ont commodément coulé sous l'océan il y a quelque onze mille ans ou plus, Platon étant peut-être la première autorité dont nous disposons pour leur existence. Certains ont soutenu que nos Indiens ne descendent d'aucun de ces peuples, mais que l'Homme est originaire des Amériques et que l'Ancien Monde est alors en réalité le Nouveau.
Le cycle de popularité de ces diverses idées suggère qu’elles ont au moins quelque chose de la nature d’une mode. Les premiers explorateurs et historiens de l’Amérique avaient tendance à favoriser l’hypothèse des tribus perdues d’Israël, car à cette époque, l’ethnologie hébraïque antique telle que décrite dans l’Ancien Testament était à peu près le seul mode de vie « primitif » bien documenté et donc le premier à venir à l’esprit d’un chercheur de relations indiennes. Les classicistes du XVIIIe et du début du XIXe siècle avaient tendance, d’un autre côté, à voir des traits carthaginois-phéniciens dans l’art, l’architecture, la langue, la religion et la structure politique des Mayas d’Amérique centrale, des civilisations aztèques et pré-aztèques du Mexique, et des Incas et autres hautes cultures des Andes d’Amérique du Sud. Avec les découvertes archéologiques spectaculaires en Égypte, une vague d’écrivains est apparue convaincue que toute civilisation provenait de la vallée du Nil et que nos ruines préhistoriques américaines n’étaient que des vestiges des colons égyptiens.
L'Atlantide perdue est un favori depuis des générations, stimulé à nouveau tous les deux ou trois ans par les éditions des best-sellers de Spence et Donnelly ; et la théorie israélite, elle aussi, a de nombreux adeptes, car il est de la doctrine de l'Église mormone que nos aborigènes sont les descendants des Hébreux et que leurs pérégrinations en Asie et aux Amériques sont fidèlement décrites dans le Livre de Mormon dicté par Dieu. La dernière en vogue, l'idée que les Indiens d'Amérique ont navigué vers l'ouest à travers le Pacifique et ont peuplé les îles polynésiennes, a un énorme succès actuel grâce au grand récit d'aventure de Thor Heyerdahl sur son audacieux voyage sur le radeau de balsa, le Kon-Tiki. Certains des mêmes visiteurs du musée qui, il y a vingt ans, s'adressaient aux scientifiques mal à l'aise et les réprimandaient pour leur manque de foi dans l'Atlantide engloutie, brandissent aujourd'hui les mêmes doigts réprimandés à ceux qui ne manifestent pas d'enthousiasme pour Aku-Aku.
Il est étrange que les explications, nombreuses et variées, des origines des Indiens d’Amérique ne se soient pas vraiment affrontées. Les partisans de la théorie carthaginoise ont également approuvé un mouvement israélite vers l’Amérique (pour expliquer les tribus les plus sauvages, cependant) ; certains égyptianistes sont tout à fait disposés à reconnaître également l’Atlantide perdue ; les rosicruciens et les théosophes ont beaucoup à dire sur l’Atlantide et son homologue du Pacifique, Mu. Mais, en contraste frappant avec cette tolérance permissive des autres théories en général, les auteurs profanes sur ces sujets ont tous un grand parti pris en commun : ils méprisent, ridiculisent et se plaignent amèrement des anthropologues professionnels des musées et des universités américaines, qu’ils considèrent tantôt comme stupides, têtus, désespérément conservateurs et très souvent carrément malhonnêtes.
Cela laisse perplexe les spécialistes, qui ne trouvent rien de particulièrement choquant dans leur conception d’un berceau asiatique pour les Indiens d’Amérique, à l’image de ce que Thomas Jefferson a décrit dans sa Note sur l’État de Virginie, le peuplement de l’Amérique s’étant effectué par une série de vagues d’invasion via le détroit de Béring et l’Alaska au cours des vingt-cinq à cinquante mille ans qui ont suivi la période médiane et finale de l’ère glaciaire. Un nombre croissant d’anthropologues pensent également que certaines hautes civilisations américaines, comme les Mayas, ont reçu une impulsion supplémentaire des contacts transpacifiques avec l’Asie du Sud-Est. Pour les mystiques, il s’agit là d’une position théorique intolérablement conservatrice et dénuée d’imagination.
Ce sont les théories qui s'affrontent et c'est ici qu'elles se livrent bataille. Les combats ont été acharnés et les pertes lourdes. Le célèbre érudit du XIXe siècle, l'abbé Brasseur de Bourbourg, a perdu ses amis et sa réputation. Le noble anglais Edward King, vicomte de Kingsborough, dont nous parlerons dans un chapitre ultérieur, a dépensé une fortune pour sa passion pour la théorie des tribus perdues d'Israël et est mort, selon certains, le cœur brisé, dans une prison pour débiteurs de Dublin. L'aventurier français, autrefois docteur en médecine, ingénieur, avocat et archéologue, Augustus Le Plongeon et sa jeune épouse, Alice, après avoir passé de nombreuses années dans les fourrés épineux de la péninsule aride du Yucatan, à explorer les ruines antiques du passé oublié des Mayas, ont vécu leurs dernières années déçus et profondément amers par le rejet de leurs théories farfelues sur la civilisation américaine qui s'était installée en Égypte il y a plusieurs milliers d'années. James Adair a consacré quarante ans de sa vie à l'étude directe des Indiens d'Amérique, mais ses affirmations selon lesquelles ils étaient les tribus perdues d'Israël lui ont valu des railleries et même des accusations de malhonnêteté. Piqué au vif par les critiques scientifiques, Thor Heyerdahl a bravé le Pacifique sur un radeau de balsa pour soutenir ses théories selon lesquelles les Indiens d'Amérique du Sud peuplaient le Pacifique, et aujourd'hui plusieurs érudits mormons fervents s'opposent, comme certains de leurs malheureux prédécesseurs, au monde de la science et de l'érudition dans leur conviction que le Livre de Mormon est la véritable histoire des peuples israélites d'Amérique.
Un nombre croissant de personnes, dans ce pays et à l'étranger, sont intriguées, voire obsédées par toutes les formes de symbolisme, surtout si elles sont d'une certaine manière ésotérique, et surtout si elles peuvent être reliées à la culture et aux origines des Indiens d'Amérique, en particulier des Mayas, des Aztèques et des Incas, dont les civilisations préhistoriques colorées les attirent comme des mouches vers le miel. Elles peuvent s'immerger dans des symboles bizarres, des rituels les plus dramatiques et les plus sacrés, des hiéroglyphes mystérieux, des temples antiques enveloppés de jungle, des langues non indo-européennes dont les syllabes étranges se prêtent à des jeux sans fin de colin-maillard linguistique, et des religions polythéistes aux fortes connotations mathématiques, astrologiques, sadiques et phalliques. Leur fascination pour ces livres devient une addiction, dans certains cas littéralement une religion, et en s’accrochant à leurs croyances sur l’Amérique aborigène, face aux rebuffades souvent brutales des anthropologues professionnels, ils se sentent persécutés, martyrisés par une sorte de destin mi-scientifique, mi-religieux qu’ils ne peuvent nier. Leurs écrits sont fréquemment truffés de références au Tout-Puissant, à la théologie et à l’éthique dans des passages dont le lecteur non initié ne voit pas la pertinence. Les marchands de livres d’occasion en sont bien conscients, car ils hantent les rayons des librairies marqués « ésotérisme, occultisme et curiosités ».
Certains de ces hommes étaient de véritables charlatans, des opportunistes moins intéressés par la quête de la vérité que par l’argent et la notoriété que leurs écrits et leurs conférences leur rapportaient. D’autres étaient stupides, incapables de distinguer les faits de la fantaisie. D’autres encore étaient des érudits consciencieux, des travailleurs infatigables et des hommes d’une grande intégrité, mais victimes de l’ignorance de leur époque, souvent encore plus handicapés par des années d’isolement du monde universitaire alors qu’ils exploraient les vastes jungles et les villages indiens reculés des hautes terres à la recherche de connaissances sur le passé américain. La plupart d’entre eux – charlatans, idiots et érudits – ont partagé certaines attitudes et certains traits de personnalité qui leur confèrent, en tant que groupe, une certaine identité.
On se demande quelles sont ces théories qui captivent à ce point l’imagination et la fidélité farouche, et quel genre d’hommes sont si obsédés par les interprétations mystiques et religieuses du passé américain ancien qu’ils les suivent, parfois littéralement, jusqu’à la mort contre toute opposition. Dans les pages qui suivent, nous examinerons de plus près ces théories et les personnes qui les ont si ardemment défendues.
La théorie la plus répandue sur les origines des Indiens d’Amérique fait probablement remonter les célèbres civilisations antiques du Mexique, d’Amérique centrale et des Andes à l’Égypte. Il y avait des pyramides en Amérique et en Égypte, des momies au Pérou et en Égypte, le culte du soleil était pratiqué dans de nombreuses régions du Nouveau Monde ainsi qu’en Égypte, et ces deux régions ont produit des écritures hiéroglyphiques, des tombes royales, des sculptures en bas-relief et un certain nombre d’autres coutumes et traits culturels similaires. Pour la plupart des gens, le mot « archéologie » n’évoque qu’une seule image : les pyramides imposantes, le Sphinx menaçant, le tombeau du roi Toutankhamon et la vallée du Nil. Il est tout à fait naturel que lorsqu’ils voient des reliques antiques comme celles-ci ailleurs, même dans la lointaine Amérique, ils voient un lien avec l’expression classique des civilisations antiques : l’Égypte dynastique.
Parmi les nombreux passionnés d'Egypte, l'un des plus dévoués, des plus farouchement fidèles et des plus militants était un aventurier français, Augustus Le Plongeon, dont les dénonciations acerbes de ses ennemis et l'étalage arrogant de son propre ego ont marqué une époque sinistre dans l'histoire de l'archéologie américaine. Faisons la connaissance de ce personnage vivant à travers un incident typique qu'il décrit lui-même.
Les versions diffèrent, mais Augustus Le Plongeon lui-même raconte qu'il venait de déterrer la statue d'un ancien dieu maya dans les débris des grandes ruines de pierre de Chichen Itza, dans les fourrés brûlés du nord du Yucatan, et que ses ouvriers indiens superstitieux refusèrent de la toucher, et encore moins de la sortir de la terre et de la marne sacrées qui l'avaient cachée pendant plus de six cents ans. C'était un grand trésor archéologique, et le Français à la longue barbe, le visage et le crâne chauve presque noirs de ses nombreuses années d'exploration dans la péninsule tropicale brûlée par le soleil, était déterminé à ne pas se laisser tromper par sa découverte.
Le Plongeon ne savait pas encore que le destin avait déjà décidé qu’il ne pourrait pas avoir cet énorme dieu de pierre couché. Son problème immédiat était de persuader les indigènes de faire ce qu’il voulait et de le faire sortir de terre. Ressemblant plus à Moïse après quarante ans dans le désert qu’à un aventurier et mystique de cinquante ans avec une jeune et belle épouse, le soi-disant docteur était un homme têtu, peut-être l’un des individus les plus obstinés et les plus grincheux qui aient jamais vécu ; il était aussi l’un des plus imaginatifs. Une personne plus prosaïque aurait pu essayer de persuader les Indiens et de les raisonner, mais cette approche était complètement étrangère à la personnalité unique et volatile de Le Plongeon. Caressant sa longue barbe grise et regardant ses ouvriers rebelles d’un air menaçant, il eut soudain une idée. Les gens obéissent aux dieux : je vais les convaincre que je suis un dieu maya réincarné ! Il leur fit signe impérieusement de le suivre.
Le petit groupe escalada les amas de ruines calcaires blanchies, traversa les broussailles emmêlées et les fourrés de broussailles épineuses, et peina à atteindre le sommet d'une structure en ruine surplombant la plaine vert olive terne du Yucatan. Un panneau de pierre sculpté était exposé dans les décombres antiques. Laissons Le Plongeon raconter lui-même l'histoire, telle qu'il l'a rapportée dans un livre publié en 1878 :
Pour vaincre leurs scrupules, et aussi pour prouver si mes soupçons étaient fondés, que, comme leurs ancêtres et les anciens Egyptiens, ils croyaient encore à la réincarnation, je les fis accompagner au sommet de la grande pyramide. ... Sur l'une des antas, à l'entrée du côté nord, est le portrait d'un guerrier portant une longue barbe droite et pointue. Le visage, comme celui de tous les personnages représentés, est de profil. J'appuyai ma tête contre la pierre de manière à présenter la même position de mon visage ... et j'attirai l'attention de mes Indiens sur la similitude de ses traits et des miens. Ils suivirent du doigt chaque linéament des visages jusqu'à la pointe même de la barbe, et bientôt poussèrent une exclamation d'étonnement : « Toi, ici », et parcoururent lentement de nouveau les traits sculptés sur la pierre et les miens. « Ainsi, ainsi, dirent-ils, toi aussi tu es un de nos grands hommes, qui a été désenchanté. Toi aussi tu étais un compagnon du grand Seigneur Chaacmol. C’est pourquoi tu savais où il était caché et tu es venu pour le désenchanter aussi. Son heure de vivre à nouveau sur terre est donc arrivée. » A partir de ce moment, chacune de mes paroles fut implicitement obéie.
Le lendemain, un autre groupe d’Indiens arriva pour voir le grand homme. Il les conduisit de nouveau au bas-relief et leur fit voir sa pose de la veille. Les étrangers « tombèrent à genoux devant moi et, à leur tour, baisèrent ma main ».
On a l'impression, d'après les écrits du docteur, qu'il était le plus heureux dans les champs, où il trouvait, parmi d'humbles et ignorants ouvriers indigènes, l'adulation réelle ou imaginaire qu'il recherchait si vainement aux États-Unis. Les anecdotes qu'il raconte sur lui-même révèlent un égoïsme étonnant qui va jusqu'à la folie des grandeurs. Il serait presque plus gentil envers Le Plongeon de considérer toute cette histoire comme une invention, car je ne peux imaginer de scène plus comique et en même temps plus pitoyable que celle-ci, où des Indiens confus et sans doute embarrassés murmuraient des paroles probablement incompréhensibles tandis que le Don Quichotte gaulois prenait des poses héroïques à côté d'un dieu de pierre des anciens Mayas.
Je ne sais pas si Le Plongeon a inventé ces anecdotes par pure fantaisie ou si, comme cela semble probable, il était si incompétent en maya parlé qu'il a simplement mal compris une grande partie de ce que les Indiens disaient. Il existe de nombreuses preuves en faveur de chacune de ces possibilités. D'une part, les histoires variaient manifestement selon les récits. Un ami de Le Plongeon a entendu l'incident ci-dessus de manière tout à fait différente : les Indiens ont remarqué la ressemblance entre Le Plongeon et la figure sculptée, et toutes les dénégations du Français n'ont pas pu persuader les indigènes qu'il n'était pas le Maya réincarné. D'autre part, les histoires sont incompatibles avec ce que nous savons des Mayas à cette époque, et les informations à leur sujet provenant de voyageurs moins fantaisistes étaient désormais abondantes. En 1883, ils étaient tous catholiques romains et avaient été exposés à l'enseignement et à la supervision catholiques pendant plus de trois siècles. Ils n'avaient certainement aucune idée de la réincarnation, qui est et a toujours été un concept étranger à leur idéologie religieuse, malgré l'histoire de Cortez qui était considéré comme le Quetzalcoatl réincarné. De plus, en 1880, aucun Indien du Yucatèque n'était probablement superstitieux à propos des ruines et des antiquités mayas qui l'entouraient, contrairement aux Mayas des hautes terres plus au sud du Guatemala, qui sont encore aujourd'hui perturbés par les profanations de leurs anciens lieux de culte.
Les ouvriers indiens du Yucatan sont très soucieux de plaire à leurs supérieurs au gouvernement ou à leurs employeurs ; ils essaient désespérément de comprendre ce qu'on leur dit dans un espagnol pauvre (qu'ils ne comprennent souvent pas très bien eux-mêmes) ou dans une langue maya yucatèque encore plus mauvaise. Peut-être à cause des barrières linguistiques, ils apprennent rapidement à observer les gestes et les expressions de leur employeur et essaient de deviner ce qu'il veut qu'ils fassent ou disent. N'importe qui, avec ou sans une longue barbe pointue, qui ferait les gestes décrits par Le Plongeon, obtiendrait sans doute à peu près la même réponse coopérative de la part des ouvriers indiens espérant plaire au patron. Les mots et les expressions que Le Plongeon leur fait dire ont sûrement été mis dans leur bouche par lui, par l'intermédiaire d'un interprète, ou ont été complètement mal compris. Même leur discours, tel que cité par le médecin, est trompeur ; s'ils lui ont parlé à la deuxième personne, ce n'était pas par formalité ou solennité (comme cela sonne en anglais) mais parce que c'est la seule construction qu'ils utilisent. Le pronom respectueux de la troisième personne est rarement entendu parmi eux, même aujourd'hui.
Quoi qu’on puisse penser de ces tactiques, ou de la satisfaction évidente que le Français presque paranoïaque tirait de son adoration réelle ou imaginaire de la part de ces indigènes ignorants, la manœuvre fut apparemment efficace, et le dieu de pierre sortit de son trou – pour être à nouveau disputé par Le Plongeon et les fonctionnaires du gouvernement mexicain qui refusèrent de le laisser le récupérer hors du pays. Cette statue couchée faisait partie d’une série de figures similaires qui ont depuis été découvertes au Yucatan et au Mexique proprement dit, appelées figures de Chac Mool, et bien que leur identité soit aujourd’hui débattue par les experts, Le Plongeon n’avait aucun doute qu’elles représentaient un prince-dieu indien qui figurait en bonne place dans l’histoire et la religion de l’Égypte ancienne et de la préhistoire maya-toltèque. Car Le Plongeon croyait en un lien historique direct entre les civilisations du Mexique, de l’Amérique centrale et de l’Égypte. Il soutenait en outre que la forme des temples mayas était délibérément conçue pour représenter la lettre égyptienne M, qui, disait-il, s’appelait « ma » et signifiait « lieu, pays et, par extension, l’Univers ». Il était sûr que les anciens mystères sacrés, à l'origine de la franc-maçonnerie par conséquent, provenaient d'Amérique et avaient été transportés par les colons mayas jusqu'au Nil, à l'Euphrate et aux rives de l'océan Indien il y a au moins 11 500 ans.
Le Plongeon a reconstitué en détail une interprétation sanglante de l'histoire maya basée uniquement sur des sculptures, des peintures murales et des tests hiéroglyphiques que les autorités en épigraphie maya d'aujourd'hui ne prétendent pas pouvoir lire. C'est une longue histoire et son impact romantique souffre dans le synopsis : Le roi de Chichen Itza et d'Uxmal, aujourd'hui deux ruines mayas du Yucatan, avait trois fils, Cay, Aac et Coh, et deux filles, Moo et Nicte. Selon la loi maya, le plus jeune fils devait épouser la fille aînée pour assurer la descendance légitime et divine de la famille royale, une pratique également connue chez les Égyptiens et les Péruviens. Le prince Coh épousa ainsi Moo, mais Aac, qui l'aimait aussi, l'assassina. (Le Plongeon a exhumé une pointe de projectile en pierre et une urne contenant ce qui semblait être des cendres ; il a immédiatement affirmé qu'il s'agissait du cœur incinéré de Coh et de la pointe de lance avec laquelle il avait été tué.)
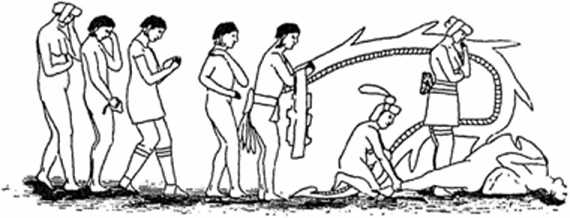
Dessin de Le Plongeon représentant la décoration d'un temple maya qui, selon lui, représentait l'exécution du prince Coh par son frère rival, Aac. La veuve, la reine Moo, et ses assistantes sont des personnes en deuil.
Au cours de la guerre civile qui suivit, Aac, devenu roi d'Uxmal, courtisa la reine Moo de Chichen Itza, mais elle le repoussa. Une sculpture maya dont Le Plongeon affirmait qu'elle représentait cette scène, pourrait tout aussi bien, ajouta-t-il, représenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden ; en effet, selon Le Plongeon, l'histoire de l'Ancien Testament est la même anecdote, mais déformée par un vieux célibataire misanthrope, peut-être l'auteur de la Genèse, qui modifia la version maya par dépit pour avoir été lui-même abandonné par une femme amoureuse.
Fuyant la colère de son frère, Moo espérait trouver refuge à l'est, dans quelque vestige du Continent Perdu de l'Atlantide (Le Plongeon y souscrivait aussi), mais échouant, elle continua son voyage et atteignit enfin les colonies mayas établies depuis de nombreuses années sur les rives du Nil.
Les colons l'accueillirent à bras ouverts, l'appelèrent « petite sœur » (Isis) et la proclamèrent reine. Mais elle finit par tomber entre les mains d'Aac, qui la maltraita et la fit mourir avec Cay, son frère aîné.
Le Plongeon déclare avec douceur dans sa préface à La Reine Meuh et le Sphinx égyptien : « Dans cet ouvrage, je n’offre aucune théorie. En matière d’histoire, les théories ne prouvent rien. Elles sont donc hors de propos. Je laisse mes lecteurs tirer leurs propres conclusions des faits qui leur sont présentés. » Puis, comme d’habitude, « Quelles que soient leurs conclusions, cela ne me regarde pas… »
En réalité, malgré ses fréquentes déclarations provocatrices de ce genre, l'opinion de ses lecteurs était d'une importance vitale pour Le Plongeon. Il se hérissait à la moindre exception à ses convictions, il écrivait de longues lettres dans lesquelles il se plaignait d'être persécuté par les savants et les fonctionnaires, et quarante ans après sa mort, ses amis proches se souvenaient que ses dernières années avaient été aigries par son échec à obtenir une reconnaissance scientifique.
Un contemporain de Le Plongeon, John T. Short, dans son livre très lu The North Americans of Antiquity, regrettait que l’enthousiasme du soi-disant docteur fût si apparent dans ses rapports, ajoutant : « un état d’esprit judiciaire, ainsi que le calme qui l’accompagne, sont nécessaires à la fois au travail scientifique et à l’inspiration de confiance chez le lecteur. » Cela rendit furieux le Français, qui répondit par cette explosion : « Merci pour le conseil ! Mais je vais demander à M. Short ce qu’il sait en fait du Yucatan et de l’histoire de ses habitants primitifs. Existe-t-il quelque part un homme qui, aujourd’hui, connaisse ces choses de manière à prétendre émettre une opinion à leur sujet ? Que sait M. Short des monuments du Yucatan ? A-t-il jamais lu une description vraie ? Où ? Elle n’a jamais été publiée à ma connaissance. Qui est le mieux placé pour les connaître, M. Short, qui ne les a jamais vus, ou le Dr Le Plongeon, qui les a étudiés spécialement in situ pendant sept ans ?
En fait, en 1881, lorsque ces lignes furent écrites, la littérature sur les antiquités du Yucatan était abondante et dans certains cas tout à fait compétente. John Short et Augustus Le Plongeon auraient tous deux pu très facilement lire, par exemple, les quatre volumes extrêmement populaires de Incidents of Travel (1841, 1843) de John Lloyd Stephens et les gravures remarquablement précises de ruines mayas de son compagnon architecte, Frederick Catherwood.
Qui était ce dragon imaginatif, cracheur de feu, défiant si hargneusement ses ennemis, réels ou imaginaires ? Curieusement, de ce mystique éloquent et voyageur, qui s’est impliqué dans tant de batailles verbales et juridiques et qui a écrit de volumineuses lettres à tous ceux qui voulaient les lire, nous savons très peu de choses sur sa carrière pré-archéologique. Né sur l’île de Jersey en 1826 – son grand-oncle maternel était Lord Jersey – et ayant fréquenté l’école militaire de Caen et l’Institut Polytechnique de Paris, il acheta avec un camarade un yacht, avec lequel ils naviguèrent jusqu’à la côte ouest de l’Amérique du Sud. Au large des côtes du Chili, une violente tempête s’éleva. Pendant de longues heures tortueuses, ils luttèrent contre les vents violents et la mer démontée, cherchant en vain un refuge le long de ce rivage traître. Finalement, dans un rugissement soutenu d’une intensité proche de celle d’un ouragan, les vagues monstrueuses engloutirent le petit navire et, lorsqu’il sombra, chacun se retrouva seul. Quoi qu'on puisse dire de l'esprit passionné de Le Plongeon, de sa vanité colossale et de son obstination perverse, il faut lui reconnaître aussi un courage extraordinaire. Il a opposé sa propre force, qui devait être considérable pour lui permettre de traverser tant d'années sous les tropiques en proie à la fièvre, à une mer déchaînée, et il a gagné. De toute cette compagnie, seuls Le Plongeon et son co-capitaine ont survécu ; le Français a atteint le rivage, battu en chancelant, épuisé, à moitié noyé, mais toujours très vivant et, en peu de temps, il a retrouvé son ancienne personnalité confiante et égoïste.
Il est typique de la volonté obstinée de Le Plongeon de ne pas rentrer en France et chez lui déprimé, mais de voir dans ce nouveau pays une épreuve pour son esprit d’initiative et son esprit d’initiative. Il obtint un poste de professeur de dessin, de mathématiques et de langues dans un collège de Valparaiso, et quiconque étudie l’intensité résolue de cet homme ne s’étonnera pas d’apprendre que lorsqu’il repartit, ce ne fut pas comme un voyageur timide qui avait renoncé à naviguer à nouveau pour toujours, comme beaucoup le feraient dans des circonstances similaires, mais comme capitaine d’un navire en route pour la Californie. Ceux qui ont suivi sa carrière violente ultérieure ne s’étonnent pas non plus de lire que ce deuxième voyage rencontra également de redoutables tempêtes ; comme sa veuve le nota plus tard, « le navire était réduit à un état pitoyable ». C’était encore l’époque des grands risques en haute mer. Frederick Catherwood, l'architecte anglais de talent qui s'est immortalisé et a suscité l'intérêt du monde entier pour les ruines mayas du Yucatan et d'Amérique centrale avec ses magistrales lithographies des anciennes cités visitées par lui et son compagnon, John Lloyd Stephens de New York, a disparu en mer lors d'un voyage similaire du Panama à la Californie et à peu près à la même époque. Mais cette fois, Le Plongeon et son navire ont fait escale ensemble.
San Francisco fut un autre défi pour Augustus Le Plongeon. Apparemment bien formé en dessin et en mathématiques, il devint finalement arpenteur de la ville et du comté. Il fit une précieuse connaissance en la personne de Stephen J. Field, qui devint plus tard juge à la Cour suprême des États-Unis. Mais il ne put se fixer et retourna en Europe et en Angleterre. L’envie de déménager le saisit à nouveau et il s’embarqua pour l’île de Saint-Thomas, puis pour Veracruz, puis traversa le Mexique jusqu’à Acapulco à cheval. « À son retour à San Francisco », écrivit sa femme Alice dans une nécrologie, « le Dr Le Plongeon se mit à pratiquer le droit et réussit ; mais certains événements l’attirèrent vers la pratique de la médecine, dans laquelle il se fit rapidement un nom pour la manière remarquable dont il guérit divers patients qui avaient été déclarés incurables. » Étant donné que Mme Le Plongeon, dans son récit assez détaillé de la scolarité antérieure de son mari, ne mentionne aucune école de droit ou de médecine particulière, il semble juste de déduire qu'Augustus Le Plongeon n'a en fait reçu qu'une formation très limitée en droit ou en médecine et qu'il a peut-être lui-même décerné les diplômes de docteur en médecine et de docteur en droit. Dans ses écrits, il se référait invariablement au nom de Dr Le Plongeon. Lorsqu'il fut plus tard chargé d'étudier l'archéologie au Pérou, il y établit un hôpital privé où, selon sa veuve, « il introduisit l'application de l'électricité dans les bains médicinaux et effectua des guérisons notables ». Au Yucatan, il se serait fait aimer des indigènes en les traitant contre la fièvre jaune, ayant lui-même survécu à une crise de cette maladie et se considérant au moins partiellement immunisé contre cette terrible maladie.
Au Pérou, Le Plongeon s’intéressa également aux tremblements de terre. Il inventa un sismographe et un sismomètre grâce auxquels, selon sa femme, il pouvait prédire l’approche et la direction d’un tremblement de terre, et publia des articles sur ce sujet dans le Van Nostrand’s Magazine de New York. Après de nouveaux voyages à New York, Londres et Paris, il revint au Yucatan en 1875, « au péril de sa vie », écrivit Alice Le Plongeon, « car la guerre des races était très active à cette époque ». Pendant plus de trente ans, il explora les cités mayas en ruines de la péninsule, publia ses théories spectaculaires et mena une guerre verbale contre les anthropologues américains et les fonctionnaires du gouvernement mexicain, qu’il accusait d’avoir confisqué illégalement les antiquités qu’il avait fouillées.
Le Plongeon a apparemment dépassé les bornes pour chaque idée qui lui est venue à l'esprit ou à quiconque. Il était totalement incapable d'examiner de manière critique les preuves factuelles ou logiques portant sur une théorie à laquelle il voulait croire. Lorsqu'il a trouvé une ligne sur un linteau sculpté dans une ancienne ruine du Yucatan et qu'il a remarqué des motifs en zigzag à proximité, il a immédiatement décidé que les Mayas préhistoriques communiquaient au moyen de fils télégraphiques électriques ! La nature du raisonnement de Le Plongeon se reflète davantage dans son analyse du dieu de pierre Chac Mool qu'il a eu tant de mal à exhumer :
Quant à la posture conventionnelle donnée à toutes les statues des souverains et autres personnages illustres de Mayach [couchées sur le dos, les genoux repliés et le visage tourné de côté], elle confirme le fait de leurs origines géographiques. Si l'on compare, par exemple, les contours de l'effigie du prince Coh découverte par l'auteur à Chichen-Itza en 1875, avec le contour des côtes orientales du continent américain, en plaçant la tête à Terre-Neuve, les genoux au cap Saint-Roque et les pieds au cap Horn, il est facile de s'apercevoir qu'ils sont identiques. La cuvette peu profonde tenue sur le ventre de la statue, entre les mains, serait alors symbolique du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes.

Chac Mool, statue couchée d'un ancien dieu maya-mexicain, découverte par l'imaginaire Augustus Le Plongeon, qui croyait que les Mayas venaient de l'Atlantide perdue et avaient plus tard créé la civilisation égyptienne. Il déclara que le contour de cette sculpture représentait les continents nord et sud-américains, séparés par le golfe du Mexique, et révélait ainsi la profonde connaissance des Mayas en géographie. Ajter Proskouriakoff.
Une lettre adressée le 1er mai 1877 à l'honorable John W. Foster, ministre des États-Unis au Mexique, sur l'île de Cozumel, aujourd'hui une station touristique en plein essor au large de la côte est du Yucatan, montre l'esprit de Le Plongeon bouillonnant de questions, de spéculations et de notions de toutes sortes. Au milieu d'une épître qui devait faire trente pages manuscrites, sans doute composées à la lueur d'une bougie ou d'une torche, on trouve les passages suivants :
Ces édifices intérieurs appartiennent à une époque très ancienne, et parmi les débris j'ai trouvé une tête d'ours sculptée avec une grande finesse dans un bloc de marbre. Elle est inachevée. Quand les ours ont-ils habité la péninsule ? Chose étrange, les Mayas ne donnent pas le nom de l'ours. Pourtant, un tiers de cette langue est du grec pur. Qui a apporté le dialecte d'Homère en Amérique ? Ou qui a apporté en Grèce celui des Mayas ? Le grec est le rejeton du sanscrit. Le maya ? Ou sont-ils contemporains ? Un indice pour les ethnologues afin de suivre les migrations de la famille humaine sur ce vieux continent. Les hommes barbus dont les portraits sont sculptés sur les piliers massifs de la forteresse de Chichen-Itza appartenaient-ils aux nations mayas ? La langue maya n'est pas dépourvue de mots de l'assyrien...
Les mœurs, la religion, l'architecture de ce pays n'ont rien de commun avec celles de la Grèce. Qui porta les Mayas au pays d'Hélène ? Étaient-ce les Caras ou les Cariens, qui ont laissé des traces de leur existence dans plusieurs contrées de l'Amérique ? Ce sont les plus anciens navigateurs connus. Ils parcoururent les mers bien avant les Phéniciens. Ils débarquèrent sur les côtes nord-est de l'Afrique, de là ils entrèrent dans la Méditerranée, où ils devinrent redoutables comme pirates, et s'établirent ensuite sur les rivages de l'Asie Mineure. D'où venaient-ils ? Quelle était leur origine ? Personne ne le sait. Ils parlaient une langue inconnue des Grecs, qui se moquaient de la façon dont ils prononçaient leur propre idiome. Étaient-ils des émigrés de ce continent occidental ? La tunique de lin blanc, qui ne demandait pas d'attache, dont se servaient les femmes ioniennes, selon Hérodote, n'était-elle pas la même que l'uipil des femmes mayas d'aujourd'hui même, introduite chez les habitants de quelques îles de la Méditerranée ?
Ces mots qui coulent de sa plume sur cette île tropicale lointaine montrent à quel point Le Plongeon acceptait sans esprit critique toute similitude comme preuve de contact historique, comment il supposait sans se poser de questions que ses propres identifications (de l'ours, par exemple) étaient correctes (ce qui n'était pas le cas), et comment, au lieu de remettre en question ses propres théories lorsqu'il était confronté à une masse de preuves contraires, il admettait simplement sa perplexité et s'éloignait calmement du sujet, toujours convaincu de son hypothèse initiale.
Bien qu'il ait prévu avec raison l'opposition que ses écrits rencontreraient, ou, pire, qu'ils seraient tout simplement ignorés, Augustus Le Plongeon s'est précipité à la rencontre de ses ennemis invisibles avec des contre-menaces anticipées.
Si la lecture de ce livre ne parvient pas à éveiller dans ce pays un intérêt pour la civilisation et l’histoire de l’Amérique ancienne, alors je suivrai le conseil que Jésus de Nazareth aurait donné à ses disciples lorsqu’il les envoya en mission pour répandre l’Évangile parmi les nations : « Et tous ceux qui ne vous recevront point, et ne vous écouteront point, en partant de là secouez la poussière de vos pieds… » Saint Marc, chap. VI, verset 11 — car je considérerai inutile de consacrer plus de temps, de travail et d’argent à ce sujet aux États-Unis, me rappelant le sort du professeur Morse, lorsqu’il demanda au Congrès la permission d’introduire son télégraphe électrique dans ce pays.
En 1881, devant l’American Antiquarian Society de Worcester, il déclara : « … comme je me sentais abandonné de tous, malgré le désir de tous de me procurer gratuitement ce que j’avais acquis au prix de tant de temps, de travail et d’argent, j’ai décidé de conserver mes connaissances, si chèrement acquises, de détruire un jour ou l’autre mes collections et de laisser ceux qui désirent en savoir plus sur les anciennes cités du Yucatan faire ce que j’ai fait… » En fait, Le Plongeon a effectivement fait quelque chose de ce genre en représailles contre les fonctionnaires mexicains qui avaient confisqué les monuments, statues et autres reliques qu’il avait trouvés au Yucatan. Après sa mort en 1908, sa veuve a révélé : « Une autre grande statue qu’il a trouvée et cachée de nouveau est encore cachée, son emplacement n’étant connu que de l’auteur présent. »
Sur son lit de mort, Alice Le Plongeon a remis à un ami intime de nombreux dessins et notes de son mari et a manifestement essayé de lui indiquer l’emplacement d’une autre découverte spectaculaire qu’ils prétendaient avoir faite et recouverte en 1875 : des salles souterraines contenant des boîtes en pierre contenant des documents anciens parfaitement préservés sur les Mayas. « Comme elle parlait avec une difficulté angoissante… je notais chaque mot au fur et à mesure que je l’entendais clairement ; je n’avais dans la main qu’une enveloppe », écrivit plus tard cet ami. Cependant, les documents que Mme Le Plongeon a remis à son amie, s’ils contiennent effectivement des indices sur les antiquités réenfouies, étaient si déguisés et compliqués qu’ils sont aujourd’hui inutiles. Comme l’a expliqué cet ami, lorsqu’elle a rendu ces notes disponibles de nombreuses années plus tard, « Le Plongeon croyait qu’il fallait faire comprendre aux gens les choses… et il avait des idées plutôt étranges pour protéger les secrets ».
Mme Le Plongeon écrivit dans une nécrologie de son mari que son tempérament sympathique et bienveillant le rendait universellement aimé. Ce point de vue n’était cependant pas partagé par l’un des admirateurs les plus enthousiastes de Le Plongeon, qui écrivit, vingt-trois ans après sa mort : « Je pense plutôt que le tempérament orageux du docteur contrarie souvent les hommes qui auraient pu (et auraient pu) être gagnés par la patience à certaines de ses opinions. » Cet ami décrivit la « petite épouse fidèle » de Le Plongeon comme n’ayant que dix-sept ans lorsqu’elle épousa le docteur, trente ans plus âgé qu’elle. « Mme Le Plongeon était elle-même une grande mystique », écrivit-il, et « il y eut beaucoup de tragédies dans sa vie. » Tous deux se sentaient piqués par l’indifférence du monde à l’égard de leur travail. « Les Le Plongeon m’ont raconté avec beaucoup d’amertume certaines des choses qu’on leur avait dites, et d’eux ! »
La plupart des étudiants qui ont suivi, professionnels ou amateurs, les ont rejetées ou, pour la plupart, les ont tout simplement ignorées. L’écriture manuscrite sur la salle de banquet chaldéenne de Belshazzar, telle que rapportée dans le Livre de Daniel, était d’origine maya, tout comme les paroles de Jésus sur la croix : Eli, eli lama sabachthani, ce qui ne signifiait pas : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » — des mots qui ne convenaient pas au Christ mourant au vu de son courage, de sa résignation et de sa foi — mais plutôt les paroles mayas : Helo, helo, lamah xabac ta ni, « Maintenant, maintenant, je coule, de l'encre noire sur le nez », c'est-à-dire : « Maintenant, je coule, les ténèbres couvrent mon visage » Le Plongeon ne considérait pas ces conclusions comme déraisonnables, comme le montre son désir de ne pas associer son nom à celui de l'abbé Brasseur de Bourbourg, dont les idées sur la théorie de l'Atlantide perdue étaient, comparées à celles de Le Plongeon, ultra-conservatrices. Un peu plus de quarante ans plus tard, Lewis Spence, le promoteur extrêmement populaire de la théorie de l'Atlantide perdue, exprima la même crainte d'être considéré comme un simple Brasseur, puis il ajouta le nom de Le Plongeon à celui de l'abbé.
Les théories égyptiennes sur les liens entre les Indiens d’Amérique et l’Égypte vont de l’attribution de la civilisation amérindienne à l’Égypte, point de vue généralement adopté à la légère par le visiteur moyen des musées de ce pays et défendu ces dernières années par un éminent anatomiste britannique du cerveau, le regretté Dr G. Elliot Smith, à l’attribution de la civilisation égyptienne à l’Amérique, idée mieux connue à travers les écrits de l’éminent abbé Charles Stephen Brasseur de Bourbourg dans les années 1860. Écrivant à cinquante ans d’intervalle, Brasseur et Smith se ressemblaient néanmoins à bien des égards, tous deux étant des étudiants compétents, bien informés et infatigables, mais tous deux se laissaient emporter par ce que la plupart des anthropologues considèrent aujourd’hui comme des théories intenables. Chacun s’est retrouvé empêtré dans une bataille, l’abbé se battant contre lui-même, et le Dr Smith menant un combat acharné tout au long de la dernière partie de sa vie contre les autorités anthropologiques établies aux États-Unis.
Smith avançait l'hypothèse que la haute civilisation n'était apparue qu'une seule fois sur terre, et que c'était dans la vallée du Nil. C'est de là que les graines de la culture égyptienne furent répandues dans le monde entier par les « Enfants du Soleil », des aventuriers en quête d'or et de perles, d'abord dans l'Ancien Monde et dans les îles du Pacifique, puis jusqu'aux Amériques, où les influences égyptiennes se manifestèrent dans les pyramides, la momification 1, les dieux et leurs attributs, et de nombreux motifs religieux et artistiques.
1 Smith et Perry, affirmant que la momification n’a été inventée qu’une seule fois, en Égypte, ont retracé son parcours et notamment son itinéraire vers les Amériques au moyen de ses apparitions aux îles Canaries et en Afrique de l’Ouest, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Indonésie, en Mélanésie, en Australie et en Polynésie. Smith a étudié les techniques d’embaumement égyptiennes, a souligné leur complexité et a insisté sur le fait que la réapparition de ce « complexe de traits » le long d’une chaîne d’apparitions allant de l’Égypte au Pérou, au Mexique, à l’est des États-Unis et à l’Alaska ne pouvait s’expliquer que par le contenu historique ou la diffusion. Parmi les caractéristiques qu'il a soulignées, il y avait l'éviscération par une incision au flanc ou par le périnée, le fait de jeter les viscères dans l'eau, l'ablation du cerveau par une incision à la base du crâne, le trempage du corps dans de la saumure, le frottement avec de l'huile, l'introduction de substances aromatiques dans la cavité corporelle, la peinture du corps en rouge, l'insertion d'yeux artificiels, l'incision dans ou entre les orteils, les doigts et aux coudes ou aux genoux pour drainer les liquides de décomposition, le séchage par la chaleur, l'ablation de l'épiderme sauf au bout des doigts et des orteils.
Smith et ses disciples, notamment William J. Perry, rassemblèrent un nombre impressionnant de preuves à l’appui de leur hypothèse, mais les anthropologues américains contestèrent âprement chacune d’entre elles. La forteresse intellectuelle qui défendait le développement indépendant des civilisations amérindiennes était le Peabody Museum of Archaeology and Ethnology de Harvard. C’est là, dans une vieille structure austère et menaçante en briques rouges qui ressemble aujourd’hui, de l’extérieur, plus à une ancienne usine de la Nouvelle-Angleterre qu’à l’un des plus grands musées du monde, qu’avait été développé le plus important centre de recherche et d’enseignement anthropologique des États-Unis. Certains anciens chercheurs célèbres de l’université s’étaient entourés de nouveaux professeurs et membres du personnel du musée, qui étaient déchirés entre la dignité traditionnelle de Harvard-Boston et leur indignation face aux théories propagées par certains de leurs collègues britanniques.
Finalement, le Dr Alfred Marston Tozzer, qui allait devenir le doyen des Mayanistes, fit remarquer à son collègue, le Dr Roland B. Dixon, que les livres de Smith feraient bientôt croire à tout le monde que les Indiens d'Amérique venaient directement du Nil. Dixon accepta à contrecœur d'écrire une contre-déclaration et se mit au travail pour rassembler les données de ce qui allait devenir un livre intitulé The Building of Cultures.
Roland B. Dixon était un perfectionniste et un érudit méticuleux. Célibataire aisé, il était presque le stéréotype du professeur d’université ; il portait des vêtements en tweed, fumait une pipe, se déplaçait lentement et parlait avec détermination – un conférencier peu inspirant, voire ennuyeux, qui donnait à ses étudiants tous les détails pénibles de la matière et s’attendait à ce qu’ils s’en souviennent de tout.

Selon les théoriciens de l'Égypte en Amérique, les pyramides mayas comme El Castillo (ci-dessus) de Chichen Itza, au Yucatan, dérivent de celles de la vallée du Nil (ci-dessous).




Augustus Lc Pongeon (en haut à gauche), dont les théories inhabituelles et la personnalité volatile l'ont entraîné dans une bataille acharnée avec les anthropologues américains. Sa jeune épouse, Alice (ci-dessus), et leur quartier général de terrain dans une ancienne ruine maya au Yucatan, vers 1875 (en bas à gauche). Au fond, un hamac avec une barre anti-moustiques. Mme Le Plongeon, dont la guitare est à gauche avec le pistolet de son mari, a enregistré et composé de la musique avec des paroles mayas.

Partie supérieure d'un monument en pierre préhistorique à Copan, au Honduras, sculpté (tout en haut) de figures que les égyptologues prétendaient être des éléphants avec des cornacs perchés sur leurs têtes, alors que les américanistes insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'aras stylisés. Un érudit anglais a accusé les archéologues américains d'avoir défiguré cette sculpture pour détruire les preuves dommageables. D’après A. P. Maudslay.
Mais c’était un anthropologue profondément informé. C’était une sorte de tradition parmi ses étudiants de troisième cycle, année après année, de tenter de le prendre sur un point de fait ou de l’identifier comme une curiosité d’une culture exotique. Presque tous les jours, on le trouvait debout sur les vieilles marches de pierre du musée entre les cours, entouré d’ un petit groupe d’étudiants qui lui avaient tendu un objet inhabituel – un morceau de bronze ornementé, un fragment d’ivoire sculpté, un tesson de poterie. Dixon tirait sur sa pipe, tournait et retournait l’objet dans ses mains, le regardait fixement et secouait la tête sans fin, comme s’il n’avait jamais rien vu de pareil de toute sa vie. Finalement, après peut-être quelques minutes de cette délibération, il le rendait à l’étudiant d’un air découragé et marmonnait : « Je m’en fous. C’est du nord du Cambodge, c’est vrai – de l’Assam du XVIe siècle – mais je n’arrive pas à imaginer d’où viennent ces motifs de lotus. » Un peu plus tard, un étudiant chagriné remboursait ses dettes en bière pression à Harvard Square.
Dixon s’attela avec acharnement à la tâche de démolir les affirmations de Smith et Perry, et ce fut une tâche énorme, car les Anglais avaient fait les déclarations les plus radicales, en s’appuyant sur toutes sortes de preuves provenant du monde entier. Il examina d’abord tous les cas connus de momification sur terre, retraça les coutumes individuelles qui y étaient liées dans chaque cas, et remarqua que la plupart des détails importants des pratiques égyptiennes étaient généralement absents, et que les méthodes employées étaient partout simples, « entièrement naturelles, comparables à celles utilisées pour conserver la viande, et que seule une tentative de conservation du corps devait être faite ». Il fit ainsi voler en éclat une croyance populaire très répandue selon laquelle les anciens connaissaient un secret de momification inconnu aujourd’hui, un procédé qui n’aurait pas été pratiqué dans le monde entier si les Égyptiens ne l’avaient pas propagé eux-mêmes. La seule analogie significative avec la procédure égyptienne se trouvait chez un peuple primitif des îles du détroit de Torrès, si éloigné de toutes les lignes connues de mouvement historique ou de diffusion culturelle qu’il était presque intouchable par les influences culturelles venues de l’ouest.
Il a également constaté des incohérences dans l’âge des traits de momification et la période présumée de l’expansion égyptienne. Quant aux centaines de structures en pierre connues dont Smith affirmait qu’elles étaient liées aux pyramides africaines, pas un seul objet égyptien, pas même une perle, n’y avait été retrouvé. Dixon a souligné que les pyramides mayas et mexicaines datent au moins du deuxième et du troisième siècle après J.-C., mais que celles du Cambodge n’ont été construites que cinq ou six cents ans plus tard.
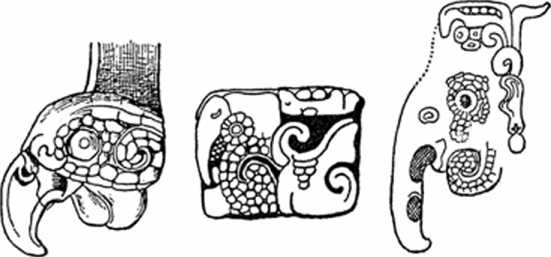
Conventionnalisation progressive de l'ara tel qu'il est représenté dans l'art maya. Les théoriciens égyptiens déclarent que la troisième figure est un éléphant. D'après HJ Spinden.
Les plus anciens temples dravidiens du sud de l'Inde, également cités comme d'origine égyptienne, furent érigés à partir du VIIe siècle apr. J.-C., près de quinze cents ans après que Smith eut déclaré que l'influence égyptienne avait atteint l'Inde sous sa forme complète. Il administra ensuite le coup de grâce en montrant qu'une évolution locale de la plupart des pyramides pouvait être retracée à travers des prototypes antérieurs dans chaque région. Par exemple, les tombes massives en pierre ou dolmens de Chine ont évolué à partir de tombes à couloir et de prototypes en bois plus anciens au lieu d'être introduites en masse depuis l'Égypte ; en outre, même Smith les a placées au IXe ou même au XIIe siècle av. J.-C., mais ses porteurs de culture égyptienne n'étaient pas censés avoir quitté l'Égypte avant le IXe siècle ou plus tard.
Le point de divergence le plus célèbre entre ces écoles de pensée, dans une bataille qui devint véritablement vitriolique de part et d'autre, le sarcasme dégoulinant de chaque critique, de chaque compte rendu de livre et de chaque réplique, était de savoir si certaines figures sculptées sur un monument préhistorique des ruines mayas de Copan au Honduras représentaient des éléphants avec des cornacs en turban perchés sur leurs têtes, comme l'affirmaient Smith, Perry, J. Leslie Mitchell et d'autres, ou si, comme le répliquaient les professeurs Tozzer et Dixon de Harvard, il s'agissait en fait de perroquets stylisés cent pour cent américains. Ce dernier débat a fourni le titre d'un des livres du Dr Smith, Elephants and Ethnologists, dans lequel il a couvert de ridicule impitoyable les partisans des aras. Mitchell est allé jusqu'à suggérer que les archéologues américains ont plus tard délibérément mutilé cette stèle maya pour protéger leur précieuse théorie, une accusation qui lui a valu une réputation dans les cercles universitaires à peu près comparable à celle qu'obtiendrait un joueur de tennis de Wimbledon s'il attaquait son adversaire entre deux jeux avec une bouteille de bière cassée.
L’autre côté de la médaille, la théorie selon laquelle la civilisation se serait déplacée de l’hémisphère occidental vers le Nil, bien qu’elle ne soit pratiquement plus soutenue de nos jours, a été vigoureusement défendue par Brasseur de Bourbourg et plus tard par Auguste Le Plongeon. Bien qu’ayant travaillé une vingtaine d’années plus tôt, l’abbé était de loin le plus érudit et le plus conservateur des deux. Il croyait fermement que les hautes civilisations de l’Égypte ancienne et de l’Ancien Monde étaient issues des colons atlantes d’Amérique, et que certaines divinités égyptiennes et mayas étaient en fait les mêmes êtres manifestés dans des cultures distinctes sous des noms différents.
Une fois que l’on accepte l’hypothèse selon laquelle l’Égypte a été colonisée par l’Amérique, ou vice versa, des conclusions plus précises sur le moment, le lieu et la manière dont cela s’est produit deviennent une tâche routinière. Par exemple, Manuel Rejón Garcia de Mérida, au Yucatan, a fait ces calculs en 1905 : Salomon a ordonné la vente de chevaux à l’Égypte mille ans avant Jésus-Christ, mais les chevaux et les porcs n’ont pas été importés en Égypte avant cette date. « Il est facile de déduire de cela que les habitants de notre partie de l’Amérique ont quitté l’Égypte avant l’importation du cheval. Ainsi, l’Amérique a été peuplée plus de trente siècles avant l’ère chrétienne. » Quatre ans après Rejón, Channing Arnold et Frederick J. Tabor Frost, qui prétendaient être les deux premiers Anglais à avoir écrit un livre sur le Yucatan — ils ne tenaient pas compte du magistral relevé photographique d’Alfred Percival Maudslay réalisé en 1899 — se demandaient d’où venait cette architecture américaine, et répondaient alors, paradoxalement pour un livre intitulé The American Egypt : « L’Égypte a été une grande tentation pour beaucoup, et en vérité il est difficile, quand on se trouve pour la première fois face à face avec des statues d’apparence très égyptienne comme les figures atlantes que nous avons trouvées à Chichen... de résister à l’idée qu’il doit y avoir un lien entre les merveilles de pierre de la vallée du Nil et les palais du Yucatan. Mais en laissant de côté les difficultés extraordinaires que pose la cartographie d’une route possible par laquelle la connexion entre les deux peuples pourrait s’effectuer, toutes les preuves disponibles sont contre vous. Les bâtiments des deux races sont différents par leur structure et leur conception, par leur ornementation et leur décoration ; et si cette dissemblance pouvait être expliquée et si l’on tentait de lier les deux ethniquement, il n’existe pas la moindre preuve, physique, mythologique, philologique ou autre, qui pourrait être dérivée d’une communauté de mœurs et de coutumes, pour aider à cet effort.
Malgré plusieurs générations de luttes anthropologiques contre la théorie de l’influence égyptienne en Amérique, cette idée persiste obstinément, principalement parce que l’archéologie égyptienne est le seul domaine de la préhistoire dont la plupart des gens ont une connaissance superficielle. Les ressemblances entre les antiquités mayas et celles de l’Asie du Sud-Est, par exemple, sont bien plus nombreuses et plus frappantes, mais le public continue d’affirmer que tout ce qui est ancien en Amérique ressemble à de l’Égypte. Une dame du Mississippi a écrit un jour qu’elle avait vu un fragment de tissu blanc uni qui aurait été dans un récipient indien exhumé près de chez elle, et elle était sûre qu’il était égyptien, car elle avait vu un tissu identique dans la section égyptienne du Metropolitan Museum. Un numéro récent du Smith Alumnae Quarterly raconte le voyage d’une ancienne élève au Mexique. « Ils se sont arrêtés », dit-il, « dans la charmante vieille ville d’Oaxaca et ont admiré les ruines antiques où se trouvent des inscriptions de style égyptien, romain et maya. »
La théorie de l’Égypte en Amérique, ou vice-versa, comme celle de l’Atlantide et des tribus perdues d’Israël, est là pour rester. Pour une raison difficile à comprendre, les gens s’y attachent émotionnellement et ne croient pas aux arguments les plus convaincants que les érudits professionnels peuvent fournir contre elle. « Un homme convaincu contre sa volonté reste du même avis. »
Bien que la plupart des personnes qui s'intéressent de près aux Mayas et aux anciens Péruviens se tournent vers l'Égypte pour trouver l'inspiration de ces civilisations américaines, les non-professionnels vraiment enthousiastes sont divisés entre un certain nombre de théories plus spécifiques, dont les principales sont l'Atlantide perdue et les tribus perdues d'Israël. Ces deux croyances exploitent les similitudes égypto-américaines, mais ne considèrent pas nécessairement l'Égypte comme le berceau de toutes les cultures supérieures du monde.
Dans l’ensemble, les tribus perdues et les autres hypothèses israélites ont séduit un groupe plus conservateur d’antiquaires et d’historiens amateurs orientés vers l’Ancien Testament, ainsi que, bien sûr, tous les mormons. Les adeptes de l’Atlantide perdue ont été, pour la plupart, des romantiques et des mystiques congénitaux. De nos jours, on les trouve parmi les lecteurs d’aventures et les membres d’organisations mystiques comme les rosicruciens et les théosophes, mais jusqu’à la fin du XIXe siècle, ils comptaient parmi leurs membres un grand nombre d’érudits de la vieille école qui affluaient aux réunions locales et aux congrès internationaux de sociétés savantes ici et à l’étranger pour exposer l’histoire d’une civilisation avancée qui a prospéré il y a plusieurs milliers d’années sur une île géante de l’océan Atlantique et qui a colonisé l’ancien continent américain avant d’être détruite par des éruptions volcaniques cataclysmiques, des tremblements de terre et des raz-de-marée, pour sombrer à jamais sous la mer.
Lors du premier congrès international des américanistes, par exemple, qui se tint à Nancy en 1875, on débattit avec enthousiasme de la théorie chinoise Fu-Sang, selon laquelle les anciens Chinois auraient découvert une grande terre de l’autre côté de l’océan, une histoire dont un délégué compara la réapparition fréquente à celle du serpent de mer. Puis le Dr Chil y Narango, des îles Canaries, souleva la question de l’Atlantide, un sujet déjà ancien et controversé. Immédiatement, les émotions s’élevèrent, les esprits savants s’échauffèrent et, si l’on en juge par les actes considérablement censurés , publiés longtemps après la fin des réunions et l’apaisement des sentiments, le congrès était en émoi.
Ce comportement n’était pas nouveau et ne s’arrêta pas là. Pendant cinquante ans encore, la controverse sur le Continent perdu pouvait être considérée comme un prétexte pour une mêlée verbale générale. Et elle le pouvait encore, si ce n’était que les anthropologues professionnels se sont lassés de cette bataille qui promettait de faire passer la guerre de Cent Ans pour une escarmouche d’un week-end. Aujourd’hui, il est pratiquement impossible d’inciter un professionnel à débattre sur ce sujet ; il se contentera de hausser les épaules et de se détourner avec lassitude. Car de tous les théoriciens de l’origine des Indiens d’Amérique, les défenseurs du Continent perdu sont de loin les plus dévoués à leur cause et les plus inflexibles. Leur loyauté atteint parfois une telle férocité que les partisans de l’Atlantide ou de Mu en sont venus à se considérer comme des citoyens de ces terres fabuleuses, déterminés à les défendre jusqu’à la mort.
Dans le Timée, Platon fait dialoguer des prêtres égyptiens de Saïs avec son ancêtre Solon, et lui parle d’un pays plus vaste que l’Asie Mineure et la Libye réunies, siège d’une civilisation magnifique, loin dans la mer occidentale. Dans son Critias, Platon en dit plus sur ce continent légendaire, dont les trois rois auraient régné sur des parties de l’Europe jusqu’à la mer Baltique, la mer Caspienne et la mer Noire, envahi l’Asie et été vaincus par les Athéniens, avant qu’eux et quelque douze millions de leurs sujets ne périssent dans l’effroyable calamité qui s’abattit sur leur île natale. Ainsi, la théorie la plus populaire de toutes trouve les origines américaines non pas sur un continent ou dans une culture qui peut encore être étudiée, ne serait-ce que sur le plan archéologique, mais plutôt dans une terre qui n’existe plus que dans les profondeurs de la mer. Les sources primaires faisant évidemment défaut (à moins d’accepter comme authentiques certaines « tablettes » censées être les témoignages originaux de Mu) et les sources secondaires, si Platon peut en être une, étant rares, les imaginations les plus fertiles ont eu libre cours pour décrire l’Atlantide, Mu et leurs merveilles antiques. Ces circonstances expliquent sans doute pourquoi, de toutes les théories sur les origines indiennes, seuls les Continents perdus ont autant attiré l’attention des artistes, des poètes et des écrivains de fiction.
Il semble que depuis des siècles, des légendes aient fait état de terres semblables au-delà des colonnes d'Hercule, des récits de géographes arabes, des récits grecs sur les îles Fortunées, l'Avalon gallois, l'île portugaise des Sept Cités et l'île de Saint-Brendan, mais surtout d'une grande étendue de terre appelée Antilia, qui apparaît sur presque toutes les cartes du XVe et du début du XVIe siècle. La carte de Toscanelli, que Christophe Colomb a consultée en 1474, la montrait en route directe par mer depuis les îles Canaries jusqu'au Japon, et Colomb aurait dirigé son cap vers l'île et aurait mis le cap plein ouest sur environ 2 600 kilomètres à sa recherche. 1 L'Atlantide comme origine de la culture du Nouveau Monde est une théorie qui remonte presque à la découverte du Nouveau Monde lui-même. Elle a été défendue par Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes en 1535, et par le poète Giralamo Fracastoro cinq ans plus tôt. 2 « Même aux XVIIe et XVIIIe siècles », note avec étonnement l’ Encyclopaedia Britannica , « la crédibilité de la légende était sérieusement débattue et parfois admise, même par Montaigne, Buffon et Voltaire. » Les archives de la Britannica sont bien dépassées. Bien que la théorie ait été réfutée par une foule de savants depuis Joseph de Acosta (1590), les ouvrages de référence en faveur de l’Atlantide, Atlantis in America et The Problem of Atlantis de Lewis Spence, ont été publiés respectivement à New York et à Londres en 1924 et 1925. À bien des égards, les affirmations de Spence sont les moins spectaculaires et ses arguments les plus raisonnés de toute la littérature en faveur de cette théorie. Il n’affirme pas que l’Atlantide était la mère de toute civilisation, ni que l’Égypte était la source de toute culture. « L’hypothèse atlante ne gagnera rien », écrit-il, à être poussée à l’extrême, ou à être sollicitée par des excentriques. Si cela vaut la peine d’être examiné, il faut l’examiner de manière sensée. » Pour faire entrer la culture atlante en Amérique, Spence postule une autre masse terrestre perdue, Antilia, dont les Antilles actuelles sont un vestige, et qui a servi de tremplin vers le continent occidental. Il pensait qu’une tradition amérindienne mexicaine de destruction de la capitale toltèque rappelait probablement la calamité de l’Atlantide, ou qu’elle était en quelque sorte confondue avec elle.
1 Une carte du monde de Ruysch en 1508 attribuait encore cette position à Antilia ; la carte porte une légende affirmant entre autres que la population de l'île était dirigée par un archevêque et six évêques, chacun ayant sa propre ville, et que les gens étaient de stricts chrétiens et « abondaient dans les richesses de ce monde ».
2 Aho Francisco Lopez de Gomara (1553). L'ouvrage exhaustif de J. Imbelloni sur les théories de l'origine des Indiens, La Segunda Esfinge Indiana, cite le poète Giralamo Fracastoro (1530) et Agustin de Zarito (1555). Selon l'Encyclopaedia Britannica, les tentatives de rationalisation du mythe après la Renaissance ont abouti à identifier l'Atlantide à l'Amérique, à la Scandinavie, aux Canaries ou à la Palestine, et les ethnologues ont vu dans ses habitants les ancêtres des Guanchos, des Basques ou des anciens Indiens.
Il y a aujourd'hui plus de croyants sur le continent perdu que jamais auparavant, y compris les milliers de membres de l'Ordre Rosicrucien, dont le vénéré et défunt empereur suprême, H. Spencer Lewis, exprima la croyance officielle selon laquelle « un grand continent appelé Atlantide... fut submergé et mit fin à l'existence terrestre de millions d'êtres incarnés ». La plupart, voire la totalité des membres de la Société Théosophique, croient également en l'Atlantide, qui figure dans leur schéma de l'évolution humaine, sept des races de l'humanité étant apparues au cours de la quatrième époque ou époque atlante qui a précédé l'actuelle époque « aryenne » de l'histoire de cette terre.
L'Atlantide était le berceau de l'humanité, le jardin d'Eden, les jardins des Hespérides, les Champs Élysées, toutes les républiques idéales de l'histoire antique. Lord Bacon a esquissé un tel État archétypal dans son fragment littéraire, La Nouvelle Atlantide.
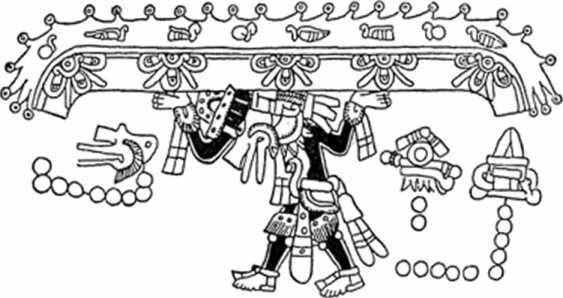
Le dieu mexicain Quetzalcoatl est représenté dans un ancien manuscrit indien soutenant la mer. Les croyants du continent perdu de l'Atlantide affirment que Quetzalcoatl et Atlas étaient la même divinité , que tous deux étaient atlantes et que ce texte montre Atlas mexicain soutenant le monde sur son dos. D'après Lewis Spence.
Les dieux atlantes étaient identifiés aux anciennes divinités des Grecs, des Phéniciens, des Scandinaves et des Hindous ; la religion atlante était considérée comme un culte du soleil identique à celui de l’Égypte et du Pérou . On attribuait à l’ancien continent toutes les grandes inventions de l’humanité, y compris la métallurgie et l’alphabet. Lewis Spence affirmait en 1925 que Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes mexicain, était également Atlas, et tous deux étaient atlantes, car « tous deux étaient l’un des jumeaux, tous deux étaient des magiciens adorés par des tribus qui pratiquaient la momification, tous deux étaient des porteurs de terre, tous deux avaient des jeunes filles qui leur étaient sacrifiées par noyade, les filles mayas étant jetées dans le cénote ou puits sacré de Chichen Itza et les dames des îles Canaries se jetant dans la mer en offrande au dieu de l’océan ». Le regretté Ernest Albert Hooton, professeur d’anthropologie physique à Harvard, a examiné les squelettes du puits sacré de Chichen Itza et a annoncé que treize d’entre eux étaient des hommes, huit des femmes adultes ou subadultes, sept des enfants âgés de dix à douze ans et quatorze des enfants de six ans ou moins. Les adultes étaient particulièrement malades, « quelque peu démesurément abîmés », leurs crânes présentant de nombreuses lésions et fractures. « Dans l’ensemble », a observé Hooton, « il est suggéré que les habitants adultes du cénote sacré n’étaient peut-être pas généralement aimés dans leur carrière pré-sacrificielle. » Puisque toutes les légendes du puits sacré racontent que seules les vierges y étaient jetées pour devenir les épouses du dieu de la pluie, Hooton a ajouté : « Tous les individus impliqués (ou plutôt immergés) étaient peut-être vierges, mais les preuves ostéologiques ne permettent pas de déterminer ce point précis. » Les partisans de l'Atlantide s'appuient sur la moindre ressemblance, réelle ou imaginaire, pour étayer leurs théories, et si ces preuves peuvent être formulées sous le couvert de la science, comme le sont tant de publicités télévisées aujourd'hui, elles sont considérées comme prouvées, du moins par les mystiques. En 1883, WS Blacket, écrivant ses Researches into the Lost Histories of America, notait gravement que le palais ou temple quiché guatémaltèque que John L. Stephens avait décrit dans son charmant Incidents of Travel était la structure identique à celle dépeinte par Platon, et ce n'est que soixante-quatre ans plus tard que les fouilles de l'Université de Tulane à Utatlan révélèrent que cette capitale quiché ne fut construite qu'à la dernière grande époque de l'histoire maya, après le début du XVe siècle après J.-C., plus de seize cents ans après la mort de Platon et plus de dix mille ans après la date que les adeptes de l'Atlantide attribuent à la civilisation perdue.
De même, les théoriciens atlantes ont affirmé qu’il y avait un large soutien géologique à l’existence d’une masse terrestre engloutie dans l’océan entre l’Europe et l’Amérique, bien que les géologues qui ont involontairement fourni les données n’avaient pas en tête des dates aussi récentes que celles attribuées à sa disparition par Platon et ses disciples.
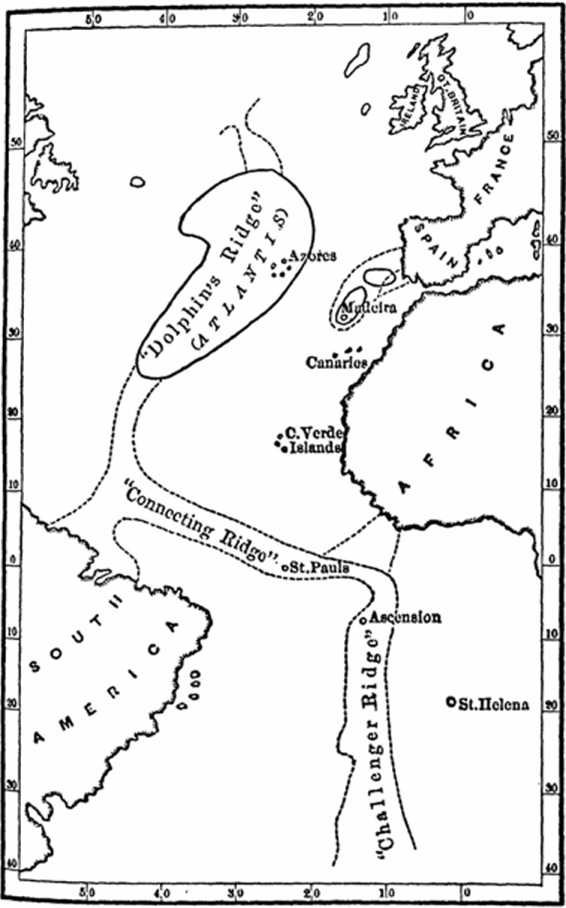
Carte du continent englouti de l'Atlantide et de ses îles et crêtes, d'après des sondages en haute mer, selon Ignatius Donnelly.
L’un des chapitres les plus révélateurs de l’ouvrage à succès Atlantis: The Antediluvian World d’Ignatius Donnelly (l’édition de 1880 en était la dix-huitième édition) est celui dans lequel il passe au peigne fin la littérature géologique et historique disponible pour trouver les cataclysmes qui ont radicalement modifié la surface de la terre de mémoire d’homme. Par exemple, il cite The Preadamites de Winchell selon lequel toute la côte sud-américaine s’est soulevée de dix à quinze pieds et s’est abaissée à nouveau en une heure, et que les Andes ont coulé de deux cent vingt pieds en soixante-dix ans. Donnelly était convaincu que l’affaissement de l’Atlantide n’était que le dernier d’une multitude de changements similaires à ceux qui, selon lui, ont submergé la Grande-Bretagne à une profondeur d’au moins mille sept cents pieds et l’ont soulevée de nouveau au-dessus de l’océan, par lesquels la Sicile a été soulevée de sous les vagues à une altitude de trois mille pieds, et le désert du Sahara a été soulevé d’un dépôt de la mer. En 1783, un volcan sous-marin éclata dans l'océan à trente milles de l'Islande, et fit surgir une île aux hautes falaises que le roi du Danemark baptisa et revendiquait immédiatement, mais qui, un an plus tard, disparut de nouveau, laissant un récif à trente brasses sous l'eau. En avril 1815, une éruption volcanique sur une île à deux cents milles à l'est de Java aurait détruit tout le monde, sauf vingt-six personnes sur une population de douze mille habitants. Le 1er novembre 1755, à Lisbonne, un bruit semblable à celui du tonnerre se fit entendre sous terre, et immédiatement après, un tremblement de terre renversa la plus grande partie de la ville, tuant soixante mille personnes en six minutes ; un nouveau quai de marbre s'enfonça soudainement à une profondeur de six cents pieds, et le célèbre géographe, Alexander von Humboldt, déclara qu'une partie de la surface terrestre quatre fois plus grande que l'Europe fut ébranlée simultanément. À Fez, au Maroc, au cours du même tremblement de terre, le sol s'ouvrit, engloutit un village de dix mille habitants, et se referma sur eux. Donnelly conclut :
Ces faits semblent montrer que les grands incendies qui ont détruit l’Atlantide couvent encore dans les profondeurs de l’océan ; que les vastes oscillations qui ont emporté le continent de Platon sous la mer peuvent le ramener à la lumière, avec tous ses trésors enfouis ; et que même l’imagination débridée de Jules Verne, lorsqu’il décrivit le capitaine Nemo, dans son armure de plongée, regardant le temple et les tours de l’île perdue, éclairée par les feux des volcans sous-marins, avait quelques bases de possibilité sur lesquelles construire. . . . Qui dira que dans cent ans, les grands musées du monde ne seront pas ornés de pierres précieuses, de statues, d’armes et d’instruments de l’Atlantide, tandis que les bibliothèques du monde contiendront des traductions de ses inscriptions, jetant une lumière nouvelle sur toute l’histoire passée de la race humaine et sur tous les grands problèmes qui embarrassent aujourd’hui les penseurs de notre époque ?3
3 Ignatius Donnelly avait préconisé que les nations de la terre « emploient leurs marines oisives à ramener à la lumière du jour quelques-unes des reliques de ce peuple enseveli ». Il soutenait qu’une seule tablette gravée extraite de l’île de Platon « aurait plus de valeur pour la science, frapperait davantage l’imagination de l’humanité que tout l’or du Pérou, tous les monuments d’Égypte et tous les fragments de terre cuite rassemblés dans les grandes bibliothèques de Chaldée ». C’était au moins une déclaration sur le sujet qui n’a jamais suscité de controverse.
L’équivalent pacifique de l’Atlantide est la Lémurie, plus connue sous le nom de Mu – à ne pas confondre avec la Reine Moo de Le Plongeon, qui, s’il s’agit d’un nom maya, devrait rimer avec « orteil » – un autre continent perdu qui a produit une grande civilisation mais qui est maintenant, lui aussi, englouti sous les vagues dévorantes de l’océan, comme les auteurs sur ces sujets ont tendance à le dire. James Churchward, son historien le plus connu, a publié son dernier livre sur Mu en 1931 ; les champions de chaque théorie tolèrent l’autre, réalisant probablement que tout argument convaincant contre un continent perdu pourrait être appliqué avec le même effet contre l’autre, mais pendant un temps il y eut une certaine rivalité entre eux. Un ancien Churchward, William, s’est plaint dans une lettre de 3800 mots à une édition du samedi du Brooklyn Times en 1890 que tout le monde sait tout sur l’Atlantide ; même les enfants peuvent déterminer son emplacement et son étendue, a-t-il affirmé, mais « qui peut tracer d’un coup les lignes de la Lémurie ? C'est un continent au même titre que la célèbre Atlantide, mais qui connaît son ancienne place sur le globe ?

Les continents perdus de Mu, dans le Pacifique, et de l'Atlantide, dans l'Atlantique, selon James Churchward.
Probablement parce que l'Atlantide a été lancée plus tôt, Mu ne lui a jamais offert de concurrence sérieuse, bien que William Churchward ait fait de son mieux pour la dynamiser en associant son nom à trois autres sujets chers aux mystiques : l'Atlantide, l'île de Pâques et Stonehenge. Sa lettre au Times contenait les titres suivants :
RELIQUES D'UNE RACE ÉTEINTE
Le continent noyé des îles du Pacifique.
Seules les flèches et les pointes de terre apparaissent désormais au-dessus des vagues, mais elles sont pleines d'intérêt pour les voyageurs et les hommes de science à lunettes.
Deux sages, Platon d’Athènes et Donnelly de Minneapolis, ont fait de l’Atlantide un nom familier.
Mu est probablement une forme abrégée de Lemuria, qui, selon l'Encyclopedia Americana, a été ainsi nommée par un Allemand, Ernst Jaekel (1834-1919), qui a décidé qu'un continent était nécessaire pour expliquer la distribution particulière des lémuriens et d'autres animaux et plantes. Jaekel (parfois orthographié Haeckel) a essayé de prouver, dans son Histoire naturelle de la création (1868), Origine et généalogie de la race humaine (1870), et d'autres ouvrages, que les singes de l'Ancien Monde ont évolué sur une île de l'océan Indien, qui a coulé sous les eaux, laissant Ceylan comme une relique. Avec la découverte de restes de lémuriens en Amérique et en Europe, dit l'Americana, l'idée a été rapidement abandonnée. Les anthropologues des musées et des universités, dont les bureaux sont visités en masse par les passionnés du Continent perdu, sont en profond désaccord. Jennings C. Wise, d’autre part, dit qu’un Écossais a donné au continent Pacifique le nom de Lémurie, d’après une fête sacrificielle romaine dédiée aux fantômes « des mondes disparus de leur origine ».
James Churchward a suivi les schémas de pensée et d’exposition familiers que l’on reconnaît chez les aventuriers professionnels et les pseudo-écrivains scientifiques les moins inhibés. Son récit personnel commence en Inde, où il dit s’être lié d’amitié avec un vieux prêtre qui l’a vu un jour essayer de déchiffrer une inscription en bas-relief. Cet ami prêtre lui a donné des leçons pendant deux ans dans la langue morte qu’il croyait être la langue originelle de l’humanité. Churchward a finalement persuadé le vieil homme de lui montrer des tablettes secrètes qui se sont révélées être les « véritables annales de Mu ». Après avoir traduit ces tablettes, ainsi que plus de deux mille cinq cents pierres trouvées par un homme nommé William Niven au Mexique, Churchward a étudié les écrits « de toutes les anciennes civilisations » — ce qu’aucun linguiste faisant autorité n’a jamais prétendu faire — pour les comparer aux légendes de Mu, et il a découvert que la civilisation de Mu a précédé les civilisations grecque, chaldéenne, babylonienne, perse, égyptienne et hindoue. De plus, dit l’auteur, il a appris l’histoire originelle de la création et c’est « sur le continent de Mu que l’homme est apparu pour la première fois ». À partir de là, l’histoire prend un ton familier : les colons de Mu se sont installés en Inde, de là en Égypte, de là au temple du Sinaï – où Moïse a copié l’histoire – et ainsi de suite. Un anthropologue exaspéré s’est demandé s’il ne serait pas plus raisonnable de supposer que ce sont moins les cataclysmes de la nature qui ont anéanti ces civilisations qu’un éventuel affrontement frontal entre les colons avides de Mu et ceux de l’Atlantide.
Pour Churchward, la grande antiquité des tablettes Naacal, qu’il a lui-même découvertes, était suffisamment attestée « par le fait que l’histoire dit que les Naacals ont quitté la Birmanie il y a plus de 15 000 ans ». Il n’a cité aucune autre autorité, aucun autre document ou preuve pour étayer cette affirmation remarquable ; l’âge suggéré place les tablettes bien loin de l’âge de pierre, quelque dix mille ans avant même l’invention de l’écriture selon la plupart des anthropologues. Les tablettes mexicaines, a déclaré Churchward, ont plus de douze mille ans ; elles seraient donc à peu près contemporaines de l'homme de Tepexpan dans la vallée de Mexico, un chasseur de mammouths aujourd'hui éteints de l'ère glaciaire, qui, selon les archéologues modernes, aurait eu du mal à signer son nom d'un X. Des divergences comme celle-ci n'inquiétaient pas Churchward, qui concluait que les archives mexicaines, comme celles de Naacal, « établissent indubitablement à ma propre satisfaction qu'à une époque la terre avait une civilisation incalculablement ancienne, qui était, à bien des égards, supérieure à la nôtre, et bien en avance sur nous dans certains éléments essentiels importants dont le monde moderne commence à peine à avoir connaissance.

L'« alphabet hiératique » de Mu, d'après des tablettes prétendument découvertes par James Churchward.
Ces tablettes, ainsi que d’autres documents anciens, témoignent du fait étonnant que les civilisations de l’Inde, de Babylone, de la Perse, de l’Égypte et du Yucatan n’étaient que les braises mourantes de la première grande civilisation.
Churchward expliquait la grossièreté des vestiges archéologiques ultérieurs de l’âge de pierre en partant du principe qu’avant la destruction de Mu, il n’y avait pas de sauvagerie, mais lorsque leur grande civilisation disparut, les survivants ne savaient pas comment se débrouiller seuls, parvenant seulement à fabriquer quelques outils et armes et quelques vêtements grossiers faits de feuillage, et furent poussés dans certains cas au cannibalisme dans leur lutte pour la survie. « La sauvagerie est issue de la civilisation, et non la civilisation de la sauvagerie », insistait-il. « Seuls ceux qui ne connaissent rien aux sauvages soutiennent que la civilisation est issue de la sauvagerie. » Ce genre de discours est plus que légèrement agaçant pour les anthropologues, les experts professionnels des sauvages. Ils grincent des dents à haute voix lorsque Churchward explique plus loin : « Un sauvage, laissé à lui-même, ne s’élève pas. Il est tombé là où il est et continue de descendre. Ce n’est que lorsqu’il est mis en contact avec la civilisation qu’un changement vers le haut devient possible en lui. »
Churchward ne fut ni le premier ni le dernier théoricien de ce courant à invoquer la notion inhabituelle de régression culturelle pour expliquer comment une civilisation est devenue moins avancée que son grand ancêtre. Harold S. Gladwin, dans Men Out of Asia, a observé le même phénomène après la grande période Mochica au Pérou, bien que la plupart des spécialistes nient toute dégénérescence industrielle à ce stade de la préhistoire andine. La théorie du Kon-Tiki de Thor Heyerdahl explique l’absence de traits péruviens en Polynésie par la stagnation et la régression qui étaient devenues « naturelles » dans un environnement insulaire – un renversement complet, comme l’a souligné l’anthropologue Edward Norbeck, de l’argument avancé par Heyerdahl ailleurs selon lequel il était très improbable que des migrants venus d’Indonésie ou d’Asie perdent des métiers tels que la poterie et le tissage lors d’une migration vers l’est dans le Pacifique. Lady Richmond Brown, FLS, FRGS, FZS, dans un dernier chapitre de « Observations et analyses » de son livre d’aventures de voyage, Unknown Tribes, Unchartered Seas, évoque le continent perdu de l’Atlantide et demande : « N’est-il pas possible qu’un puissant empire ait existé, probablement bien plus grand que le nôtre, couvrant des millions de kilomètres carrés de territoire qui se trouve maintenant profondément sous l’océan – que quelques vestiges d’une annihilation stupéfiante aient survécu, et que ces tribus primitives d’aujourd’hui soient les descendantes, s’enfonçant toujours plus bas par un processus de dévolution, de leur ancien statut élevé ? » En 1817, James H. McCulloh, docteur en médecine, écrivait : « Pour ma part, je crois que si l’homme n’avait pas été créé civilisé, il n’y serait jamais parvenu par ses propres efforts ; nous voyons, lorsqu’on nous laisse à nous-mêmes, à quel point nous sommes dégradés. » Enfin, le Dr Samuel Kirkland Lothrop, éminent anthropologue du Peabody Museum de Harvard, a demandé avec sarcasme : « Pourquoi le groupe d’écrivains qui voudrait faire dériver la culture du Nouveau Monde de l’Ancien – que ce soit l’Atlantide, Mu, l’Asie ou les Quatre Coins – constate-t-il toujours une dégénérescence ultérieure ? S’agit-il d’une unité psychique ? »
Churchward en a appris beaucoup plus sur Mu grâce à ses « traductions » des tablettes secrètes que quiconque n’a jamais prétendu en savoir sur l’Atlantide, même Platon. Ses scènes de Mu sont idylliques. « Au-dessus de la rivière fraîche, des papillons aux ailes voyantes planaient à l’ombre des arbres, s’élevant et s’abaissant dans un mouvement féerique, comme s’ils pouvaient mieux admirer leur beauté peinte dans le miroir de la nature. S’élançant de-ci de-là, de fleur en fleur, les colibris effectuaient leurs courts vols, scintillant comme des joyaux vivants aux rayons du soleil. Des chanteurs à plumes dans les buissons et les arbres rivalisaient entre eux dans leurs doux chants. » Il a décrit avec beaucoup de détails presque tous les aspects de la vie sur Mu ; la façon dont tout cela est arrivé sur les tablettes secrètes est une merveille. Population : « Le grand continent regorgeait d’une vie gaie et heureuse sur laquelle 64 000 000 d’êtres humains régnaient en maître. Toute cette vie se réjouissait dans sa luxuriante demeure. » Race : « La race dominante du pays de Mu était une race blanche, composée de gens extrêmement beaux, à la peau claire, blanche ou olive, aux grands yeux doux et sombres et aux cheveux noirs et raides. » Navigation : « Les soirs frais, on pouvait voir des bateaux de plaisance remplis d’hommes et de femmes magnifiquement habillés et parés de bijoux. Les longues rames dont ces navires étaient équipés donnaient un rythme musical aux chants et aux rires des heureux passagers. » Comme il n’y avait apparemment aucune mention de bateaux à vapeur ou de moteurs hors-bord sur Mu, ces rames étaient probablement manœuvrées par des galériens un peu moins joyeux et heureux, qui n’appartenaient probablement pas à la « race dominante ».
Une image tout à fait différente de Mu – ou de la Lémurie – est offerte par Max Heindel dans sa Cosmo-Conception rosicrucienne, publiée en 1929. Selon Heindel, dont l’intention déclarée était de réconcilier les cosmologies mystiques apparemment contradictoires de la célèbre théosophe Mme H.P. Blavatsky et d’un autre occultiste vénéré, A.P. Sinnett, auteur du Bouddhisme ésotérique, l’époque lémurienne se situe il y a bien longtemps, lorsque la croûte terrestre commençait à peine à durcir, en partie encore ardente, avec des mers d’eau bouillante entre les îles. L’atmosphère était « dense » – un peu comme le brouillard de feu d’une période lunaire précédente – les formes de l’homme et de l’animal étaient encore « tout à fait plastiques ». Le squelette s’était formé, certes, mais l’homme avait le pouvoir de modeler sa chair et celle des animaux qui l’entouraient. Il n’avait pas d’yeux, seulement deux points sensibles qui étaient affectés par la lumière du soleil « alors qu’il brillait faiblement à travers l’atmosphère ardente de l’ancienne Lémurie ». Son langage était constitué de sons « semblables à ceux de la nature », dérivés du soupir du vent dans la forêt supertropicale, des ruisseaux ondulants, des tempêtes hurlantes, des chutes d’eau tonitruantes et du rugissement du volcan.

Le continent perdu de Mu, selon James Churchward
Il était possible de voir à quelques mètres seulement dans n’importe quelle direction, écrivait Heindel, et le contour de tous les objets qui n’étaient pas à portée de main apparaissait flou, flou et incertain. « L’homme était davantage guidé par la perception interne que par la vision externe », expliquait-il. L’habitant de l’Atlantide avait une tête, mais à peine pas de front ; son cerveau n’avait pas de développement frontal ; la tête s’inclinait presque brusquement vers l’arrière à partir d’un point situé juste au-dessus des yeux. « Au lieu de marcher, il progressait par une série de sauts volants, un peu comme ceux du kangourou. Il avait de petits yeux clignotants et ses cheveux étaient de section ronde… Les oreilles de l’Atlante étaient placées beaucoup plus en arrière sur la tête que celles de l’Aryen… » Claude Falls Wright, dont les exposés de 1894 sur la théosophie moderne suivaient de près ceux de la fondatrice d’une société théosophique, Mme Blavatsky, affirme que les Lémuriens étaient censés mesurer entre vingt-sept et trente pieds de haut et posséder des pouvoirs de la nature que nous ne pouvons concevoir aujourd’hui. Leur civilisation était donc différente de la nôtre, « ayant probablement plus à voir avec la science et la philosophie qu’avec la nourriture et les vêtements ». Cela a dû être une bénédiction pour une personne mesurant dix mètres, pour qui la nourriture et les vêtements pouvaient constituer un problème assez sérieux.
Presque tous les auteurs qui ont écrit sur les Continents perdus les imaginent enveloppés d’une brume tourbillonnante. Dans la reconstitution de Max Heindel, l’Atlantide ainsi que Mu étaient plongées dans cette brume, « entourées d’une aura de brume légère, comme un lampadaire vu à travers un épais brouillard ». En 1931, Jennings C. Wise a écrit dans son livre Red Man. in the New World Drama les théories de Fabre d’Olivet concernant la race rouge en tant qu’Atlantes. « Pour d’Olivet, l’Atlantide n’était pas une simple terre de rêve. Pour son esprit incisif, elle surgissait de la brume du temps aussi clairement qu’il croyait qu’elle se tenait autrefois au-dessus des brumes de la mer qui l’engloutit. » Même Hollywood, dans ses films sur l’homme des cavernes, semble obligé de souffler des vapeurs de glace sèche depuis des fissures dans le sol et de faire dériver des nuages bas au-dessus des décors.
Ceux qui ont succombé à la fièvre tropicale des Continents perdus et de l’Égypte en Amérique ne sont pas tous des excentriques sans instruction, sans intelligence ou sans scrupules. Il y a moins d’un siècle, la maladie a emporté l’un des savants les plus respectés du monde. Dès l’âge de dix-sept ans, lorsqu’il fut intrigué par un article de la Gazette de France selon lequel un fermier brésilien avait trouvé une pierre plate, des armes et une armure macédoniennes, toutes portant des inscriptions grecques, Charles Stephen Brasseur de Bourbourg avait consacré sa vie à l’étude des antiquités américaines. Trente ans plus tard, une autorité reconnue sur l’histoire, la langue et la culture des Indiens du Mexique, il devint déprimé et frustré par le doute et le cynisme. Faisant fi de toutes ses conclusions antérieures sur l’archéologie et l’histoire des autochtones, il prit une décision que l’historien Hubert Howe Bancroft qualifia plus tard de « sacrifice de travail unique… dans les annales de la littérature ».
Né en 1814 dans une petite ville du nord de la France, Brasseur ressentit, comme il le dit, « un vif intérêt pour tous les faits géographiques relatifs à l'Amérique » après avoir lu le récit des prétendus restes grecs au Brésil.

Charles Stephen Brasseur de Bourbourg. D'après Winsor, avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque du Congrès.
Un article ultérieur dans le Journal des Savants d'Antonio del Rio, capitaine d'artillerie qui explora les désormais célèbres ruines mayas de Palenque, décida Brasseur de se tourner vers l'archéologie, bien qu'il s'essaye d'abord, à l'âge de vingt et un ans, sans grand succès, à l'écriture de romans et de contes moraux, le premier d'entre eux étant intitulé Les Épreuves de la Fortune et d'Adversité. Il se tourna ensuite vers des études philosophiques et théologiques, voyagea en Allemagne, en Italie et en Sicile, et en 1845, reçut les ordres et vint en Amérique.
Il se retrouva enfin dans la patrie des cultures et des tribus indiennes qui allaient retenir son attention pour le reste de ses jours. Boston, écrivit-il un jour, « ne cessera jamais d’être particulièrement chère à ma mémoire », car c’est là qu’il fit ses premiers pas dans la préhistoire des Indiens d’Amérique grâce aux célèbres écrits de William H. Prescott, dont la Conquête du Mexique est encore aujourd’hui l’ouvrage classique sur Cortez et ses conquistadores. Pour s’acquitter de ses devoirs sacerdotaux, Brasseur enseigna l’histoire de l’Église pendant un an au séminaire catholique de Québec, puis retourna à Rome pour représenter l’Église catholique d’Amérique du Nord à la cour papale de Pie IX. Il ne cacha cependant pas le fait que son intérêt principal fut toujours moins porté sur les questions religieuses que sur la culture aborigène américaine. « Je suis abbé de l’Église, fit-il remarquer à un admirateur nord-américain qui le rencontra à Rome, mais mes devoirs ecclésiastiques m’ont toujours été très légers. »
Cette dévotion avouée pour l’archéologie le poussa à rechercher à maintes reprises des missions dans l’Église qui lui permettraient d’approfondir ses études indiennes. Il était heureux à Rome car cela lui donnait l’occasion de consulter les rares codex mexicains et d’autres documents amérindiens conservés au Vatican. Mais il ne pouvait pas rester longtemps loin de l’Amérique et, en 1848, il y revint, visita New York et Niagara et retraça les anciennes routes des explorateurs français le long du Mississippi jusqu’à la Nouvelle-Orléans. De là, il prit un billet pour Veracruz, au Mexique, pour devenir « aumônier de la légation française », mais en réalité pour se consacrer plus intensément à l’étude directe des langues, des coutumes, de l’histoire et des antiquités des Indiens mexicains. Il était encore au Mexique lorsqu’il commença à vivre son étonnant renversement intellectuel.
Après des années de voyages à la recherche de documents indiens depuis longtemps oubliés, après avoir épluché péniblement les inscriptions floues et reconstitué l’histoire du passé mexicain pour en faire une histoire significative, le célèbre abbé Brasseur avait peu à peu commencé à soupçonner quelque chose d’entièrement nouveau et de très inquiétant dans ses archives. Au fond de son esprit, presque inconsciemment d’abord, mais plus tard avec une insistance de plus en plus pressante, s’était mis à douter que les anciens Toltèques, les prédécesseurs des Aztèques et les conquérants des Mayas du Yucatan, sur lesquels il avait écrit tant de savants ouvrages, aient jamais existé ! A sa propre horreur, il était de plus en plus convaincu que tous ces écrits indigènes qu’il avait si laborieusement traduits à partir des originaux nahuatl, maya yucatèque et quiché guatémaltèque étaient en fait de pures allégories, et que les divinités et autres personnages mythologiques des légendes mayas et mexicaines, à la compréhension desquels il avait contribué plus que quiconque, n’étaient que des représentations indiennes des grandes forces de la nature. Mais quelles forces de la nature ?
Perplexe, puis déconcerté par les écrits étranges et complexes d’une civilisation passée dont il ne parvenait pas à comprendre les concepts et les habitudes de pensée, l’abbé se tourna désespérément, comme tant d’entre nous le font en période de stress, vers le monde irréel, vers le surnaturel, pour trouver des réponses. C’était typique de Brasseur qu’une fois convaincu d’avoir raison, il ne pouvait plus revenir en arrière. Dans son bureau mexicain, si loin de son bien-aimé Paris et de sa Rome encore plus aimée, il saisit alors sa plume d’oie à l’ancienne, la trempa dans une bouteille d’encre rouge-brun maison et griffonna soigneusement les premières lignes du livre Quatre Lettres, qui devait retourner ses admirateurs scientifiques contre lui et ruiner une réputation d’érudition qu’il avait si laborieusement construite au cours d’années de voyages, d’études et d’écriture.
Une fois libéré des exigences empiriques, des exigences de la science, il trouva des réponses assez facilement, comme le font tous les mystiques. Les choses devinrent soudain très claires. Les pyramides d'Egypte étaient comme celles du Mexique, elles devaient être apparentées. Comment ? Eh bien, elles devaient descendre d'une civilisation ancestrale commune. L'Atlantide ! Si l'Atlantide était la mère de toutes les grandes cultures, cela expliquerait les nombreuses ressemblances entre l'Egypte et l'ancien Mexique. Les civilisations préhistoriques américaines devaient être nées sur l'Atlantide, les colons de ce continent s'étant installés en Amérique et ayant ainsi, comme les Guanchos, leurs prétendus compatriotes des îles Canaries, échappé au désastre qui s'abattit sur leur patrie. Cette race atlante, disait Brasseur, s'est répandue depuis le Nouveau Monde et a créé l'Egypte et d'autres grandes civilisations de l'Ancien Monde. Le dieu égyptien, Horus, n'était autre que Quetzalcoatl, le dieu-serpent à plumes des Mayas mexicains. D'autres divinités américaines antiques étaient en fait les grandes forces de la Nature qui détruisirent l'Atlantide. Il écrivit encore et encore ; ses idées, ne se laissant plus freiner par la prudence et la raison scientifiques, s'engagèrent dans la voie escarpée du mysticisme.
Brasseur était tenu en si haute estime que la plupart des autorités archéologiques et historiques de l’époque, bien que totalement en désaccord avec ses dernières vues et profondément perturbées par la tournure des événements dans sa vie d’érudit, n’étaient pas disposées à le condamner publiquement. L’abbé vécut dix ans après avoir annoncé ses nouvelles théories surprenantes, années de solitude considérable, de chagrin et d’obstination déterminée dans ses croyances. Pour leur défense, il tenta de traduire un célèbre manuscrit indien, le Troano, mais l’émotion gagnait désormais son esprit et ses conclusions devinrent de plus en plus folles, ses écrits décousus et décousus, jusqu’à sa mort, accablé de chagrin par le rejet de ses théories et humilié par le silence éloquent avec lequel elles furent accueillies. L’historien Bancroft écrivit peu après la mort de l’abbé en 1874 :
Brasseur de Bourbourg a consacré sa vie à l’étude de l’histoire primitive américaine. Aucun homme ne l’a jamais égalé ni approché en matière de connaissances réelles sur les sujets qu’il avait choisis. Au cours de la dernière décennie de sa vie, il a conçu une théorie nouvelle et compliquée concernant l’origine du peuple américain, ou plutôt l’origine des Européens et des Asiatiques d’Amérique, qu’il a fait connaître au monde dans ses Quatre Lettres. En raison de la nature extraordinaire des opinions exprimées et de la tendance bien connue de l’auteur à construire des structures magnifiques sur des fondations fragiles, ses derniers écrits ont été accueillis, pour la plupart par des critiques totalement incapables de les comprendre, avec un ricanement, ou ce qui semble avoir davantage attristé l’écrivain, dans le silence. Maintenant que le grand américaniste est mort, bien qu’il soit peu probable que ses théories soient jamais acceptées, son zèle pour la cause de la science antique et les nombreuses œuvres précieuses de sa plume seront mieux appréciés.
Les tribus perdues d’Israël ! Qui ne serait pas intrigué par ces mots qui nous semblent familiers, même si nous n’avons qu’une compréhension très vague de la théorie. Peut-être nous rappelons-nous vaguement que les Israélites furent conquis par un roi ennemi quelque part dans l’Ancien Testament et que certains d’entre eux furent dits « perdus » – errants ou emportés pour disparaître de l’histoire. La théorie selon laquelle les tribus perdues ont trouvé leur chemin vers l’Amérique et sont responsables d’un certain nombre d’anciennes civilisations indiennes a fait de nombreux adeptes, y compris un érudit renommé qui a consacré sa fortune puis sa vie à cette magnifique obsession.
Edward King, le jeune vicomte de Kingsborough, premier-né d’une noble famille irlandaise, se promenait paresseusement dans la bibliothèque Bodléienne d’Oxford par un matin gris et brumeux du début du XIXe siècle. La nouvelle de la victoire d’Andrew Jackson sur les troupes britanniques dans la plaine inondable de Chalmette, près de la Nouvelle-Orléans, venait d’atteindre l’Angleterre et, comme beaucoup de ses camarades d’études à Exeter College, le jeune lord Kingsborough était amer, désillusionné par la politique et le gouvernement, et à la recherche d’un débouché plus gratifiant pour ses intérêts intellectuels et sa fortune considérable. Armé d’une note d’introduction qui lui donnait accès aux pièces les plus rares de ces collections inestimables, il s’arrêta un instant devant une vitrine poussiéreuse contenant un ancien manuscrit indien mexicain, peint par les indigènes avec des pigments végétaux et minéraux sur une peau de daim rigide et plâtrée de blanc. Ses couleurs vives étaient toujours claires après au moins trois cents ans, et le style artistique étrange et les représentations grotesques si étrangères à la culture de l’Europe occidentale attirèrent immédiatement son attention. Fasciné, King se pencha sur cet ancien codex, perdu dans son environnement et inconscient du temps qui passait. Sa découverte devait littéralement conduire à sa mort prématurée.
Le jeune noble tomba alors amoureux des antiquités mexicaines, et cette passion devint l'obsession dominante de sa vie malheureuse. Après avoir terminé ses études à Oxford, il fut élu à la Chambre des Lords, mais il n'y avait pas de place dans sa vie pour les deux activités : les antiquités américaines étaient tout ou rien. Il prit la décision presque sans précédent de renoncer à son siège à la Chambre en faveur de son frère, puis se retira complètement de la vie publique pour étudier les manuscrits mexicains et l'archéologie.
Au cours de ses lectures, Kingsborough, dont les allégeances étaient apparemment des plus violentes, devint passionnément convaincu que les Indiens mexicains étaient les descendants des « tribus perdues d’Israël », dix tribus, ou comme certains disent, neuf tribus et demie de l’ancien royaume qui furent conquises et emmenées de Samarie par le roi d’Assyrie en 422 av. J.-C., laissant derrière elles les tribus de Juda, de Benjamin et la demi-tribu de Menassé. Selon certaines propositions, les Hébreux auraient atteint l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud directement depuis l’hémisphère oriental, mais la plupart des partisans de la théorie des tribus perdues pensent que la route passait par la Perse, les frontières de la Chine et le détroit de Béring. Quoi qu'il en soit, Lord Kingsborough a tellement exagéré dans son obsession que, malgré les lourdes dettes héritées de son père, il a dépensé toute sa fortune restante pour rassembler et publier un magnifique ensemble de neuf volumes impériaux in-folio reproduisant des codex mexicains et commentant des antiquités mexicaines, un objet de collection aujourd'hui, mais un luxe qui l'a mis, quatre ans après la parution du premier d'entre eux, en retard de paiement auprès d'un fabricant de papier pour un montant de 508 £ 10 s. 6 d.
En 1835, on se souvient que les gens allaient encore en prison pour dettes, et en novembre de cette année-là, la société londonienne eut un scandale de choix pour son passe-temps favori de bavardage : ce noble autrefois riche fut emprisonné dans une prison pour dettes ordinaires, sans doute à la satisfaction suffisante de ceux qui l’avaient ouvertement désapprouvé lorsqu’il avait renoncé à son droit d’aînesse. Kingsborough resta dans la prison du shérif jusqu’au 4 décembre, mais un peu moins d’un an plus tard, le 1er octobre 1836, il y retourna onze jours pour une condamnation similaire : cette fois pour une dette de 26 £ 4 shillings.11 d. À sa libération, ses amis pensèrent qu’il avait enfin compris la leçon, qu’il allait maintenant se ressaisir et oublier les frivolités de sa passion intellectuelle, devenir solvable et éviter les ennuis. Mais Edward King était mortellement accro à sa drogue préférée. Il continua à publier des ouvrages de luxe et, un mois plus tard, il entamait une troisième peine de prison pour une dette de 118 £ 17 shillings.7 d. Il mourut en prison pour dettes un an plus tard, à l'âge de quarante-deux ans, sans que les témoignages ne permettent de savoir si c'était du typhus, de la fièvre typhoïde ou, comme certains le prétendaient, d'un cœur brisé. Jacinto Jijón e Caamaño, qui lui a écrit un hommage en 1918, dit que si Lord Kingsborough avait vécu un an de plus, il aurait hérité des titres et des prérogatives de son père, ainsi que d'un revenu locatif de 40 000 £ par an. Nous apprenons à compter sur l'historien Hubert Howe Bancroft pour évaluer les meilleures et les pires qualités d'un homme. Bien que Bancroft ait eu peu de patience avec la théorie des tribus perdues, et bien qu’il ait déclaré volontiers que le vicomte manquait d’impartialité et de recherches approfondies, que ses données étaient loin d’être ordonnées et que Kingsborough était un fanatique, son enthousiasme n’a néanmoins jamais été offensant. « Il y a dans son travail une dignité savante que n’ont jamais atteint ceux qui l’ont raillé et injurié ; et bien que nous puissions sourire de sa crédulité et regretter qu’un zèle aussi fort ait été si étrangement déplacé, nous devons néanmoins parler et penser avec respect à l’égard de quelqu’un qui a consacré sa vie et sa fortune, sinon sa raison, à un effort honnête pour jeter la lumière sur l’un des points les plus obscurs de l’histoire de l’humanité. »
Ce malheureux jeune homme n’était pas le premier, ni le dernier de plusieurs milliers d’autres, à croire que les Indiens d’Amérique étaient des restes des Israélites. Il existait de nombreux écrits sur les tribus perdues aux XVIe et XVIIe siècles1, car un certain nombre d’Espagnols en Amérique étaient heureux d’avoir une excuse pour reléguer les aborigènes au statut misérable des Juifs européens. Le degré de logique exigé des érudits de l’époque est indiqué par un passage du célèbre ouvrage du rabbin d’Amsterdam Menasseh ben Israël, Origin de los Americanos, esto es esperanza de Israel, publié en 1650. Il parlait d’un voyageur juif en Amérique du Sud, un homme nommé Aaron Levi, alias Antonio Montesini, qui était sûr que son guide indien était un Israélite lorsque ce dernier l’accueillit avec le Shema (Shema Israël, « Ecoute, ô Israël », Deut. 4:4). Lorsque le guide assura à Montesini qu’un nombre considérable d’Indiens « de la même origine » que lui vivaient dans les montagnes près de Quito, Montesini et le grand rabbin d’Amsterdam après lui en conclurent qu’une tribu perdue d’Israélites vivait encore dans les hautes terres d’Amérique du Sud.
1 Bartolomé de las Casas, le prêtre espagnol qui a si ardemment défendu les droits des Indiens à une époque où l'exploitation des indigènes était une procédure acceptée, aurait été, selon le père Torquemada, le premier à suggérer cette théorie il y a plus de quatre cents ans, mais comme l'a souligné Edward John Payne de l'University College en 1899, les preuves présentées par Torquemada pour défendre cette supposition plaidaient en réalité contre elle.
Selon une grande autorité en histoire hébraïque, Allen H. Godbey, l'un des premiers partisans des tribus perdues fut un autre Espagnol du début du XVIe siècle, Francisco Lopez de Gomara, ainsi qu'un calviniste français, De Lccy, Genebrard et Andrew Thevel, à peu près à la même époque. J. Imbelloni ajoute à ces noms le nom de Diego Gonzalo Fernandez Oviedo (1535). Le Dr Godbey mentionne le père Duran, dont la célèbre Historia de las Indias de Nueva Espana parut en 1585. Gregorio Garcia écrivit également sur cette hypothèse dans la dernière partie du siècle. Parmi les nombreux défenseurs des tribus perdues qui se succédèrent au fil des générations, on trouve Roger Williams, John Eliot, William Penn, Samuel Sewall et Increase et Cotton Mather.
D’autres auteurs de l’Antiquité ont prêché que la découverte des tribus perdues depuis longtemps, encore sous la protection spéciale du Dieu Tout-Puissant pendant plus de deux mille ans, bien que méprisées par toute l’humanité, « conduirait tous les hommes à reconnaître que le Dieu d’Israël est un Dieu de vérité et de justice, et qu’il aime jusqu’à la fin ceux qu’il aime ». Comme l’anthropologie en tant que science n’existait pas à cette époque, les missionnaires, les historiens et les autres voyageurs qui exploraient le monde connu en pleine expansion étaient constamment étonnés des similitudes qu’ils trouvaient dans les modes de vie entre des tribus jusque-là inconnues et celles qui leur étaient déjà familières grâce aux récits bibliques. Aujourd’hui, vous pouvez vous rendre dans les Human Relations Area Files de l’une des nombreuses universités, demander un inventaire de tous les peuples du monde qui pratiquent une coutume particulière – le mariage entre cousins, par exemple – et en un temps relativement court, vous pouvez obtenir tous les exemples connus, ainsi que les données détaillées et l’histoire de chacun. Les premiers auteurs, ignorant comment des coutumes similaires peuvent se développer indépendamment les unes des autres, étaient généralement enclins à les attribuer à des liens historiques.
La culture tribale hébraïque antique était la mieux connue à cette époque, ses coutumes « étranges » (mariage par achat ou en échange de services rendus au beau-père, héritage d’une belle-sœur veuve comme épouse, sacrifices humains et animaux, etc.) étant familières à travers les récits de l’Ancien Testament sur Abraham, Isaac, Jacob, Rachel, Laban, Léa, Bilha et compagnie. Lorsque leurs coutumes supposément uniques ont commencé à réapparaître ailleurs dans le monde, en particulier au vu des nombreuses prophéties selon lesquelles les Juifs reviendraient un jour et seraient réunis avec leurs frères, des voyageurs pieux ont découvert des vestiges israélites perdus parmi les Afghans, les Abyssins, les Masaï et les Zoulous africains, les Cafres, les Japonais, les Birmans, les Karens et les Malais ; même les vieux Anglo-Saxons, une fois leurs coutumes connues des historiens littéraires, sont devenus hébreux par descendance. Les Indiens d'Amérique se sont bien sûr joints à cette illustre compagnie en temps voulu, car ici et là, parmi eux, on ne pouvait guère échapper à voir des cérémonies de prémices, de nouveaux festivals du feu, des sacrifices aux dieux, des calendriers lunaires et rituels, des légendes de géants destructeurs, des mythes du déluge, des fêtes, des exorcismes, des rites de purification, des jeûnes et des tabous alimentaires, des confessions, des pèlerinages, des endogamies et autres restrictions au mariage, et surtout, la circoncision et la vénération d'une arche tribale.
Selon un auteur du début du XVIIIe siècle, quinze siècles après que Josué eut expulsé les Cananéens, ses descendants, ayant découvert leur origine et animés par leur haine ancestrale, livrèrent à nouveau la bataille de Jéricho sur le sol américain, incendiant cette fois leurs temples, leurs tours et leurs villes du Nouveau Monde. Lescarbot conclut que le Nouveau Monde n’était pas peuplé par les Israélites, mais par les Cananéens que les premiers avaient eux-mêmes expulsés. Il affirma catégoriquement que les Américains sont les descendants de Noé. Josiah Priest, dans son ouvrage American Antiquities (1798), tenta de montrer que l’Amérique était peuplée avant le déluge, que c’était le pays de Noé et le lieu où l’arche avait été érigée. Cependant, Priest affirma que les célèbres tertres indiens de Marietta, sur la rivière Ohio, étaient les ruines d’un fort romain.
Les dissidents de la théorie ne tardèrent pas à se faire entendre. En 1633, William Wood, après une courte visite en Nouvelle-Angleterre, protesta que les mots amérindiens, qui avaient été déclarés apparentés à l’hébreu, pouvaient tout aussi bien être considérés comme les glanages de toutes les nations, « parce qu’ils ont des mots qui ressemblent au grec, au latin, au français et à d’autres langues… ». En 1652, Sir Hamon L’Estrange écrivit un traité intitulé Americans no Jewish (Les Américains ne sont pas des Juifs), et la théorie israélite fut à nouveau contestée par J. Ogilby en 1670, et par Hubbard, qui écrivit dans son Histoire de la Nouvelle-Angleterre de 1680 : « Si l’on observe leurs manières et leurs dispositions, il est plus facile de dire de quelles nations ils ne tirent pas leur origine que de qui ils tirent leur origine. Sans doute leurs conjectures, ceux qui les imaginent descendre des dix tribus d’Israélites… « Les Juifs sont plus raisonnables que les autres, car on ne trouve aucune trace de leur proximité avec eux plus qu’avec aucune autre tribu de la terre, que ce soit quant à leur langue ou à leurs manières. » Le Père Lévêque a reconnu en 1836 les pièges du raisonnement des Tribus Perdues : « Si Jules César avait été un amoureux des Juifs, écrivait-il, ou s’il s’était senti, d’une manière ou d’une autre, intéressé par leurs affaires, il aurait tout aussi bien pu découvrir les tribus perdues d’Israël parmi les anciens Gaulois et Bretagnes dans son Bellum Gallicum. »
John Mackintosh, qui traduisit l’ouvrage de Leveque, attaqua la théorie des tribus perdues avec la plus grande vigueur dans son propre livre la même année, avertissant que la ressemblance superficielle entre les sons des mots hébreux et ceux de diverses langues indiennes n’était pas suffisante pour proposer un lien historique ; « les jugements de ceux qui s’efforçaient de faire des recherches de cette façon étaient tellement pervertis qu’on imaginait des ressemblances qui n’existaient pas en réalité. » En 1853, Mariano Edward Rivero et John James von Tschudi, écrivant sur les antiquités péruviennes, consacrèrent plusieurs pages à des preuves alors considérées comme en faveur de la théorie israélite, mais conclurent que l’hypothèse « ne repose sur aucune base solide ».
Au milieu du XIXe siècle, un autre argument fut avancé contre l’idée des tribus perdues selon laquelle les Indiens seraient d’origine indienne. James Kennedy, Esq., LL.B., écrivant sur l’ origine probable des Indiens d’Amérique, avec une référence particulière à celle des Caraïbes, observa que les dix tribus n’avaient jamais disparu. En 1872, John D. Baldwin déclara qu’il n’y avait nulle part un fait, une suggestion ou une circonstance quelconque prouvant que les dix tribus aient jamais quitté l’Asie du Sud-Ouest, où elles résidaient après la destruction de leur royaume. « Elles furent « perdues » pour la nation juive parce qu’elles se rebellèrent, apostasièrent et, après leur soumission par les Assyriens en 721 av. J.-C., furent dans une large mesure absorbées par d’autres peuples de cette partie de l’Asie. Certains d’entre eux étaient probablement encore en Palestine lorsque le Christ apparut. Cette idée farfelue, appelée théorie, ne mérite guère autant d’attention. » Ce point de vue est défendu aujourd’hui par d’éminents érudits hébraïques ; Dans son livre de référence, The Lost Tribes a Myth, le Dr AH Godbey, professeur d'Ancien Testament à l'Université Duke, se plaint du fait que cette fantaisie est encore exposée en chaire par des hommes supposés être des érudits, qui « présentent la disparition politique des « tribus perdues » comme une terrible illustration de la punition du péché individuel ; comme si devenir Américain était la sanction pour être un Anglais pécheur. »
Pour les anthropologues, le plus célèbre défenseur des tribus perdues, après Lord Kingsborough, était James Adair, qui a vécu quarante ans parmi les Indiens d’Amérique du Nord au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Comme l’a déclaré Samuel G. Drake en 1841, Adair « tourmenta toutes les coutumes et tous les usages pour les rendre semblables à ceux des Juifs, et presque tous les mots de leur langue devinrent des mots hébreux ayant le même sens ». Par exemple, Adair racontait que pendant les cérémonies indiennes des prémices, les indigènes chantaient la phrase mystique Yo Meschica, He Meschica, Va Meschica ; pour un fervent partisan de la théorie israélite, les premières syllabes de ces trois termes formaient le nom Jéhovah, et le reste de chaque terme était clairement Messie. Adair soutenait sa thèse à la fois sur l’arrivée et sur le départ, pour ainsi dire ; Lorsqu’il entendit les Indiens chanter Schiluhyu, Schiluhe, Schiluhva, il choisit cette fois les dernières syllabes pour voir à nouveau Jéhovah, le Schiluh étant le même que l’hébreu Scheleach ou Schiloth, « messager ou pacificateur ». Les Indiens appelaient une personne accusée ou coupable Haksit canaha ; ce qui, assura Adair à ses lecteurs, signifie « un pécheur de Canaan ». La manière dont les Cananéens ont atteint l’Amérique est une autre histoire longue et compliquée, appuyée par une autre longue liste de personnes, dont l’érudit français Lescarbot, avocat au Parlement de Paris, en 1611, et le président Esra Stiles de Yale (1783).
Le regretté Theodore A. Willard, fabricant de piles, était un passionné d’antiquités mayas qui voyait d’un bon œil la théorie des tribus perdues ainsi que le mythe de l’Atlantide. Il rappelait le récit de l’évêque Diego de Landa datant du XVIe siècle d’une vieille tradition yucatèque selon laquelle leurs premiers colons étaient venus de l’est par voie maritime – une légende presque invariablement citée comme preuve par les partisans des théories phénicienne, égyptienne, israélite et atlantiste – et il attirait l’attention sur le « teint distinctement sémitique » des figures humaines représentées dans les sculptures et peintures murales antiques des ruines mayas. « La dignité du visage et l’attitude sereine de ces portraits sculptés ou peints », écrivait-il en 1926, « sont étonnamment hébraïques ».
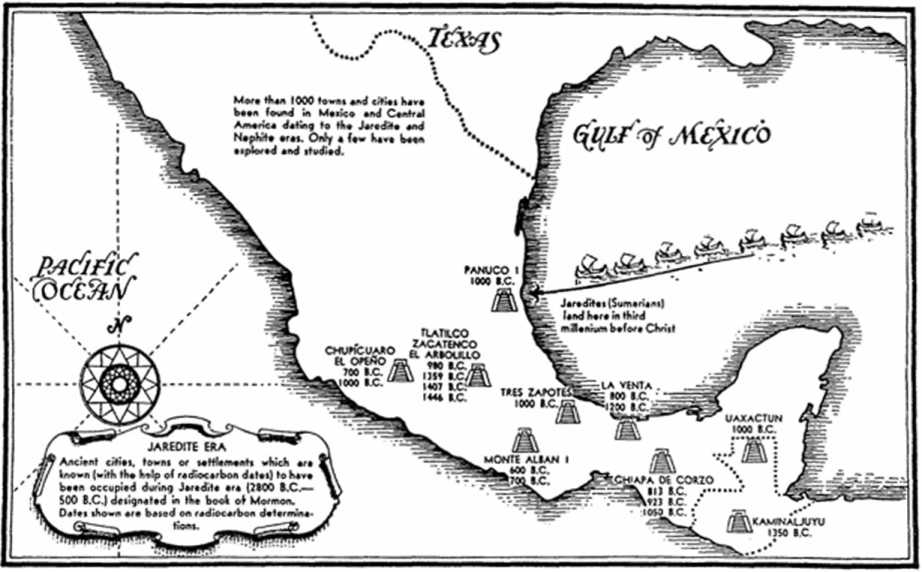
L'ère des Jarédites dans la croyance mormone. Les Jarédites sumériens débarquèrent sur la côte du golfe du Mexique et fondèrent les centres qui sont aujourd'hui des ruines antiques. D'après HA Ferguson.
Contrairement à la croyance populaire et en contradiction avec de nombreuses encyclopédies, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours nie que son Livre de Mormon s’intéresse aux tribus perdues, mais elle a été l’organisation la plus active et la plus persistante à chercher à prouver que les Hébreux sont venus en Amérique et y ont fondé les civilisations indiennes de l’époque précolombienne, comme le rapporte leur livre sacré. Depuis dix-neuf ans, de jeunes missionnaires mormons visitent mon bureau de l’Université Tulane, certains d’entre eux en route vers le Golfe du Mexique et les Caraïbes dans l’espoir de trouver un soutien concret à la thèse mormone. L’un d’eux, avec une barbe d’explorateur et un anneau d’or dans un lobe d’oreille, a commandé une goélette en direction du Golfe et a prévu d’y faire dériver une petite flotte de modèles réduits des voiliers décrits dans le Livre de Mormon. Il les suivait à l'aide de taches colorées qu'elles devaient libérer automatiquement au fur et à mesure qu'elles flottaient sur les eaux, pour trouver quelle partie du continent les anciens navigateurs d'Israël étaient susceptibles d'avoir atteint en premier, emportés par les vents et les courants dominants. Je n'ai jamais revu ce jeune homme, mais d'après une description de lui, de sa barbe soyeuse et de sa boucle d'oreille en or, que j'ai entendue un an plus tard environ, j'estime que j'ai raté une deuxième visite de sa part. J'aimerais entendre les résultats de son expérience.
Autant que je sache, les Indiens d’Amérique ne sont mentionnés dans aucun autre dogme officiel de l’Église. L’article 8, chapitre 15, des Articles de foi du Livre de Mormon présente les preuves de l’Église qui soutiennent sa croyance selon laquelle l’Amérique fut colonisée par un peuple appelé Jarédites, venu directement des scènes confuses de la tour de Babel décrites dans la Genèse ; que les Jarédites, après une série de calamités, furent détruits au deuxième siècle avant J.-C. ; et qu’un Israélite nommé Léhi et ses disciples arrivèrent également sur ce continent depuis Jérusalem vers 600 avant J.-C., se divisant en deux groupes, les Néphites et les Lamanites, les premiers construisant les grandes villes précolombiennes de l’Amérique centrale et des Andes, et s’éteignant vers 324 après J.-C. ; les seconds, un peuple nomade non agricole qui continua dans une « condition dégénérée », sont maintenant représentés par les tribus indiennes que nous connaissons mieux en Amérique du Nord.
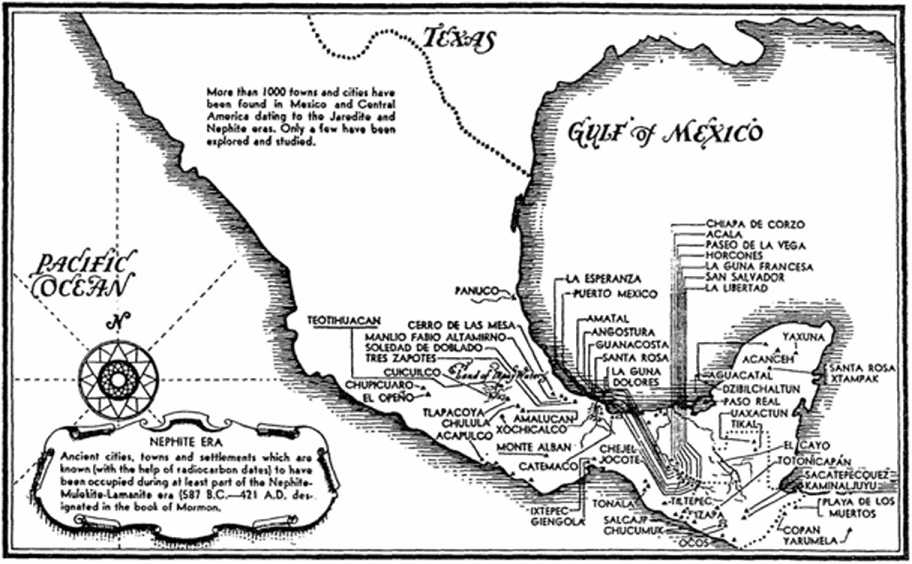
L'ère néphite dans la croyance mormone. Les Israélites sont arrivés en Amérique vers 600 av. J.-C., un groupe d'entre eux, les Néphites, occupant les anciennes villes indiquées sur la carte. D'après H.A. Ferguson.
Les Mémoires d'un Mormon de L.A. Bertrand donnent un compte rendu quelque peu différent des croyances mormones : « Les Jarédites traversèrent l'océan dans huit navires, débarquèrent en Amérique du Nord et y bâtirent des nations hautement civilisées et de grandes villes ; leurs descendants défièrent cependant le Seigneur et furent détruits six cents ans avant Jésus-Christ. Les Israélites de Jérusalem les remplacèrent, débarquant sur la côte ouest de l'Amérique du Sud ; des descendants de Juda vinrent également de Jérusalem en Amérique du Nord, puis émigrèrent dans les régions septentrionales de l'Amérique du Sud. Le premier groupe israélite se sépara en deux nations : la première porte le nom du prophète Néphi, qui les conduisit en Amérique, et la seconde celui de leur chef méchant et corrompu, Laman. Les Néphites se dirigèrent vers le nord de l'Amérique du Sud ; les Lamanites occupèrent les parties centrales et méridionales du même continent. Les Néphites s'étendirent vers l'est, l'ouest et le nord, prospérèrent grandement, mais étaient constamment en guerre avec les Lamanites païens. » Les descendants de Juda devinrent eux aussi athées et semi-barbares, mais ils apprirent les Écritures sacrées des Néphites, qui les rejoignirent et colonisèrent plus tard le continent du Nord. Finalement, les Néphites tombèrent eux aussi en disgrâce et furent punis par des tremblements de terre, le feu du ciel et la guerre. Le Christ apparut aux restes néphites et ses apôtres prêchèrent l’Évangile dans tout l’hémisphère, convertissant les Néphites comme les Lamanites. Mais ils rétrogradèrent de nouveau et furent « une fois de plus frappés par le bras du Tout-Puissant ». Les Néphites périrent dans une grande bataille finale près de la colline de Cumorah (dans l’État de New York), où Mormon enterra les tablettes sacrées qui furent finalement enlevées en 1827 par Joseph Smith.
John Taylor, président des mormons, a déclaré que le dieu maya mexicain, Quetzalcoatl-Kukulkan, et le Christ étaient le même être, citant lord Kingsborougk qui a observé que Quetzalcoatl est représenté dans l’art indien comme une personne crucifiée. Deux auteurs mormons actuels, Milton R. Hunter et Thomas Stuart Ferguson, présentent leurs raisons supplémentaires pour soutenir cette croyance, citant des parallèles entre les descriptions de Quetzalcoatl dans un ancien document mexicain et celles du Livre de Mormon. Ils attirent également l’attention sur Apocalypse 22:16 : « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les Eglises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Quetzalcoatl était identifié à Vénus, l’étoile du matin, par ses adorateurs indiens ; En fait, la crucifixion que Lord Kingsborough a mentionnée est le sacrifice très répandu de l'Étoile du Matin, un rituel dans lequel un être humain, souvent un esclave ou un captif, était étendu sur un échafaudage, les bras écartés, puis abattu d'une flèche. (Les théoriciens précédents sur les origines des Indiens d'Amérique ont identifié Quetzalcoatl de diverses manières comme étant Atlas, Saint Thomas, Votan, Osiris, Dionysius, Bacchus, un missionnaire bouddhiste ou brahmane, Viracocha et Mango Capac du Pérou, Poséidon et Hotu Matua, le héros culturel de l'île de Pâques dans le Pacifique.)
Les mormons s’appuient sur ce qu’ils considèrent comme des parallèles significatifs entre le Livre de Mormon et les Annales d’Ixtlilxochitl, ce dernier étant un document historique écrit au XVIe siècle par un Indien mexicain, Fernando de Alva Ixtlilxochitl, petit-fils du dernier roi indigène de Tezcuco. Hunter et Ferguson documentent cet argument avec des descriptions et des illustrations montrant des ressemblances entre les costumes, les arts, l’artisanat, l’architecture et d’autres traits culturels des Égyptiens, d’une part, et les descendants des Hébreux en Amérique, d’autre part. Ils attaquent les attitudes anthropologiques orthodoxes du « tout ou rien » : selon lesquelles les Indiens d’Amérique étaient tous mongoloïdes ou aucun racialement, et que le Nouveau Monde était peuplé entièrement par la Sibérie-détroit de Béring ou aucun. « De plus, prétendre que de tels personnages à la barbe et au nez convexe [représentés dans les vestiges mexicains et yucatèques]… Les représentants des Mongoloïdes sont des ignorants, des « preuves réelles » évidentes du contraire. Ce sont des représentations de Caucasiens et toutes les esquives et les ignorances qui se produisent à l’égard de ces preuves ne changeront pas la vérité. . . . Ceux qui persistent à suivre les théories du « tout ou rien » doivent accuser Ixtlilxochitl, Sahagun, Torquemada, les Señores de Totonicapan et Xahila, et Joseph Smith d’ignorance ou de fausses déclarations délibérées pour avoir dit que les colonisateurs sont venus en Amérique par bateau de l’autre côté de la mer. Ces gens remarquables sont morts et ne peuvent pas parler pour eux-mêmes ; cependant, les figurines en pierre et en céramique des anciens colonisateurs parlent de manière très éloquente depuis la terre. Ce sont des « voix de la poussière » qui constituent des preuves réelles qui ne seront pas facilement surmontées ; et, dans une large mesure, il semble que cette « preuve réelle » indique que les premiers colons de la Terre d’Abondance ressemblaient beaucoup aux anciens Proche-Orientaux, tant dans leur tenue que dans leur tenue vestimentaire.
Les Annales n’ayant été publiées en anglais qu’en 1848, soit dix-huit ans après la première édition du Livre de Mormon, les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours soulignent que les ressemblances entre les deux livres ne peuvent être attribuées à une quelconque connaissance que Joseph Smith aurait pu avoir de la chronique indienne. Les critiques non juifs du mormonisme soutiennent cependant qu’en 1830, lorsque Smith a publié sa traduction des tablettes d’or, il existait de nombreux livres sur la théorie des tribus perdues qu’il aurait pu lire et qui auraient pu l’influencer dans sa traduction des inscriptions sacrées. Ils pensent également qu’aux alentours de 1600, lorsqu’Ixtlilxochitl écrivait, il était sans doute fortement influencé par l’enseignement chrétien, qui aurait teinté ses récits de la création indienne, du déluge, de l’arche, d’une tour de type Babel et d’une confusion des langues avec dispersion ultérieure des populations.
Il y a environ un siècle, Lucien de Rosny a souligné les ressemblances entre la Bible hébraïque et le livre sacré des Indiens Quichés du Guatemala, le Popol Vuh, un recueil de traditions et d’histoire écrit peu après la conquête espagnole par un ou plusieurs Indiens Quichés. De Rosny a montré que les deux Bibles contiennent l’histoire de la mer qui s’est miraculeusement ouverte pour laisser passer des tribus fugitives ; toutes deux parlent d’une confusion des langues et d’une tour de Babel ; et toutes deux racontent comment la loi sacrée a été transmise à des prêtres au sommet d’une montagne, le dieu maya, Tohil, la donnant à son prêtre, Chi-Pixab, tout comme Jéhovah l’a donnée à Moïse. Il est également facile de trouver des histoires et des images de déluge dans ces livres indiens autochtones, même dans les codex mayas clairement précolombiens. Les anthropologues attribuent les passages presque identiques du Popol Vuh et de la Bible à l’influence européenne sur le scribe autochtone qui a consigné le premier, et ils considèrent les histoires de déluge précolombiennes comme des légendes indépendantes issues de déluges différents.
Le regretté professeur Roland B. Dixon de Harvard a inclus une discussion sur les histoires de déluge dans son livre, The Building of Cultures, qui était en grande partie consacré à attaquer l’école de diffusion égyptianiste. Dixon a déclaré que les mythes relatant un grand déluge au cours duquel toutes les personnes ont été détruites sauf une ou un petit groupe de survivants sont largement répandus dans le monde, bien que moins courants en Afrique qu’ailleurs. Cependant, « à part l’idée de base d’un déluge auquel peu de personnes échappent, les détails et même les idées fondamentales des récits sont différents ». Dans un cas, montre-t-il, la cause du déluge peut être un accident, dans un autre, elle peut être due au mécontentement divin, dans un autre encore à une inimitié personnelle entre deux êtres surnaturels. « Le moyen de se sauver peut être un bateau, ou l’escalade d’un grand arbre ou d’une montagne ; le monde peut redevenir habitable par une décrue, ou peut avoir besoin d’être recréé par le survivant ». Dixon a déclaré que tous les peuples, à l’exception de ceux des régions les plus arides, ont dû, à un moment ou à un autre, connaître des inondations soudaines et désastreuses, et sur cette base, « l’imagination mythique construit son intrigue individuelle ».
À l’université Brigham Young de Provo, dans l’Utah, un important département d’archéologie publie son propre Bulletin, qui rassemble les résultats des recherches des professeurs et des étudiants dans ce domaine. Certains articles sont des reportages purement factuels, d’autres comportent au moins une brève interprétation favorable au dogme de l’Église. Le Bulletin a publié quelques études intéressantes sur la distribution des traits, concentrées sur des motifs que l’Église trouve pertinents pour son histoire. Par exemple, dans un numéro de 1953, deux articles sont consacrés aux représentations de « l’arbre de vie » dans l’art maya. Il s’agit de motifs en forme de croix qui figurent dans un certain nombre de sculptures et de peintures mayas et mexicaines anciennes. Considérant cette figure comme la croix du Christ, les premiers auteurs y ont vu la preuve que les enseignements chrétiens avaient atteint le Nouveau Monde avant Colomb. Les archéologues modernes y font généralement référence comme à un arbre conventionnel, qui figure apparemment dans la mythologie, l’histoire ou la religion précolombiennes. Pour les mormons, les différents éléments qui apparaissent de manière assez constante dans ce motif indiquent non seulement un lien historique avec l'Ancien Monde, qui a produit des formes d'art très similaires, notamment à Java et au Cambodge, mais sont également identifiés à des histoires familières de la Bible et de la mythologie grecque.
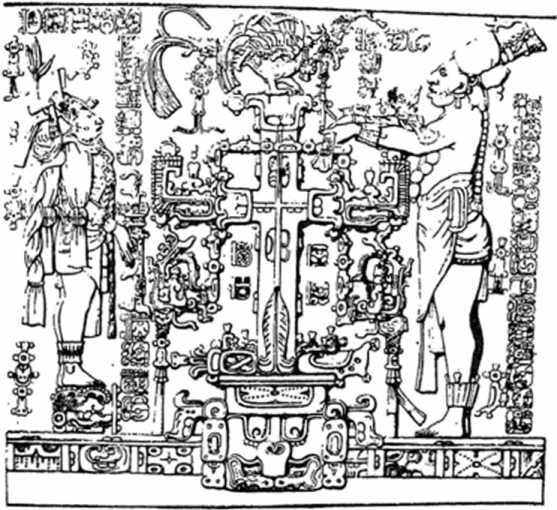
Arbre stylisé en bas-relief, Temple de la Croix, Palenque, Mexique. Les premiers Espagnols pensaient qu'il s'agissait de la croix du Christ. Les mormons croient qu'il s'agit de l'Arbre de Vie. D'après AP Maudslay.
Un autre ouvrage particulièrement intéressant pour sa distribution des traits et de loin l'exposé le plus complet des preuves en faveur des croyances mormones sur l'Amérique ancienne est celui de Thomas Stuart Ferguson, One Fold and One Shepherd, publié en 1958. Son thème est que l'Amérique centrale et le Mexique ont reçu leur toute première civilisation élevée des Jarédites mésopotamiens qui ont débarqué sur la côte du golfe du Mexique oriental au troisième millénaire avant J.-C., et de deux petits groupes d'Israélites, descendants de Joseph, qui ont traversé l'océan au sixième siècle avant J.-C., et que le Livre de Mormon raconte l'histoire de cette colonie hébraïque depuis son départ de Jérusalem en 597 avant J.-C. jusqu'à la destruction de sa nation américaine en 385 après J.-C. Ferguson nous rappelle que le Livre de Mormon ne prétend pas expliquer l'origine de toutes les cultures à toutes les époques et dans toutes les zones de l'hémisphère occidental - seulement les hautes civilisations - et qu'il ne contredit pas la présence de cultures de l'âge de pierre en Amérique avant ou pendant la période dont il traite, ni les influences possibles de l'Asie du Sud-Est. Nous allons le décrire au chapitre 6. One Fold and One Shepherd, qui représente un travail et une étude considérables de la part de son auteur consciencieux et dévoué, rassemble de nombreuses ressemblances entre les vestiges et documents archéologiques mayas mexicains d’une part, et les « pays bibliques » (principalement l’Égypte, l’Asie Mineure et la Mésopotamie) d’autre part. Dans une section, il énumère 298 « éléments de culture » communs aux pays bibliques et à l’Amérique centrale à l’époque préhistorique, allant littéralement de « A » (briques d’adobe) à « Z » (séquence zodiacale).
La New World Archeological Foundation, créée il y a quelques années par des mormons et financée en grande partie par des contributions mormones, mène depuis plusieurs années des explorations et des fouilles dans le sud du Mexique parmi les ruines des époques préhistoriques pendant lesquelles, selon eux, les colonies sumériennes et israélites furent fondées en Amérique. Bien qu’ils soient tout à fait disposés à expliquer leurs croyances lorsque l’occasion leur semble appropriée, les saints des derniers jours évitent pour la plupart les débats passionnés et amers qui ont caractérisé ce domaine général de la question, bien qu’ils soient contrariés par le fait que les anthropologues non juifs ne prennent pas le Livre de Mormon suffisamment au sérieux pour se familiariser avec son contenu ou lui donner un procès équitable en tant que source historique authentique. Les mormons sont convaincus que l’archéologie étayera pleinement leurs croyances sur les habitants préhistoriques de l’Amérique, tout comme elle a confirmé de nombreuses villes et événements décrits dans la Bible. J’ai enseigné un été dans l’Utah, où peut-être la moitié de mes étudiants à l’université d’État étaient mormons. En dehors des cours, la question des origines des Indiens d’Amérique n’a jamais été soulevée, et même en classe, les étudiants ont montré une attitude plus détendue que je ne l’avais prévu à l’égard des questions discutables. En effet, le jour même de mon arrivée à Salt Lake City, le journal a publié un avertissement de l’un des responsables de l’Église lors d’une réunion de jeunes à l’échelle de l’État, selon lequel le Diable était connu pour essayer d’empoisonner l’esprit des étudiants par le biais des enseignements plausibles des professeurs d’université. (J’ai entendu Billy Sunday dire la même chose devant un tabernacle rempli d’étudiants et de professeurs d’université de Caroline du Sud il y a environ quarante ans.) La déclaration mormone la plus agressive que j’aie entendue était extrêmement modérée dans un livre de 1924 de Lewis Edward Hills, New Light on American Archaeology. Citant le Psaume 82 : « Ils ont pris des conseils astucieux contre les êtres cachés de Dieu », Hills expliquait que les anciens Américains étaient les êtres cachés de Dieu, et que les conseils et les astuces étaient des tentatives ultérieures pour détruire la croyance selon laquelle ces gens étaient des Israélites. « Je crois que cela continue », a ajouté Hills.
Selon Hills, le pays des nombreuses eaux, rivières et fontaines (Mormon 701 : 5) était la vallée du Mexique ; la tour de Sherrizah était la pyramide du Soleil à Teotihuacan, que de nombreux touristes américains ont visitée ; Behor était ce qui est maintenant la ville en ruines de Cholula, et Ammonihah (Mormon 360 : 14, 15) était Tikal, la plus grande ruine maya connue, enfouie au plus profond de la jungle du Peten, au nord du Guatemala, et actuellement explorée par le musée universitaire de Philadelphie. La ville d’Abondance du Livre de Mormon (545 : 25, 26) se trouvait dans la partie nord du pays, Abondance, dans les contreforts surplombant les lagons près du golfe du Mexique. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours croit en la révélation actuelle et continue, dit l’ Encyclopaedia Britannica, « par la parole directe à oreille et la présence visible de Dieu ; par la communication vocale sans présence visible ; par la visite des anges et la délivrance de messages ; Lewis Hills a eu la seconde révélation de ce genre alors qu’il essayait de localiser sur une carte du Mexique la colline nommée Shim mentionnée dans Le Livre de Mormon. « J’ai commencé à la marquer sur la carte au nord de la ville de Désolation. Alors que je commençais à la poser, une voix m’a parlé et m’a dit : « La colline de l’autre côté. » J’ai immédiatement regardé ma carte Rand & McNally devant moi, et là, bien sûr, j’ai vu une montagne appelée « Mont Zem ». Le Livre de Mormon l’a appelée la colline Shim, et elle s’appelle aujourd’hui Mont Zem. C’est très clair pour moi : Shim et Zem sont la même chose. »
Les relations tendues qui existent assez généralement entre les professionnels d’une part et les milliers de passionnés du Continent perdu, des Tribus perdues et du Kon-Tiki d’autre part, découlent, comme nous l’avons vu, de quatre siècles de controverses sur l’origine des Indiens d’Amérique, en particulier des Mayas et des Aztèques du Mexique et d’Amérique centrale, ainsi que des Incas et d’autres grandes civilisations andines d’Amérique du Sud. Parce qu’ils sont presque tous d’accord sur une version de l’Asie à l’Alaska du peuplement du Nouveau Monde – certains sont également prêts à admettre des contacts sporadiques et beaucoup plus tardifs à travers le Pacifique depuis l’Asie du Sud-Est – les anthropologues professionnels sont considérés par les partisans des autres théories comme des isolationnistes mentalement fossilisés dans leur tour d’ivoire, tandis que les docteurs en philosophie considèrent leurs harceleurs amateurs comme, au mieux, des mystiques égarés dont la théorie dans ces domaines scientifiques est plus émotionnelle qu’intellectuelle.
Les mystiques ne nient nullement cet aspect de leurs doctrines.
Ralph M. Lewis, chef vénéré de l’Ordre rosicrucien, écrivait en 1950 dans un article intitulé « Science et mysticisme » : « Les expériences mystiques semblent provenir entièrement de l’être de l’individu. De plus, elles lui procurent une satisfaction qui va bien au-delà des plaisirs physiques et intellectuels. » Les partisans de ce que les professionnels appellent avec une certaine mauvaise humeur « les théories les plus folles » sont attirés par leur sujet aussi irrésistiblement qu’un toxicomane par sa drogue ; ils sont désireux et impatients de s’asseoir pour en discuter tout l’après-midi avec quiconque manifeste le moindre intérêt. Comme ils sont donc quelque peu brusquement évités par presque tous les publics professionnels visés, les amateurs ont tendance à se considérer comme des martyrs intellectuellement persécutés ou du moins snobés.
Par exemple, Thor Heyerdahl, dont le best-seller Kon-Tiki et Aku-Aku, comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, a donné à sa théorie des relations culturelles entre les Indiens d’Amérique du Pérou et l’Océanie un public qui s’approchait rapidement de celui des projets israélites et atlantistes, a décrit avec amertume l’opposition obstinée qu’il a rencontrée « dans un bureau sombre à l’un des étages supérieurs d’un grand musée de New York ». La plupart des lecteurs ont probablement raison d’identifier le méchant de Heyerdahl comme étant le Musée d’histoire naturelle. « Le vieil homme » avec lequel il a discuté là-bas était « aux cheveux blancs et de bonne humeur », une description qu’il est difficile d’attribuer à une personne en particulier dans un musée, mais selon l’auteur, les commentaires typiques de ce scientifique sur les théories de Heyerdahl étaient : « Non ! », « Jamais ! », « Vous avez tort, absolument tort... Cette réaction violente à l’hypothèse remarquable de Heyerdahl peut, après tout, être provoquée par presque n’importe quel anthropologue professionnel aujourd’hui, mais l’aventurier a alors son vénérable adversaire, qui avait écrit des livres que « à peine dix hommes avaient lus », pour lui exprimer l’opinion étonnante selon laquelle « la tâche de la science est l’investigation pure et simple… et non pas d’essayer de prouver ceci ou cela ». Il y a de nombreuses années, cela aurait pu être le regretté Franz Boas, anthropologue à l’Université de Columbia, qui disait souvent que nous devons collecter davantage de données avant de nous aventurer trop loin dans la théorie, mais Boas est mort bien avant que Heyerdahl ne reçoive le traitement glacial à New York et peu ou aucun de ses disciples ne partagent son extrême prudence.

Le mythe du déluge est représenté dans un ancien livre maya, le Codex Dresden. Les passionnés de Tribues Perdues pensent qu'il s'agit de la version amérindienne de l'histoire de l'Ancien Testament.


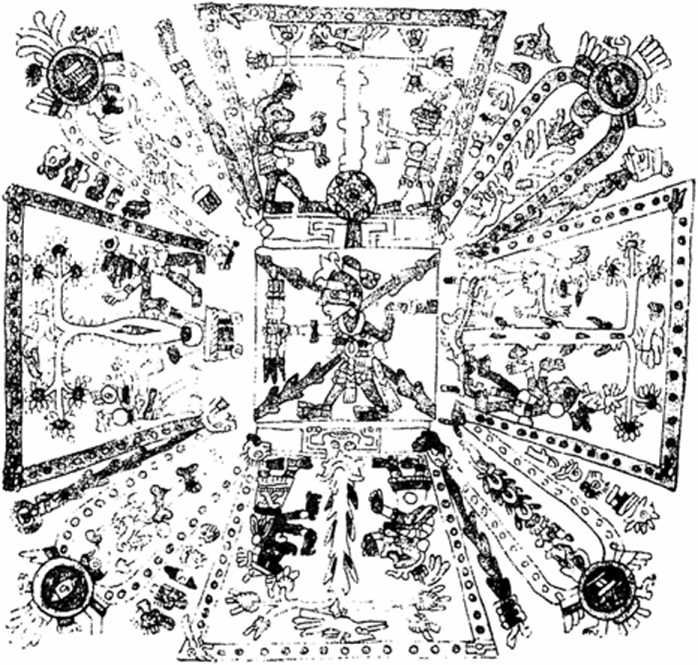
En haut à gauche : disque en pierre sculpté du sud-est du Mexique représentant un personnage barbu au profil de type sémitique. Les mormons affirment qu'il s'agit d'un Israélite. D'après P. Keleman.
En bas à gauche : le dieu mexicain Quetzalcoatl, que les mormons identifient au Christ, représenté dans le Codex Magliabecchiano.
Ci-dessus : arbres stylisés dans le Codex Fejérváry mexicain. Les premiers prêtres espagnols pensaient qu'ils représentaient la croix du Christ ; les mormons croient qu'ils représentent l'arbre de vie et les événements du Livre de Mormon.


Le sacrifice de l'Étoile du matin mexicain tel qu'il est décrit dans l'ancien Codex mexicain Nuttal (Zouche). Les mormons identifient le dieu mexicain, Quetzalcoatl, au Christ et considèrent la cérémonie de l'Étoile du matin comme une version du Nouveau Monde de la crucifixion.
TS Denisen, imprimeur de profession et philologue de profession, qui, après des années d’études assidues, décida que les langues indiennes mexicaines étaient d’origine indo-européenne, se plaignit dans la préface de son ouvrage de 1913 : « Je n’ai reçu aucune aide . Bien que j’aie demandé conseil à des philologues, ils ont été refusés pour diverses raisons. Un « linguiste » érudit, cependant, discutant de certains travaux préliminaires, s’est donné la peine de montrer que je devais être une personne très ignorante. Sa conclusion extraordinaire fut que « pas une seule » de mes dérivations ne résisterait à l’épreuve de l’analyse scientifique, ce qui était un peu pire que ce que je pouvais dire de ses critiques, car certaines d’entre elles se trouvaient être justes. Un autre philologue s’exprimant à titre semi-officiel a pris une décision plus courte, il a catégoriquement condamné sans avoir lu mon article ! » Il est probable qu’aucune auto-évaluation plus franche n’a jamais été faite involontairement dans un livre.
Harold S. Gladwin, un anthropologue amateur aisé, qui finançait ses propres fouilles, entretenait un musée en Arizona et publiait ses propres volumes sur ce que la plupart des professionnels considéraient comme des théories scandaleuses, se décrivait souvent dans son livre à succès, Men Out of Asia, comme un croisé essayant d’inculquer un peu de bon sens aux stupides docteurs en philosophie. « Toutes les lumières de la Maison des Grands Prêtres de l’Anthropologie Américaine sont éteintes », écrit-il, « toutes les portes et fenêtres sont fermées et solidement verrouillées (ils ne dorment pas les fenêtres ouvertes de peur qu’une idée nouvelle ne s’envole) ; nous avons sonné la cloche de la Raison, nous avons frappé à la porte avec la Logique, nous avons jeté le gravier des Preuves contre leurs fenêtres ; mais le seul signe de vie dans la maison est un ronflement occasionnel du Dogme. »
Gladwin connaissait bien la plupart des principaux anthropologues américains de sa génération, mais il prenait plaisir à les harceler dans son livre, qui était illustré de caricatures si révélatrices qu'elles laissaient peu de doute parmi les professionnels et les étudiants diplômés quant aux intellectuels qu'il choisissait de tourner en dérision.

Le Dr Phuddy Duddy et son public captif, un étudiant en camisole de force. Extrait de Men Out of Asia de Harold S. Gladwin.
Une note d’amertume se glisse cependant dans ses attaques habituellement légères contre le monde universitaire. « Si vous avez déjà visité un musée d’archéologie et discuté avec le conservateur, ou si vous avez déjà suivi un cours dans une branche quelconque de l’anthropologie dans l’une de nos universités », généralise-t-il avec insouciance, « vous aurez sans doute le sentiment d’avoir rencontré le Dr Duddy quelque part, un jour ou l’autre. [Le Dr Phuddy Duddy – pour son doctorat – était le faire-valoir de Gladwin dans Men. Out of Asia.] C’est le cas – puisque notre Phuddy Duddy n’est rien de moins qu’un composite de tous les grands esprits qui ont gouverné notre pensée anthropologique au cours des 70 dernières années. » Le Dr Duddy est toujours pompeux : « Cette intrusion d’amateurs dans des domaines spécialisés », lui fait-il claironner à un moment donné par Gladwin, « est une pratique qui ne peut être trop fortement condamnée et qui, à moins d’être rapidement réprimée, stimulera presque certainement des spéculations injustifiées… »
Il s’agissait là de bien plus qu’une simple réprimande professionnelle et bon enfant ; elle rappelle l’attitude qui avait poussé Auguste Le Plongeon, ingénieur, avocat, docteur en médecine autoproclamé et archéologue indépendant, à écrire, près de cinquante ans plus tôt :
Mais qui sont ces prétendues autorités ? Certainement pas les docteurs et les professeurs qui dirigent les universités et les collèges des États-Unis ; car non seulement ils ne savent absolument rien de la civilisation américaine ancienne, mais, à en juger par les lettres que je possède, la plupart d’entre eux refusent d’apprendre quoi que ce soit à ce sujet. . . . Les soi-disant savants de notre époque sont les premiers à s’opposer aux idées nouvelles et à ceux qui les portent. Cette opposition continuera d’exister jusqu’à ce que l’arrogance de l’amour-propre et de l’érudition superficielle qui plane encore entre les murs des collèges et des universités ait complètement disparu. . . .
Autant qu'on puisse le dire, Le Plongeon lui-même ne s'opposait à aucune idée nouvelle, quelle qu'elle soit ; comme nous l'avons vu, il était un fervent défenseur du continent perdu de l'Atlantide, des tribus perdues d'Israël en Amérique, des théories qui faisaient dériver la civilisation égyptienne des Mayas du Yucatan et qui ont envoyé des colons nord-africains, grecs et chinois dans l'hémisphère occidental à l'époque précolombienne.
Même les mormons, qui ont une attitude douce et dont le dogme officiel de l’Église est le seul à inclure les Indiens d’Amérique, se plaignent amèrement que le Livre de Mormon ait été injustement ignoré en tant qu’histoire authentique des civilisations aborigènes de l’Amérique ancienne, et que cela soit le résultat d’un entêtement délibéré de la part des scientifiques. « Cependant, aussi étrange que cela puisse paraître », écrivaient les mormons Milton R. Hunter et Thomas S. Ferguson en 1950, « cent vingt ans se sont écoulés depuis que le Livre de Mormon est sorti de presse, et il a été presque complètement ignoré par ceux qui devraient s’intéresser à ses affirmations parce qu’ils prétendent être des chercheurs de vérité. Je m’adresse ici aux archéologues et aux anthropologues, étudiants des antiquités américaines. »
A. Hyatt Verrill, qui croit que l'homme est arrivé en Amérique de diverses manières, certains d'Europe via le Groenland, d'autres à travers l'Atlantique, certains depuis l'Atlantide perdue ou l'Europe du Sud, certains par le détroit de Béring, et d'autres encore à travers le Pacifique, décrit un complot délibéré de la part des archéologues professionnels pour étouffer les informations qui contredisent leurs théories. Dans un livre de 1953 coécrit avec sa femme, il dépeint les scientifiques comme étant maintenant contraints à contrecœur d'admettre des preuves qu'ils avaient cachées pendant longtemps, par exemple l'existence de jouets à roues dans le Mexique préhistorique. L'absence de véhicules à roues chez les anciens Indiens et, comme on le pensait autrefois, le fait qu'ils n'aient jamais inventé la roue, ont longtemps été cités comme des preuves contre tout lien historique entre l'Ancien Monde et l'Amérique préhistorique. « Les archéologues du Mexique savaient depuis longtemps que les anciens Mexicains connaissaient et utilisaient la roue », accusèrent les Verrills, « et il y avait de nombreux spécimens de jouets à roues, etc., au Museo Nacional, mais pour une raison inconnue et mystérieuse, peut-être simplement pour soutenir leur déni de tout contact avec l’Ancien Monde, aucun scientifique nord-américain n’admettait publiquement et ouvertement l’existence de la roue à l’époque précolombienne. » « Cependant », ajoutèrent-ils, dans certains articles scientifiques jamais vus ou lus par le profane, il y avait, de temps à autre, de brèves références au fait que les roues étaient connues des premiers Américains... Une fois la vérité révélée, il était inutile de continuer à soutenir que les roues étaient inconnues dans l’Amérique ancienne et dans l’Histoire naturelle ... il y avait un article dans lequel cela était admis... Ayant finalement admis ouvertement que les anciens Américains connaissaient la roue, la conscience des « irréductibles » fut apaisée en déclarant que même si les premiers Américains connaissaient la roue, ils n’en faisaient aucun usage pratique ; ce n’était que supposition. . . . Une fois que ces archéologues opposés aux contacts avec l’Ancien Monde ont été forcés d’admettre la présence de la baleine dans l’Amérique ancienne, ils ont commencé à voir la lumière et à changer d’avis sur de nombreux points.
Il y a quelque chose de extrêmement amusant pour les professionnels dans cette image implicite d’anthropologues transmettant subrepticement des documents secrets à d’autres conspirateurs afin de protéger la terrible vérité des jouets à roues d’un public ayant subi un lavage de cerveau.
Harold S. Gladwin ne trouvait pas cela drôle. Lui aussi avait le sentiment que l'on faisait du sale boulot. Il commença par raconter comment cette absence de roue lui avait été rabâchée à contrecœur, à tout moment.
Et puis nous avons appris que des roues préhistoriques avaient été découvertes au Mexique dès 1887, et, pendant tout le temps où nous étions harcelés, les professeurs étaient au courant de leur existence mais ont décidé que les preuves pouvaient être ignorées car la référence était obscure et n'avait jamais été citée. Voilà la science pour vous, avec un grand S.
En 1887, un Français, Désiré de Charnay, creusait dans le sud du Mexique et découvrit plusieurs petits animaux en argile avec des protubérances semi-circulaires à la place des pattes, avec un trou dans chaque bosse, formant une sorte de palier. Quatre disques d'argile perforés accompagnaient chaque animal, et lorsque Charnay poussait des brindilles à travers les disques et les paliers, il avait de petits jouets à roues qui pouvaient être roulés d'avant en arrière sur une planche. Tout cela a été publié en 1887 dans son livre Ancient Cities of the New World, un livre rarement mentionné et plutôt rare, probablement en raison du fait que la plupart des exemplaires ont été ramenés et brûlés par le Dr Phuddy Duddy.
En 1940, Matthew Stirling, chef du Bureau d'ethnologie américain, fouillait à Tres Zapotes, à Vera Cruz, sur la côte est du Mexique. Il découvrit deux autres jouets en poterie à roues, mais dans ce cas, les axes traversaient des cylindres d'argile sur lesquels se tenaient les petits chiens en poterie (?). Ce n'est que lorsque nous avons vu ces jouets illustrés dans le National Geographic de septembre 1940 que nous avons appris toute la vérité et que nous avons pris conscience de l'ignoble tromperie qui avait été pratiquée à notre encontre.
Il y avait une différence entre cette version et celle des Verrills que nous venons de citer. Gladwin écrivait dans ce que l’on pourrait appeler un style jovial, si cela devenait nécessaire. Mais une tromperie inexistante n’a jamais fait l’objet d’un humour en soi ; Gladwin savait que malgré toute sa jovialité, le message était indubitable et qu’il serait compris.
Les vœux pieux des Verrills dans ce sens sont encore plus apparents dans les passages ultérieurs, où ils imaginent que le manuscrit de Mme Verrill, Gods Who Were Men, a révolutionné la pensée du monde scientifique. Ils citent une lettre du Dr Junius Bird du Museum of Natural History qui est censée montrer son « changement d’avis », mais qui est en fait une tentative très prudente de reconnaître poliment la réception d’un manuscrit pour lequel il n’avait manifestement aucun enthousiasme. « Gordon Ekholm et moi avons lu votre livre avec un intérêt et une appréciation considérables pour le temps et les efforts que vous y avez consacrés », peut-on lire dans la citation. « Franchement, aucun de nous n’est qualifié pour évaluer une grande partie de votre matériel comparatif, car il sort du cadre de notre expérience et provient de domaines dans lesquels nous n’avons aucune formation. , . . Beaucoup de vos comparaisons sont significatives. ... Avez-vous l’intention que nous conservions le volume dans nos archives ? Si c’est le cas, il sera disponible pour toute personne que vous pourrez envoyer pour le voir. » Les suppressions ci-dessus sont dues aux Verrills. Ils ont montré la lettre au Dr Rubin de la Borbolla, un anthropologue mexicain. « C’est merveilleux ! », aurait-il déclaré.
Dans un autre passage, les Verrills, dans leur évocation, racontent que le regretté archéologue de Yale, le Dr Wendell C. Bennett, a déclaré dans un rapport préliminaire sur les fouilles de Tiahuanaco en Amérique du Sud qu'il avait trouvé une meule en pierre.
« Plus tard, cependant, lorsque son rapport fut publié, toute référence à la roue fut omise. » Il est clair qu’il avait délibérément supprimé l’information. De nouveau, vers la fin de leur livre, le couple, qui se félicite lui-même, dit à propos du manuscrit de Mme Verrill qu’elle « s’attendait avec confiance à ce que l’ouvrage soit discrédité, tourné en dérision et mis de côté. Mais à sa grande satisfaction et à son étonnement, plusieurs archéologues et scientifiques de premier plan acceptèrent ses découvertes. Un exemplaire du volume fut présenté au Dr Earnest A. Hooton qui plaça l’ouvrage dans la bibliothèque de référence du musée Peabody… » En 1953, le Dr Hooton n’était plus en vie pour clarifier ce point, qui est sans équivoque destiné à donner l’impression qu’en acceptant le livre pour la bibliothèque de Harvard, il approuvait les vues de Verrill. Les universitaires professionnels, pour la plupart, ne sont tout simplement pas habitués à ce genre de jeu. Ils ne citent pas les lettres personnelles des uns et des autres dans leurs livres, ou ne citent pas d’opinions verbales sans au moins vérifier auprès de l’orateur.
Leo Wiener, professeur de slave à Harvard, qui publia à titre privé un énorme ouvrage richement illustré destiné à prouver que les langues et la culture maya et aztèque étaient toutes deux dérivées du mandingue africain, écrivit dans sa préface : « Il ne fait aucun doute que les chiens archéologiques continueront à aboyer après la lune et poursuivront les mêmes méthodes vociférantes que par le passé, afin de réprimer la recherche de la vérité par le bruit là où la raison échoue, oubliant que la vérité, où qu’elle soit, brillera sans une telle insistance vocale. » M. Wiener avait manifestement eu des relations décourageantes avec les archéologues américains. Il décrivit les « viles calomnies privées et publiques » dirigées contre lui-même ; il déclara que les américanistes étaient aveuglés par des préjugés ; il ridiculisait leur méthode du chat qui court après sa queue, leur logique d'Alice au pays des merveilles, et à un endroit il commentait ainsi le Dr Herbert J. Spinden du Brooklyn Museum et ses spéculations concernant le contenu thématique des inscriptions sur un célèbre autel maya du VIe siècle : « Comme Alice aurait apprécié cette histoire fantastique, surtout si Lewis Carroll avait ajouté : « Peut-être qu'elle représente les folies de 503 ou les folies de 1924. »
Les Le Plongeon ne pouvaient pas non plus croire que les anthropologues professionnels qui rejetaient leurs théories extravagantes étaient motivés par l’honnêteté intellectuelle. Le Plongeon publiait des textes aussi sulfureux que ses éditeurs le permettaient et se plaignait auprès de ses amis que trop de ses textes avaient été censurés. Mme Le Plongeon, l’ancienne Miss Dixon de Brooklyn, était apparemment une âme douce, intéressée par la musique et la poésie, et farouchement fidèle à son mari beaucoup plus âgé et plus grincheux. Lorsqu’ils revinrent aux États-Unis dans les années 1880 après leurs années de travail sur le terrain au Yucatan, ils s’installèrent dans une vieille demeure en granit et en brique sur Washington Street, à Brooklyn ; selon Willis Fletcher Johnson, qui leur rendit hommage dans The Outlook quarante ans plus tard, cette maison jouxtait les bâtiments d’origine du Brooklyn Institute, tous deux démolis plus tard pour faire place à la voie d’accès ferroviaire au pont de Brooklyn. Ils y conservèrent d’énormes réserves de reliques et de documents mayas et attendirent en vain une reconnaissance professionnelle qui ne vint jamais. Selon Johnson, ils furent amèrement déçus.
Les oreilles étaient sourdes, les yeux aveugles et les portes leur étaient fermées. Quelques rares savants américains reconnurent la valeur historique de leur travail et leur en accordèrent le mérite. La majorité se montra froidement indifférente ou ouvertement hostile. Tous les acteurs de cette tragédie misérable sont aujourd’hui morts et je ne rappellerai pas leurs noms. Mais certains des chefs de file et des mécènes les plus influents de la recherche archéologique et ethnologique américaine se sont apparemment employés à discréditer le Dr Le Plongeon et à empêcher que ses réalisations soient reconnues. Ils l’ont tourné en dérision et l’ont dénoncé comme un romancier et un faussaire, à égalité avec l’auteur du célèbre Géant de Cardiff, alors encore frais dans les mémoires. ... Ainsi, le Dr et Mme Le Plongeon n’eurent pas l’occasion d’être entendus par le public et leurs livres durent être publiés à leurs frais. Pourtant, aujourd’hui, toutes les révélations qu’ils firent alors et qui furent ridiculisées et rejetées sont entièrement vérifiées.
Les anthropologues professionnels n'ont jamais jugé nécessaire de répondre à ces accusations, car ils laissaient parler les absurdités de Le Plongeon : sa conviction que certains plis sur les monuments mayas indiquaient qu'ils disposaient du télégraphe électrique à l'époque préhistorique, que Jésus parlait le pur maya sur la croix, que la forme d'une statue couchée, le Chac Mool du Yucatan, symbolisait le contour de l'Amérique du Nord et du Sud, prouvant ainsi que les anciens Indiens connaissaient intimement la géographie de tout l'hémisphère. Le Plongeon n'était pas seulement inexpérimenté et sans formation dans l'analyse et l'interprétation des données anthropologiques, il était également totalement dépourvu de sens critique à l'égard de ses propres méthodes, ce qui est peut-être une autre expression de l'égoïsme dont il faisait preuve sans vergogne dans le récit de ses expériences réelles ou imaginaires. Après que Le Plongeon eut cru avoir convaincu les Indiens qu’il était un dieu maya réincarné, ils lui révélèrent, selon Johnson, « une grande partie de l’ancienne tradition des Mayas qui était cachée au peuple, y compris la signification de nombreux hiéroglyphes et de nombreux noms propres et autres mots de l’ancienne langue maya. Ils lui racontèrent également en détail l’histoire de la chute tragique de l’empire maya et la relation de la civilisation et de la mythologie mayas avec celles de l’Égypte et de l’Inde. »
Tout cela est un mensonge éhonté, que ce soit de la part de Johnson ou de Le Plongeon. Aucun Indien maya de 1883 n’avait la moindre idée de l’histoire, de la civilisation ou de la mythologie maya antique, et même aujourd’hui, peu d’entre eux, voire aucun, n’ont jamais entendu parler de l’Égypte et de l’Inde. De plus, ce passage illustre une autre tromperie favorite de Le Plongeon. Il a toujours prétendu pouvoir « lire » les inscriptions hiéroglyphiques mayas. Ce qu’il voulait dire en réalité, c’est que, comme tout le monde, il pouvait donner sa propre interprétation personnelle des scènes représentées sur des sculptures, des peintures murales et dans les codex. Mais il ne l’a jamais dit explicitement, et pour le non-expert, ses mots signifiaient qu’il pouvait lire l’écriture ancienne comme on pourrait lire les hiéroglyphes phonétiques égyptiens, grecs ou anglais. Quant à la signification des noms propres et autres mots mayas « cachés au peuple », elle n’est pas et n’a jamais été secrète ; elle était accessible à quiconque demandait ou écoutait, comme en témoignent de nombreux dictionnaires mayas du XVIe siècle.
L’antagonisme entre les professionnels et les amateurs s’étend également aux professionnels et aux véritables mystiques. Un membre de l’Ordre Rosicrucien, écrivant sur « Quand l’Amérique fut-elle colonisée ? » dans le Rosicrucian Digest en 1954, notait que les livres sur les continents perdus avaient été rejetés « avec un amusement condescendant » et que la science occulte, « qui seule pouvait interpréter les traditions indiennes de migration et de colonisation, était considérée comme une bizarrerie de quelques experts fanatiques ». Il se plaignait que lorsque les occultistes cherchaient des fonds pour des expéditions et des recherches, ils « étaient écartés comme des excentriques incapables de faire des recherches honnêtes et impartiales ». Un autre rosicrucien, Walter J. Albersheim, Sc.D., écrivant sur la science et le mysticisme en 1953, demandait : « Pourquoi l’amertume et le mépris, la haine personnelle que de nombreux scientifiques et aspirants scientifiques déversent sur tous ceux qui osent défendre l’effort mystique… ? » Albersheim pensait que la cause de cette « réticence à voir ou à écouter, de cette diffamation personnelle » était l’insécurité, et qu’elle se révélait dans l’amertume même de la haine. Mais la même question lui vint à l’esprit que moi-même : « Y a-t-il quelque chose dans le mysticisme qui puisse éveiller la suspicion et la peur chez les scientifiques ? »
La regrettée Mme HP Blavatsky, la plus vénérée des théosophes mystiques, écrivait dans sa célèbre Doctrine secrète : « C’est l’ignorance de nos hommes de science qui n’acceptent ni la tradition selon laquelle plusieurs continents ont déjà sombré, ni la loi périodique qui agit tout au long du cycle manvantarique – c’est cette ignorance qui est la principale cause de toute la confusion. » Ailleurs, elle exprimait à nouveau son mépris du scientifique orthodoxe : citant un théosophe sur ses croyances concernant les antiquités péruviennes, elle commentait qu’il était une « rareté parmi les hommes de science, un chercheur intrépide, qui accepte la vérité partout où il la trouve, et n’a pas peur de la dire face même à l’opposition dogmatique. ..
En plus de défier la critique professionnelle, les amateurs et les mystiques font souvent preuve d’une modestie paradoxale, voire d’une hésitation, lorsqu’ils présentent leurs croyances au public. Ils sont typiquement pessimistes. Peut-être l’hypothèse d’Albersheim sur l’insécurité pourrait-elle être envisagée pour ses compagnons de voyage. Le défenseur le plus lu de la théorie de l’Atlantide, Lewis Spence, s’était préparé au pire en 1925 : « Sans aucun doute, des préjugés et des préventions me tiendront en travers de mon chemin, et la valeur de mes prémisses sera niée par ceux qui ont une vision plus claire, tout comme d’autres peuvent, en vertu d’un don supérieur de dialectique, réussir à renverser ma thèse générale… » TS Denisen, un philologue amateur, a prophétisé : « Je serai sans aucun doute accusé d’avoir témérairement suggéré une dérivation audacieuse là où de plus grands érudits ont été prudents… Là où d’autres se sont retenus, je suis entré hardiment, non par témérité et présomption, mais par nécessité. Celui qui veut naviguer dans des eaux inconnues doit prendre des risques.
Samuel G. Drake, lui aussi, écrivait vers 1840, qu’il s’attendait à être ridiculisé par les critiques : « Avant de savoir que si nous étions dans l’erreur, c’était en compagnie de philosophes tels que ceux que nous avons présentés à nos lecteurs dans ce chapitre, nous avons éprouvé une certaine hésitation à exprimer notre opinion sur un sujet d’une telle importance. Mais, après tout, comme il ne s’agit que d’une opinion honnête, personne ne devrait être intolérant, même s’il peut être autorisé à se réjouir lui-même et même ses amis à nos dépens. » Et Mme Hyatt Verrill, un peu plus d’un siècle plus tard, « s’attendait avec confiance à ce que son travail soit discrédité, tourné en dérision et mis de côté. »
On ne peut s’empêcher de voir une certaine régularité dans ces attitudes. Le défenseur typique des théories « sauvages » des origines amérindiennes commence son livre par l’image de l’opprimé ; il souligne qu’il a été personnellement méprisé, ridiculisé ou au mieux snobé par les professionnels. Puis il prédit que ses écrits seront à leur tour mal reçus ou ignorés, et il s’attaque à la bigoterie obstinée des hommes dans les universités et les musées. Il sous-entend fréquemment qu’ils sont non seulement désespérément conservateurs et jaloux de toute percée scientifique des amateurs, mais aussi qu’ils sont en fait malhonnêtes et que lorsqu’ils sont confrontés à des preuves contradictoires, ils les suppriment ou, si nécessaire, les détruisent. Pourtant, tout en accusant les professionnels d’ignorance, d’incompétence et de manque d’éthique, les pseudo-scientifiques sont presque invariablement fiers de toute approbation réelle ou (plus souvent) imaginaire qu’ils obtiennent de ces Phuddy Duddies égarés. Les Verrill se sont vantés sans vergogne de commentaires professionnels qu’ils ont interprétés à tort comme favorables à leurs écrits ; Et de toutes les personnes au monde, à qui Gladwin a-t-il demandé d'écrire la préface et de donner ainsi un peu de prestige à son livre qui avait consacré chaque page à ridiculiser le professeur d'université et conservateur de musée ? Nul autre que le docteur Earnest Albert Hooton, professeur d'anthropologie et conservateur d'anthropologie physique au musée Peabody de l'université Harvard !
Un autre type de comportement paradoxal de la part des mystiques est leur fier aveu d'un côté qu'ils ne sont pas liés par les règles de recherche empirique des scientifiques et qu'ils sont tout à fait disposés à utiliser l'intuition ou des preuves dérivées du surnaturel dans leur « recherche », tout en protestant continuellement qu'ils sont aussi scientifiques que n'importe qui d'autre dans leurs méthodes.
Les amateurs détesteront toujours les Phuddy Duddies, et les professionnels mépriseront toujours les Crackpots.
La théorie de l'origine des Indiens d'Amérique, défendue aujourd'hui par la plupart des anthropologues professionnels, dont Le Plongeon, Gladwin, Heyerdahl, les rosicruciens et les théosophes ont écrit avec tant d'indignation, ne paraît pas du tout déraisonnable à ses défenseurs. De temps à autre, au cours de l'histoire géologique, l'étroite étendue de ce qui est aujourd'hui de l'eau entre l'extrémité nord-est du continent eurasien et le point le plus occidental de l'Alaska a été soit un pont terrestre, soit une bande gelée que les animaux de la plupart des espèces pouvaient traverser sans danger. Entre les grandes glaciations, cette région autour du détroit de Béring était beaucoup plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui, probablement couverte, selon l'ouvrage de Richard Foster Flint intitulé Glacial and Pleistocene Geology, d'herbes longues et épaisses, fourrage idéal pour les éléphants et autres herbivores. À un moment ou à un autre, des ours, des mammouths, des rennes, des bisons, des chameaux et d'autres animaux y ont vécu en troupeau. Ce trafic, explique Flint, se faisait principalement vers l'est, mais une partie, notamment celle des chameaux, se faisait vers l'ouest et, à l'époque du Pléistocène, il était limité aux animaux des habitats froids ou boréaux.
Même un homme primitif de l’âge de pierre, une fois qu’il aurait suffisamment maîtrisé l’environnement du nord de la Sibérie pour errer jusqu’à la péninsule du Kamtchatka, aurait sûrement pu traverser et, selon les anthropologues, il l’a certainement fait, ce qu’ils démontrent par la distribution géographique continue d’une longue liste d’artefacts archéologiques fonctionnellement ou historiquement liés et d’objets et de coutumes ultérieurs qui s’étendent à travers l’Europe du Nord et l’Asie et jusqu’en Amérique – des choses comme l’arc à dos de tendon, l’armure à lattes, les raquettes, le toboggan, les bateaux d’écorce, les plats et pots d’écorce, les chapeaux de vannerie, le tipi ou la tente conique de peau et d’écorce, la divination par l’examen de l’omoplate, les cérémonies centrées sur l’ours, l’histoire du « vol magique » et des types de poterie spécifiques comme la poterie marquée par des cordons qui s’étendait profondément dans le sud-est des États-Unis à l’époque préhistorique.
Français Au vu de ce que les anthropologues considèrent comme un flux culturel démontrable de l'Asie vers l'Amérique via le détroit de Béring, qui ne mesure aujourd'hui qu'une cinquantaine de kilomètres de large, avec plusieurs sauts d'île en île pour briser les étendues de mer ouverte - on peut le voir de l'autre côté presque tous les jours - et au vu de la grande diversité des types physiques ou des sous-races amérindiennes qui ont été fouillés sous forme de squelettes ou qui survivent sous forme de vestiges parmi les populations aborigènes actuelles, la théorie anthropologique la plus largement acceptée est que l'Amérique a été peuplée sur une longue période, commençant il y a au moins vingt-cinq mille ans et peut-être plus, par vagues successives par de nombreux groupes différents de chasseurs nomades, différentes branches de populations asiatiques fondamentalement mongoloïdes.1 Bien que des migrations rapides aient sans doute été possibles, cette expansion s'est probablement faite lentement, car les chasseurs nomades ou semi-nomades ne se déplacent généralement de leur territoire familier que lorsqu'ils y sont contraints par la rareté ou la migration du gibier dont ils se nourrissent, ou par la pression d'autres groupes qui les suivent, ou par la nécessité économique de diviser des populations croissantes de ce type, les groupes se séparant à la recherche de nouveaux territoires de chasse. Les changements climatiques ou d'autres conditions d'habitat peuvent également provoquer des déplacements, mais ceux-ci se produisent généralement si lentement qu'ils deviennent presque imperceptibles au fil des siècles.
1 Il existe encore une grande diversité d'opinions sur la date de l'arrivée de l'homme en Amérique. Le Dr George F. Carter, géographe, soutient que l'homme a atteint la région de San Diego, en Californie, il y a 100 000 ans. Le Dr James B. Griffin, archéologue, tout en admettant qu'un certain nombre de découvertes soutiennent l'idée que l'homme aurait pu être présent dans le Nouveau Monde il y a 20 000 à 30 000 ans, ne pense pas qu'aucune d'entre elles ne démontre clairement que cela se soit produit avant 10 000 à 12 000 ans avant J.-C.
John Josselyn a beaucoup voyagé en Nouvelle-Angleterre à partir de 1638 et, trente-quatre ans plus tard, il a publié deux ouvrages, New England Rarities (1672) et (en 1673), un récit de ses deux voyages au Nouveau Monde. Dans le premier, il déclare : « Les habitants du nord-est de l’Amérique, c’est-à-dire du nord de l’Angleterre, etc., sont considérés comme des Tartares, appelés Samoades, ayant le même teint, la même silhouette, les mêmes habitudes et les mêmes manières. » Dans le second ouvrage, il écrit : « Les Mohawks sont environ 500 ; leur langue est un dialecte des Tartares (comme l’est aussi la langue turque). » Cotton Mather, peu de temps après, au cours du même siècle, déclara dans son Magnalia Christi Americana que Jules César, lorsqu’il disait des Scythes nomades et féroces de la mer Noire qu’il « est plus difficile de les trouver que de les déjouer », faisait en réalité également référence aux Indiens d’Amérique. Pierre de Charlevoix, qui visita l'Amérique du Nord en 1720, cite Solin et Pline, ainsi que le Vénitien Marco Polo, selon lesquels les Scythes se livrèrent à de vastes migrations, abandonnant de vastes régions et se déplaçant vers des pays inhabités, atteignant probablement à un moment donné l'Amérique elle-même.
La théorie du détroit de Béring remonte évidemment à une époque plus ancienne que celle de Josselyn, car elle fut attaquée dès 1637 au moins, lorsque Thomas Morton, dans son histoire naturelle de la Nouvelle-Angleterre, protesta contre le fait que les motivations pour traverser ce qu'il supposait être alors une terre gelée sans aucune forme solide en vue n'étaient pas suffisantes. Aujourd'hui, les partisans du Continent perdu se demandent quelle est la différence entre leurs théories et cette vision anthropologique professionnelle, car les deux proposent la submersion sous l'océan d'une masse terrestre, occupée par des êtres humains dans un cas, traversée par eux dans un autre. Ils se demandent pourquoi les professionnels rejettent si unanimement l'idée d'un continent englouti mais sont tout à fait disposés à émettre l'hypothèse d'un ancien pont terrestre reliant la Sibérie à l'Alaska. Pour obtenir des réponses, les anthropologues vous renvoient à leurs collègues géologues, et les océanographes, qui ont cartographié presque chaque mètre carré du fond marin entre ces deux extrémités les plus septentrionales des hémisphères, peuvent vous dire presque exactement à quoi ressemblait le terrain lorsqu'il était au-dessus de l'eau, et se risqueront à des suppositions raisonnées sur la période géologique et le nombre d'années écoulées depuis la submersion. La seule question semble être de savoir si le pont terrestre a été causé par un abaissement du niveau de la mer ou par une déformation de la croûte terrestre, le mouvement réel de la surface de la terre lorsque son substrat relativement fragile a cédé sous le poids énorme d'une grande calotte glaciaire, puis s'est ajusté vers le haut lorsque le glacier a reculé.
Le pont terrestre de l'isthme de Béring était large, un terrain légèrement vallonné avec des lacs de taille considérable et un certain nombre de petites rivières. Le Yukon, par exemple, se jetait dans la mer inférieure par l'un de ces anciens chenaux, aujourd'hui à environ trente brasses sous l'océan. Lorsque ce terrain fut exposé, il retenait l'océan Arctique et permettait ainsi aux courants plus chauds du Pacifique de tempérer le climat du côté sud de l'isthme. Le niveau de la mer étant trente brasses plus bas qu'aujourd'hui, l'océan Arctique se trouverait à plus de trois cents milles au nord du détroit de Béring. D’après son étude des cartes sous-marines, le Dr Douglas S. Byers, de la Robert S. Peabody Foundation à Andover, dans le Massachusetts, nous apprend que ce qui est aujourd’hui le chemin le plus court, entre le cap Deshneva et le cap Prince de Galles, séparés par seulement vingt milles nautiques d’eau libre, n’était pas la plus ancienne voie de circulation piétonnière, mais qu’au contraire, une route allant du cap Chaplina au nord de l’île Saint-Laurent vers Norton Sound, traversant aujourd’hui environ cent dix milles de mer libre, était le passage terrestre le plus favorable aux envahisseurs de l’âge de pierre des Amériques. Mais si on les interroge sur les anciennes masses terrestres des océans Atlantique ou Pacifique, les géologues et les océanographes deviennent beaucoup plus vagues dans leurs détails et commencent à parler de millions, et non de milliers, d’années, bien avant l’apparition de l’homme sur terre.
Les anthropologues professionnels pensent également que, pour la plupart, les civilisations les plus avancées des Amériques – les Mayas, les Mexicains pré-Aztèques, les Pueblos et les Andins pré-Incas – se sont développées indépendamment des influences de l’Ancien Monde, et même dans une large mesure indépendamment les unes des autres. Les non-professionnels se montrent alors angoissés et désapprobateurs et désignent des objets, des coutumes, des légendes et des croyances ou pratiques religieuses similaires, voire identiques, que l’on retrouve dans l’Ancien et le Nouveau Monde ; ils estiment que ces choses parlent d’elles-mêmes et ils considèrent les explications techniques des professionnels, formulées en termes d’« inventions parallèles en réponse à des configurations de stimuli similaires », comme une façon de se sortir d’une situation difficile camouflée dans du jargon.
Des centaines de milliers de mots, sincères, passionnés et souvent furieux, ont été prononcés dans ce débat classique. Parmi l’immense corpus de preuves citées par les professionnels pour défendre leur position, en voici un échantillon : l’agriculture. Les civilisations avancées, comme celles de l’Égypte ancienne, de la Mésopotamie, de la Perse et de la vallée de l’Indus, ne peuvent se développer sans une certaine production alimentaire efficace, dans la plupart des cas la culture de cultures vivrières, généralement des céréales stockables qui peuvent être conservées en quantités excédentaires, ce qui permet aux spécialistes non agricoles de se consacrer à d’autres activités et de consacrer du temps libre. Il en était de même pour les cultures avancées de l’Amérique ancienne, mais l’inventaire des cultures y était très différent de celui de l’Asie précolombienne, de l’Afrique ou de l’Europe. Il n’y avait, par exemple, dans le Nouveau Monde, ni riz, ni blé, ni millet, ni orge, ni lin, ni seigle, ni avoine, ni aucune des techniques de culture de l’Ancien Monde — ni charrue, ni bœufs domestiques pour la tirer, ni même de véhicules à roues, ni aucun de ces animaux domestiques si étroitement associés aux civilisations agricoles à l’étranger : ni chevaux, ni cochons, ni moutons, ni poulets, ni buffles d’eau, ni bétail d’aucune sorte.
Seul le chien était commun aux deux hémisphères, ainsi que quelques plantes domestiquées : patates douces, courges, coton et noix de coco. En Amérique, il n'y avait aucun des arbres fruitiers de l'Ancien Monde — comme le pommier, le pêcher, le poirier, le bananier — et dans l'hémisphère oriental, pas de dinde américaine, de lama ou d'alpaga péruvien, ni de tabac indien, bien que la plupart de ces derniers prospèrent une fois transplantés sur les autres continents. Nous oublions aujourd'hui ces anciennes distributions, alors que le tabac turc est aussi bien connu que les bananes d'Amérique centrale, les pêches de Géorgie et les pommes de Washington. Le Dr Alfred L. Kroeber ajoute les éléments suivants de l'Ancien Monde qui n'avaient pas fait leur chemin vers les Amériques en 1492 : les proverbes, la divination par examen des viscères, le fer, la roue — sauf ici par invention indépendante comme jouet et pour les figures rituelles — les instruments de musique à cordes à l'exception de l'archet monotone, les serments et les ordalies. Il pense que les éléments suivants ont été inventés indépendamment dans chaque hémisphère : le concept et l'utilisation du zéro en mathématiques, le symbole de l'oiseau à deux têtes (à l'exception de l'aigle des Habsbourg postcolombiens apporté au Mexique par Maximilien), l'arc en encorbellement de pierres superposées (contrairement à l'arc véritable avec sa voûte à clef autoportante), l'utilisation de cinq jours supplémentaires dans le calendrier de l'année, une séquence zodiacale, le comptage du temps permutatif, la dépendance au jeu, les substances intoxicantes, la fermentation déclenchée par la salive, la demi-clef et l'enroulement à une seule tige en vannerie, et dans les textiles l'utilisation des métiers à tisser et la teinture par nouage, les poix de Pan, le bronze et d'autres métallurgies. On peut imaginer le vocabulaire nécessaire pour débattre de chaque élément de cette imposante liste.
Il existe également une longue liste de traits culturels parallèles de chaque côté du Pacifique, dont on doute encore de leur invention indépendante ou de leur parenté. Un jeu de patolli-parcheesi presque identique était pratiqué dans les deux hémisphères, et dans l’art, l’architecture et la religion, ainsi que dans certaines techniques matérielles, des similitudes étonnantes conduisent de nombreux anthropologues à admettre des traversées sporadiques, peut-être accidentelles, du Pacifique depuis l’Asie du Sud-Est, qui ont pu apporter des concepts religieux isolés, des motifs artistiques ou même des objets. Mais la plupart des chercheurs ne pensent pas que ces éléments aient eu une importance culturelle ou raciale durable.
En 1827, John Ranking, dans Historical Researches on the Conquest of Peru, Mexico, etc., a avancé que l'empire inca d'Amérique du Sud avait été fondé par les équipages de quelques navires de Kubilai Khan poussés vers l'est à travers le Pacifique après avoir échappé à la tempête qui avait détruit la majeure partie de la flotte que l'empereur mongol avait envoyée contre le Japon au XIIIe siècle. Hubert Howe Bancroft, qui avait tendance à critiquer avec une courtoisie dévastatrice, écrivait en 1886 :
Dans cette théorie, comme dans toutes les autres, on ne fait guère de distinction entre l’introduction d’une culture étrangère et l’origine réelle du peuple. Il serait absurde, cependant, de supposer que quelques équipages de navires, presque, sinon tout à fait, sans femmes, jetés par hasard sur le rivage du Pérou au XIIIe siècle, se soient transformés au XVe en une nation puissante, possédant une civilisation très avancée, mais ressemblant si peu à celle de leur mère patrie qu’elle n’offre que des analogies très faibles et très tirées par les cheveux. ... Il est ridicule de supposer qu’un père mongol ait transmis à ses enfants la connaissance des arts et des coutumes de l’Asie, sans graver dans leur esprit l’histoire de son naufrage et l’histoire de son pays natal, sur lesquelles tous les Mongols sont si précis.
Une hypothèse quelque peu similaire a été avancée par Harold S. Gladwin dans son ouvrage Men Out of Asia en 1947. Gladwin a suggéré qu'après la mort d'Alexandre le Grand en 323 av. J.-C., certains survivants de sa flotte naufragée sous le commandement de l'amiral Néarque ont navigué vers l'est, en recrutant des artisans en Inde et en Asie du Sud-Est, et ont fait un voyage épique à travers le Pacifique, où eux et leurs descendants ont été à l'origine des hautes civilisations précolombiennes de la région maya et des Andes péruviennes. Dans une critique de ce livre pour American Antiquity, le Dr Samuel Kirkland Lothrop a admis que les grandes trirèmes, quadrirèmes et quinquérèmes de la flotte d'Alexandre, avec des équipages de cinq et six cents hommes, étaient en effet assez puissantes pour traverser le Pacifique, mais pas à la voile sous les tropiques contre les vents et les courants dominants comme le montrent les cartes météorologiques d'aujourd'hui. De plus, ils n’auraient pas eu la boussole qui a permis aux explorateurs des XVe et XVIe siècles de maintenir le cap sans l’aide du soleil ou des étoiles, et « leur a également permis de faire demi-tour et de rentrer chez eux ».
Mais admettons, pour les besoins de la discussion, que des bateaux entiers d’Asiatiques de toutes sortes aient atteint l’Amérique du Sud avec leurs compétences techniques, pourquoi n’ont-ils laissé aucune trace dans les îles qui les ont traversés ? Comment ont-ils développé l’agriculture tempérée et tropicale dans le Nouveau Monde ? Pourquoi ont-ils donné à une tribu un gratte-dos, à une autre un tube à boire, à une troisième une maison sur pilotis ? Pourquoi ont-ils donné aux Péruviens un système décimal et aux Mayas un système vigésimal de numération ? Et pourquoi les langues de ces régions n’ont-elles aucun lien entre elles ? Plus important encore, a déclaré le Dr Lothrop, Gladwin a ignoré les communautés agricoles florissantes qui existaient sans poterie ni métal mille ans ou plus avant Néarque.
En 1836, J. MacKintosh, qui avait si vigoureusement attaqué la théorie israélite des origines des Indiens d’Amérique, affirmait avec enthousiasme que ces derniers étaient originaires de Corée. MacKintosh affirmait que lorsque les puissants Kitans vainquirent les Coréens sous la dynastie Tsin, ils tyrannisèrent tellement leurs victimes que ces dernières entreprirent un voyage pour établir une colonie dans un pays lointain. Pendant neuf semaines, ils naviguèrent vers le nord-est, traversèrent plusieurs îles, « et arrivèrent dans un pays dont ils ne purent découvrir les frontières. Santini suppose très raisonnablement que ce pays est l’Amérique. Cette information… tend à prouver au-delà de tout doute possible que les Coréens furent les premiers à visiter le Nouveau Monde depuis l’Asie ».
De toutes ces théories asiatiques, celle qui a retenu le plus l'attention dans les congrès scientifiques du siècle dernier fut celle qui identifiait un pays appelé Fu-Sang dans les annales chinoises anciennes avec le Mexique préhistorique. Un Français, De Guines, semble avoir été, en 1761, le premier à publier son opinion selon laquelle, au cinquième siècle de notre ère, des bouddhistes furent envoyés de Chine pour établir leur religion dans le Nouveau Monde, qu'ils appelèrent Fu-Sang. Il aurait tiré cette hypothèse d'une fable chinoise rapportée par l'historien du septième siècle Li Yen, qui, selon Channing Arnold et Frederick J.
Tabor Frost tenait cette histoire d’un prêtre bouddhiste, Hwui Shan, qui disait être venu de ce pays inconnu, à 40 000 li de la Chine. Comme un li chinois équivaut à environ un tiers de mille, cela placerait Fu-Sang au moins aussi loin que les Amériques, mais HJ von Klaproth, qui a enquêté sur cette histoire de manière très approfondie en 1831, a tenté de démontrer que Fu-Sang était en fait la côte sud-est du Japon, et que la distance de 40 000 li, en plus d’être de mesure très variable, pouvait difficilement être estimée avec précision par un prêtre bouddhiste, et de plus, elle était probablement comparable, selon un autre enquêteur, E. Morse, aux « mûriers de plusieurs milliers de pieds de haut et aux vers à soie de 7 pieds de long qui font partie de son conte de fées ». Arnold et Frost soulignent en outre que les tuiles vernissées, si courantes en Chine à partir de 2000 av. J.-C., étaient entièrement absentes de l’ancienne Amérique centrale, tout comme le tour de potier et la charrue.
En 1844, un autre Français, M. de Paravey, renouvela l'hypothèse de De Guines, et un an plus tard, Friederich de Neuman, professeur de langues orientales à l'université de Munich — selon certaines sources, Neumann de Monaco — la soutint également. Le baron de Humboldt trouva également dans les demeures lunaires hindoues des signes du zodiaque qui lui rappelèrent l'ancien calendrier mexicain, et il conclut à une origine commune de l'astrologie asiatique et mexicaine. Dès 1866, l'architecte français Viollet-le-Duc nota des ressemblances frappantes entre les anciennes constructions mexicaines et celles du sud de l'Inde. Tous ces chercheurs furent impressionnés par la similitude de la trinité Brahma-Siva-Vishnu d'une part, et de la trinité mexicaine Ho-Huitzilopochtli-Tlaloc d'autre part, par les ressemblances dans les attributs de certaines divinités hindoues et ceux du panthéon maya, par les ressemblances entre les pagodes de l'Inde et les temples pyramidaux de Méso-Amérique. Étendant leurs comparaisons vers le sud, jusqu'au Pérou, ils y remarquèrent des dieux analogues comme Pachacamac et Viracocha, et les prétendues Vierges du Soleil semblaient être les pendants des servantes des divinités d'Extrême-Orient. Certains enthousiastes, selon Rivero et Tschudi en 1853, considéraient Fo en Chine, Bouddha au Japon, Sommono-Cadom en Inde, le lamaïsme au Tibet, la doctrine de Dschakdschiamuni chez les Mongols et les Calmuks, ainsi que le culte de Quetzalcoatl au Mexique et de Mango-Capac au Pérou comme autant de branches d'un même tronc. Rivero et Tschudi eux-mêmes soutenaient que Quetzalcoatl et Mango-Capac étaient tous deux des missionnaires du culte de Brahma ou de Bouddha, et probablement de sectes différentes.
Dès lors et jusqu'à la fin du siècle, une longue série de savants, pour la plupart français, soutenaient en tout ou en partie l'idée générale selon laquelle la civilisation amérindienne dérivait ou était au moins influencée par la culture chinoise ou asiatique-bouddhique. En 1874, Lucien Adam racontait que Matthew Fontaine Maury, célèbre géographe du XIXe siècle et commandant de la marine confédérée, lui avait assuré que les marins chinois n'auraient eu aucune difficulté sérieuse à découvrir l'Amérique. On pouvait aller de la Chine à l'Alaska en passant par le Japon, les Kouriles, la côte du Kamtchatka et les Aléoutiennes sans perdre de vue la terre plus de quelques heures.
Il ne faut pas laisser de côté une théorie de ce genre sans faire référence à Auguste Le Plongeon, que nous avons si souvent cité, car le bon docteur a jeté son dévolu sur à peu près toutes les hypothèses possibles que lui ou n’importe qui d’autre pouvait formuler sur l’Amérique préhistorique : l’Atlantide, les tribus perdues, la reine Moo et les Égyptiens, les Phéniciens et les Grecs du Nouveau Monde. Il n’est guère probable qu’il ait refusé cette distinction aux Chinois. Décrivant quelques figures péruviennes qui lui semblaient chinoises, il les montra à « un Chinois érudit ». Selon Le Plongeon, les traits du Chinois exprimaient avec vivacité les différentes émotions qui hantaient son esprit : « curiosité, surprise, crainte, crainte superstitieuse… Après beaucoup de bruit et de cajoleries, il me dit enfin, d’une voix pleine de révérence comme le ferait un brahmane en prononçant le mot sacré OA-UM, que la signification de l’inscription était Fo. » Apparemment, il n'est pas venu à l'idée de Le Plongeon que le monologue du géant dans Jack et le haricot magique pourrait être une approximation encore plus proche de ces mots effrayants.
L’étude la plus approfondie des contacts transpacifiques précolombiens est celle de deux auteurs anglais de The American Egypt, Channing Arnold et Frederick J. Tabor Frost, et de deux anthropologues modernes, le Dr Gordon F. Ekhohn et le Dr Robert Heine-Geldern du Museum of Natural History. Dans plusieurs publications individuelles et collectives, ces chercheurs ont rassemblé un nombre étonnant de parallèles entre les cultures du Nouveau Monde et celles de l’Inde ancienne, de la Chine et de la Mésopotamie. Le Dr Ekholm suggère que les influences asiatiques au Mexique pourraient se concentrer sur la frontière occidentale de la région maya dans les États actuels du Chiapas, de Tabasco ou de Campeche, et qu’elles se trouvent plus fortes dans les motifs et styles d’influence mexicaine tardive de Chichen Itza, du Yucatan et de la ville contemporaine de Tula au centre du Mexique, vers 1200 après J.-C. Ce complexe d’influences asiatiques pourrait avoir atteint l’Amérique vers 700 après J.-C.
Le Dr Ekholm ne soutient pas qu’un seul de ces parallèles culturels entre l’Asie et l’Amérique soit concluant en soi, mais il estime que certains sont importants et que, pris ensemble, ils tendent tous à se renforcer mutuellement, car ils se produisent dans des contextes contemporains ou autrement liés. La liste des traits presque identiques ou très similaires, discutée en détail par Arnold et Frost en 1905 et plus tard par Ekholm et Heine-Geldern, comprend le « serpent de feu » et le monstre marin mythique, les figures atlantes, les dieux ou les figures cérémonielles debout sur des humains accroupis, les arbres stylisés ou célestes avec des visages démoniaques dans leurs branches, les escaliers flanqués de balustrades en forme de serpent, les demi-colonnes architecturales, les colonnettes, les arcs en trèfle, les galeries voûtées, les panneaux sculptés représentant des figures groupées autour de personnages sur des trônes bas, les postures spécifiques de personnages intronisés, les trônes de tigre, les trônes de lotus, les bâtons de lotus, les cultes phalliques, les lions ou les tigres assis, les disques solaires et les dieux plongeurs.
Ekholm et Heine-Geldern citent comme exemple remarquable de la proximité des ressemblances entre l’Asie et la Méso-Amérique les motifs de lotus hindous-bouddhistes et mayas. Dans les deux cas, on retrouve la coutume inhabituelle de représenter la tige ou le rhizome, qui dans la vraie plante pousse horizontalement sous l’eau ou profondément enfoui dans la boue, au lieu des fleurs ou des feuilles elles-mêmes, qui s’élèvent au-dessus de la surface sur leurs propres tiges. Dans les deux cas, le lotus est souvent utilisé comme une « sorte de paysage imaginaire animé par des figures humaines », ces dernières étant souvent représentées en position allongée tenant le rhizome.
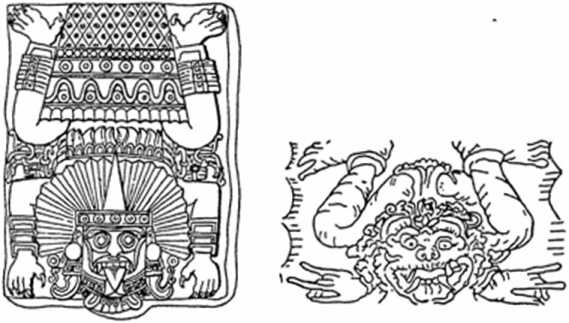
Dieux plongeurs. À gauche : sculpture de Veracruz, au Mexique. D'après GF Ekholm, illustrée par J. Imbelloni. À droite : manuscrit balinais.
En Inde, le rhizome émerge de la bouche de monstres marins aux corps semblables à ceux des poissons aux deux extrémités de la plante de lotus ; au Yucatan, des poissons stylisés occupent ces mêmes positions. Et dans les deux cas, les panneaux de lotus servent de bordures à des parties plus grandes et plus importantes des sculptures en relief.
Heine-Geldern et Ekholm ne croient pas que ces correspondances puissent être dues à de simples contacts accidentels, comme ceux qui auraient pu résulter de navires poussés à travers le Pacifique par des tempêtes et des courants océaniques. Ils sont convaincus qu’une sorte de trafic à double sens entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique a dû avoir lieu grâce à des navires capables de transporter des marins et des marchands, « dont on ne pouvait s’attendre à ce qu’ils soient ni des architectes, ni des sculpteurs accomplis, ni des experts en cosmologie et dans des domaines similaires ». Il ne fait aucun doute que les navires et la navigation étaient suffisamment avancés pour les traversées océaniques à cette époque. Les auteurs citent plusieurs exemples de navires du IIe au IVe siècle capables d’effectuer le voyage. Vers 400 après J.-C., un bouddhiste chinois revint d’Inde, traversant directement l’océan de Ceylan à Java, à bord d’un navire transportant plus de deux cents marins et marchands, un navire beaucoup plus grand que les navires de Colomb et des premiers explorateurs espagnols.
Arnold et Frost suggèrent l’itinéraire le plus probable qui aurait pu amener les premiers bouddhistes en Amérique.
Ils suivirent le cours du courant jusqu'en Amérique et furent jetés sur la côte où il frappa avec la plus grande force. Le contre-courant du Pacifique se divise en deux branches à l'approche de la côte à environ 10 degrés de latitude nord, une partie allant vers le sud et l'autre vers le nord. S'ils empruntaient la branche sud, ils entreraient en contact avec le courant équatorial venant du Pérou et seraient inévitablement emportés vers la mer. Par contre, s'ils empruntaient la branche nord, ils seraient emportés sur quelques milles le long de la côte jusqu'à environ 13 degrés de latitude, où le courant se rapproche et où ils trouveraient l'endroit le plus probable pour débarquer.
Arnold et Frost ont avancé quelques hypothèses intéressantes sur les raisons qui ont pu pousser les mouvements bouddhistes à se diriger vers l’Amérique. Ils soulignent que la persécution des bouddhistes au cours des IVe et Ve siècles a conduit ces derniers à être chassés de l’Inde, vers la Birmanie et la Chine, où le bouddhisme a été reconnu comme la troisième religion de l’Empire dès l’an 65. De Birmanie et de la péninsule malaise, la religion s’est propagée dans l’archipel indien ; un temple à Boro Budor à Java a été construit entre 600 et 700. Mais là encore, en Birmanie, les bouddhistes ont été impliqués dans des troubles, peut-être dans le cadre de tensions raciales ou ethniques généralisées dans toute cette région, et Arnold et Frost suggèrent qu’un groupe de bouddhistes a probablement entrepris un voyage vers le VIIIe siècle à la recherche d’un nouveau foyer. Il se pourrait, disent les auteurs, qu’il s’agisse de Khmers ou de quelques Orientaux professant le bouddhisme.
Les travaux archéologiques d'Emilio Estrada, Betty J. Meggers et Clifford Evans en Équateur ont révélé des preuves solides de contacts beaucoup plus anciens entre l'Amérique du Sud et l'Asie de l'Est. Les fouilles de Valdivia sur la côte équatorienne ont livré des poteries fabriquées par un peuple de cueilleurs de coquillages entre 2000 et 3000 av. J.-C. Ces céramiques partagent un certain nombre de caractéristiques distinctives avec la poterie de la période Jomon moyenne à tardive du Japon, qui remonte à la même période de la préhistoire. Il n'existe aucun autre groupe lié de caractéristiques céramiques similaires ailleurs sur la côte pacifique des Amériques, où l'on s'attendrait à ce que ces cueilleurs de coquillages aient laissé des restes s'ils avaient migré par voie terrestre. Estrada et Meggers présentent une autre liste de similitudes frappantes entre les vestiges archéologiques équatoriens de la culture ancienne de Bahia et de la culture ancienne de Jama-Coaque, datant des deux derniers siècles avant Jésus-Christ, et des antiquités d'environ la même époque au Japon, en Inde, en Asie du Sud-Est et dans les îles voisines de Mélanésie. La liste des traits culturels parallèles ou très similaires comprend des modèles de maisons en poterie avec des caractéristiques architecturales non typiques des types de maisons du Nouveau Monde, des repose-nuques, des figurines assises, des flûtes de pan symétriquement graduées, des poids de filet en poterie, des ornements d'oreilles en forme de tees de golf, des jougs de coolie pour transporter des fardeaux et des radeaux de mer avec des planches centrales.
Comme Arnold et Frost, ces auteurs notent que le courant contre-équatorial, qui coule vers l'est juste au nord de l'équateur, mène directement vers la côte nord de l'Équateur, et que, plus au nord, le courant japonais coule vers l'est pour rejoindre le courant mexicain qui descend le long de la côte pacifique jusqu'en Équateur. En réponse aux accusations selon lesquelles un petit groupe d'étrangers apparaissant sur les côtes sud-américaines serait liquidé ou absorbé par les habitants locaux, Estrada et Meggers nous rappellent que quelques années après la découverte européenne, au début du XVIe siècle, dix-sept Noirs survécurent à un naufrage au large de cette même côte, se marièrent avec des femmes indiennes, prirent en peu de temps le contrôle politique de toute la province d'Esmeraldas et, des décennies plus tard, résistèrent avec succès à la conquête espagnole. En outre, les auteurs estiment que la période autour de 200 av. J.-C. fut idéale pour l'introduction d'idées nouvelles dans une culture qui avait émergé de ses débuts simples et primitifs et avait le potentiel de se développer en une civilisation relativement avancée.
Estrada et Meggers nous assurent que les navires de haute mer d'Asie du Sud-Est étaient tout à fait capables d'effectuer la traversée du Pacifique même à cette époque reculée. Au IIIe siècle, ces navires pouvaient transporter six cents hommes et mille tonnes de marchandises, et bien avant cela, des navires lourdement approvisionnés utilisaient les voies maritimes pour entretenir les relations économiques et politiques entre l'Inde, la Chine et leurs colonies.
Les diverses théories évoquées dans ce chapitre ont été présentées avec une retenue délibérément dénuée d’émotion. Cela ne signifie pas qu’elles soient considérées comme telles. Au contraire, chaque hypothèse, chaque affirmation, chaque élément de preuve a été âprement débattu de New York à Vienne et à Copenhague. Le Congrès international des américanistes, qui s’est tenu presque chaque année depuis 1875, a peut-être fourni les scènes les plus dramatiques de ces débats, car c’est là que les adversaires de toutes les parties du monde peuvent exprimer leurs opinions face à face. Prenons l’exemple du premier congrès :
C’était le lundi 19 juillet 1875, à une heure et demie d’un après-midi chaud à Nancy, en France. L’événement était un gala ; l’institution qui le parrainait, le Conseil de la Société Américaine de France, avait tout mis en œuvre pour présenter une démonstration colorée. Le Palais Ducal, où se déroulaient les sessions, était décoré à une extrémité de drapeaux américains en masse, leurs hampes réunies derrière un grand bouclier portant les noms de Leif Erikson, Jean Cousin de Dieppe, Christophe Colomb et Americus Vespuce. À l’entrée de la salle des Cerfs, où les délégués siégeaient, un double « trophée » de drapeaux français était couronné de deux grands panneaux de tapisserie provenant du pavillon de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Dans les salles au-delà se trouvait une grande exposition d’antiquités américaines et de curiosités indiennes indigènes, ainsi que quelques reliques guanches des îles Canaries, apportées par le Dr Chil y Naranjo, un ardent défenseur de la théorie de l’Atlantide perdue.
A l'intérieur, les délégués de trente nations, ayant terminé ce matin-là les rituels inévitables du congrès français (accueil, réponse et autres formalités), s'étaient maintenant attelés à la véritable raison de leur venue : l'échange d'informations et d'idées sur l'Amérique aborigène. Il y avait partout une atmosphère d'attente ; les délégués semblaient sentir l'importance historique de cette première réunion. Près des hautes fenêtres donnant sur le parc se tenaient le professeur Henry, directeur de la Smithsonian Institution de Washington, et M. Robert C. Winthrop, président de la Société historique de Boston, délégués officiels des États-Unis. Ils échangeaient des plaisanteries avec MM. Paplonski et Luis de Zelinski, qui, selon le programme, représentaient « la Russie et les pays slaves ». En regardant autour de la salle bondée, on vit Ogivia Yémon du Japon, M. Stéphane D'Aristarchi de Constantinople, d'éminents professeurs de Norvège, du Danemark, du Pérou et une foule d'autres savants dignes de ce nom, en redingote et col montant et rigide.
La première séance portait sur le thème « Relations de l’Amérique précolombienne avec l’Ancien Monde », un sujet chargé de dynamite, et les délégués attendaient manifestement avec plus qu’un plaisir purement académique le choc des esprits qui allait se produire. La première conférence, une conférence inoffensive sur la découverte de l’Amérique par l’Islande, était désormais un sujet de conversation dépassé dans ces cercles ; on l’ignora poliment. La deuxième conférence au programme, lue par M. Paul Gaffarel, professeur à la Faculté des Lettres de Dijon, s’intitulait « Les Phéniciens en Amérique ». Les délégués se précipitèrent, s’attendant à un feu d’artifice, mais les choses n’étaient pas encore suffisamment échauffées et, bien qu’il y ait eu quelques hochements de tête ici et là, même ce sujet controversé ne souleva aucune protestation. Puis vint une conférence présentée par M. Foucaux, professeur au Collège de France, intitulée « Le bouddhisme en Amérique ». Au fur et à mesure que la discussion se déroulait, la moitié de l'auditoire érudit manifestait son assentiment, tandis que l'autre moitié commençait à s'agiter nerveusement, manifestement de plus en plus agacée.
L'auteur de la communication s'achevait en exprimant l'espoir que la question des influences bouddhiques dans l'Amérique préhistorique serait sérieusement examinée par les délégués, dont les recherches, pensait-il, établiraient avec certitude dans quelle mesure l'Amérique devait à l'Asie une grande partie de son ancienne civilisation. C'était demander un combat, et il y avait maintenant des adversaires prêts à se battre. Immédiatement, M. Léon de Rosny, président de la Société d'ethnologie de Paris, demanda la parole. M. Edouard Madier de Montjau, qui présidait la séance, la lui accorda. « Le détroit de Béring n'a jamais été un obstacle sérieux aux communications entre les deux continents », proclama de Rosny.
Chaque année, des vents favorables soufflent du Kamtchatka vers l'Amérique, et il y en a d'autres qui soufflent en sens inverse. Les Esquimaux considèrent comme un jeu de faire le voyage d'une presqu'île à l'autre, non seulement dans des bateaux isolés, mais dans de grandes flottes de pêche. N'aurait-il pas été possible un beau jour que le voyage fût tenté, non par quelques misérables chasseurs de phoques, mais par de grandes bandes d'émigrants venus des régions les plus civilisées de l'Asie orientale, qui ne se seraient pas arrêtés, comme les Esquimaux, à la presqu'île d'Alaska, mais auraient pénétré jusqu'au Mexique, peut-être jusqu'au Pérou, et, en apportant dans ces régions de nouvelles idées de gouvernement et de religion, auraient fondé les grandes civilisations attribuées aux Toltèques, aux Aztèques et aux Incas ?... Nous n'admettons ni l'autochtonisme ni le non-autochtonisme des races américaines, parce que c'est une question de science et que nous ne pouvons l'affirmer sans preuve. Il en est de même de l'autochtonisme ou du non-autochtonisme des civilisations américaines. Quelles preuves peut-on apporter en faveur de l’origine asiatique de la civilisation mexicaine ou péruvienne ?
M. de Rosny s'arrêta, versa délibérément un verre d'eau, le porta à ses lèvres avec un certain dégoût, et continua : « Non seulement la solution de cette question est loin d'être à portée de main, continua-t-il, mais la poser même est prématuré.
"Ils n'ont pas encore réussi à déchiffrer la plupart des monuments de la littérature indigène américaine, et pourtant ils veulent comparer cette civilisation à celle de l'Asie ! Ils commencent à peine à épeler, et déjà ils veulent tirer des conclusions !"
Il y eut quelques rires et quelques applaudissements. M. le docteur Dally, président de la Société d'anthropologie de Paris, obtint la parole. « Ces prétendues analogies entre l'Ancien et le Nouveau Monde ne sont que des sempiternelles illusions. La solution de la question est que les indigènes américains ne sont ni des Hindous, ni des Phéniciens, ni des Chinois, ni des Européens : ils sont des Américains. »
L'orateur suivant fut le révérend père Petitot, missionnaire, qui déclara cette dernière solution prématurée.
Toutes ces questions sont trop jeunes pour être si promptement résolues. Je crois pouvoir fournir des données nouvelles sur les immigrations asiatiques en Amérique. Les analogies entre diverses langues asiatiques, notamment le malais, et les langues américaines que j'ai étudiées avec le plus grand soin, me portent à croire à l'existence d'une langue primitive et universelle, dont nous ne recueillons aujourd'hui que des fragments épars. Autrement, comment trouverait-on dans l'Inde des mots appartenant non seulement au malais, mais au latin et au breton ?... Je vous prie donc instamment de ne pas reculer a priori devant l'hypothèse asiatique.
Le délégué salvadorien, M. Torres Caicedo, répondit : « En matière de science, toute opinion est admissible, à condition qu’elle soit appuyée par des preuves et qu’elle demeure. Il me semble cependant que les grandes civilisations de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud ont un caractère très original, que leurs langues, leurs monuments portent une empreinte particulière qui n’est ni scandinave ni asiatique, mais véritablement américaine. »
« La parole est à M. Frédéric de Hellwald, délégué d’Autriche », annonça le président. Ce monsieur se leva. Il rendit d’abord hommage au zèle et à l’érudition du révérend père Petitot. Puis il attaqua l’idée que les Esquimaux auraient pu apporter la civilisation de l’Asie orientale aux contrées méridionales de l’Amérique.
Il n'est pas nécessaire de se précipiter vers des conclusions, mais il semble établi que les Esquimaux et les races voisines, soit d'Asie, soit d'Amérique, formaient une race à part, qu'on pourrait appeler une race boréale. Entre eux et les Indiens, il n'existe aucune ressemblance. Ils n'ont pu servir d'intermédiaires entre les peuples civilisés de l'Asie orientale et ceux de l'Amérique. Il est possible qu'entre la Chine et le Japon, d'une part, et le Mexique et le Pérou, d'autre part, il y ait eu des communications directes, mais accidentelles. Sans doute, une barque japonaise ou chinoise a pu être poussée par les tempêtes à travers le Pacifique et échouer sur la côte américaine ; cela s'est produit plus d'une fois de notre temps. Mais l'homme civilisé n'est pas plus sage que le milieu où il vit ; détaché de ce milieu, il perd sa supériorité. Que serait-il arrivé à quelque pauvre pêcheur ou à quelque marin échoué sur un rivage inconnu, au milieu de tribus barbares dont il ne comprenait pas la langue ? Il n'y a pas un Asiatique ou un Européen qui eût civilisé les Indiens dans ces circonstances. Au contraire, ils seraient devenus eux-mêmes des sauvages, oubliant leur pays natal et peut-être même leur langue maternelle, car telle est l'histoire de tous les individus abandonnés ou jetés sur une côte déserte, telle est l'histoire de tous les Robinson Crusoé. Jamais ces Robinson Crusoé n'ont servi la cause de la civilisation.
M. Léon de Rosny fut de nouveau reconnu. Il attaqua amèrement les idées du révérend père Petitot. Les procès-verbaux officiels du congrès en parlèrent même comme d'une guerre courtoise, mais acharnée. « Toutes ces hypothèses d'influences asiatiques sur les civilisations américaines sont très piquantes, conclut-il. C'est la preuve où gît le vice. » Petitot répondit avec véhémence : « Je n'ai pas du tout conclu définitivement. Je n'ai pas l'intention de conclure quoi que ce soit. Je vous demande seulement de ne pas juger sans avoir entendu. »
Ici, le compte rendu du congrès s'interrompt discrètement, ou les participants se retrouvent dans un silence maussade. Le prochain à prendre la parole est Lucien Adam, qui lit un long exposé sur la théorie de Fu-Sang, une ancienne découverte chinoise de l'Amérique. Lorsqu'il a terminé, Frédéric de Hellwald se lève et observe sèchement :
Cette légende de Fu-Sang revient périodiquement, aussi obstinément et aussi régulièrement que l'apparition du serpent de mer est rapportée dans nos journaux. De même que personne n'a jamais avoué personnellement avoir étudié zoologiquement cet animal, de même personne n'a jamais prouvé scientifiquement la découverte de l'Amérique par les Chinois. Le docteur Bretschneider a largement réfuté, il y a quelques années, cette fable, ce qui n'a pas empêché qu'un livre anglais sur elle ne paraisse récemment. Il est à craindre que la réfutation de M. de Rosny et de Lucien Adam ne mette un terme à la réapparition du monstre. Le congrès de Nancy rendrait un véritable service à la science en déclarant qu'il tient la théorie de Fu-Sang pour un serpent de mer scientifique et en lui interdisant d'infester désormais les latitudes de l'américanisme.
Le récit d’aventures saisissant de Thor Heyerdahl, le best-seller Kon-Tiki, a prouvé que les anciens Péruviens auraient pu traverser le Pacifique d’est en ouest sur leurs radeaux de balsa préhistoriques, un exploit que l’on croyait autrefois quasiment impossible. Heyerdahl pense non seulement qu’ils y sont parvenus, mais que la population et la culture polynésiennes sont ainsi venues d’Amérique du Sud, amenées vers 500 après J.-C. par le légendaire héros culturel péruvien, le dieu blond Viracocha, et ses compagnons de migration. Six cents ans plus tard, selon Heyerdahl, des Indiens Kwakiutl « de type caucasien » mais aussi légèrement mongoloïdes venus de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord ont envahi Hawaï, se sont mêlés aux migrants péruviens et ont formé la race et la culture océaniennes ou maori-polynésiennes actuelles dans ces îles. Il fonde son argument sur la ressemblance entre le nom pré-incaïque de Viracocha, que l’on dit être « Con-Tici » ou « Illa Tici », et le dieu polynésien « Tiki » ; sur ce qu'il imagine être des styles artistiques similaires en Polynésie et dans l'ancien Pérou ; sur les premiers récits d'indigènes à la peau claire sur l'île de Pâques et de héros culturels blonds et barbus au Pérou, avec des personnes blondes, barbues ou au nez aquilin représentées dans l'art préhistorique d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale (que les théoriciens des tribus perdues d'Israël considèrent comme des Israélites) ; sur la distribution de la patate douce et de la courge, domestiquées des deux côtés du Pacifique avant la découverte européenne ; et sur la similitude des styles artistiques entre l'Amérique aborigène de la côte nord-ouest et la Polynésie.
A première vue, il s'agit d'un ensemble impressionnant de preuves, mais il n'a pas déconcerté les anthropologues professionnels américains, qui, presque en tant qu'organisme, constituent depuis plusieurs générations une sorte de comité de surveillance pour protéger le public imprudent contre ce que les scientifiques considèrent comme des théories hâtives sur l'origine et les relations préhistoriques des Indiens d'Amérique avec l'étranger. Face à cette nouvelle menace, ils gardaient un œil nerveux sur la liste des livres les plus vendus, car chaque fois qu'un livre de Heyerdahl figurait dans le top 10, cela signifiait que des milliers de nouveaux fans de Kon-Tiki et d'Aku-Aku rejoignaient la liste de leurs ennemis. S'il y a une chose qu'un lecteur avide de livres d'aventure déteste, c'est un érudit intellectuel qui verse sagement un tube à essai d'eau froide sur un héros viking blond déjà trempé de saumure qui a conquis le Pacifique rugissant pour démontrer sa foi dans une théorie dramatique, alors que les scientifiques à lunettes avaient dit que c'était impossible.
Les anthropologues, qui auraient dû être plus avisés, n’en ont pas moins fait la queue pour attaquer la thèse de Heyerdahl. L’un des mieux placés pour le faire était peut-être le conservateur du département d’ethnologie océanique au musée d’histoire naturelle de Chicago, le Dr Alexander Spoehr, qui deviendra plus tard directeur du célèbre musée Bernice P. Bishop à Hawaii, un poste que ses amis lui reprochent parfois d’avoir accepté pour échapper à la colère des aficionados du Kon-Tiki sur le continent. Le Dr Spoehr ne nie pas que Heyerdahl ait prouvé qu’un voyage de ce genre pouvait être effectué ; il nie en revanche que des migrations d’une telle ampleur aient réellement eu lieu. L’étymologie du mot péruvien « Tici » est loin d’être certaine, a-t-il souligné, et de plus, les occurrences occasionnelles et fortuites du même mot ou élément de mot dans deux langues sans rapport entre elles sont un phénomène courant. J’ai récemment trouvé dans un article d’ethnographie africaine que les Akka, une tribu nomade de nains décrite pour la première fois par l’explorateur Henry Morton Stanley, étaient appelés Tiki -Tiki par leurs voisins. Devons-nous en déduire qu’ils sont eux aussi impliqués d’une manière ou d’une autre dans l’exode de Viracocha ? Quant à leur couleur de peau, les Polynésiens sont assez légèrement pigmentés sur les parties du corps qui ne sont pas exposées au soleil et on sait qu’ils ont une lignée raciale de type caucasien. Les cultures matérielles du Pérou pré-incaique et de la Polynésie n’étaient pas les mêmes, et les similitudes existantes dans la maçonnerie se retrouvaient également en Malaisie et en Micronésie, loin à l’ouest. La patate douce et la courge indiquent certes un contact entre l’Ancien et le Nouveau Monde, mais cela ne prouve pas une migration – pas plus, dit le Dr Spoehr, que ce qui pourrait laisser penser que, parce que la pomme de terre « irlandaise » est originaire d’Amérique du Sud, les Irlandais sont ipso facto des migrants d’Amérique du Sud également. Quant aux ressemblances dans les styles artistiques entre les îles du Pacifique et l’Amérique du Sud ou la côte nord-ouest, « elles n’ont jamais impressionné les étudiants critiques de la région comme étant similaires ».
Au contraire, le Dr Spoehr avance un imposant faisceau de preuves défavorables : les langues polynésiennes appartiennent à la famille malayo-polynésienne qui s’étend de la Micronésie et de la Malaisie jusqu’à l’archipel insulaire d’Asie du Sud-Est. La pirogue à balancier qui traversait cette même ceinture permettait des migrations faciles depuis le continent vers l’est, ce que confirment une série de plantes alimentaires océaniques, telles que le taro, la noix de coco, la banane et l’arbre à pain, ainsi que le cochon domestique, reliant la Polynésie à l’Ancien Monde plutôt qu’au Nouveau. Et pourquoi, demande le Dr Spoehr, si les Polynésiens sont en grande partie des marins péruviens, des traits péruviens fondamentaux comme les arts textiles et la céramique hautement développés ne se trouvent-ils pas chez eux, et si Viracocha et ses cohortes étaient effectivement blonds ou roux comme on le prétend, pourquoi n’a-t-on pas trouvé cet élément caucasoïde dans les abondants restes squelettiques pré-incas ?
Hans Plischke, directeur de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Göttingen, fut un autre critique éminent de Heyerdahl. Il écrivit que depuis les voyages de James Cook, la science a reconnu les liens culturels et ethno-historiques des Polynésiens avec l'Asie du Sud-Est. Les preuves linguistiques, anthropologiques physiques et ethnologiques ainsi qu'historiques soutiennent toutes une migration des insulaires des mers du Sud vers l'est, depuis l'Indonésie, vers le Pacifique ; il existe un résumé convaincant, selon Plischke, dès 1870 : Origin of the Polynesians de George Gerland. Les théories qui nient que le mouvement de population soit venu de l'ouest plutôt que de l'Amérique en raison des alizés et des courants contraires ignorent les compétences maritimes des Malais, dit Plischke ; ils savaient naviguer contre le vent. Selon cet auteur, un indigène nommé Tupia, que le capitaine Cook emmena avec lui de Tahiti en 1769, pouvait interpréter sans difficulté non seulement en Nouvelle-Zélande mais aussi dans l'archipel malais, ce qui montre une relation linguistique précoce lorsque ces peuples furent découverts pour la première fois. En effet, ajoute Plischke, le mot « Tiki » lui-même est d’origine malaise selon les autorités en langues indonésienne et marquisienne.
Le Dr Edward Norbeck a écrit à propos du livre de 821 pages de Heyerdahl, American Indians in the Pacific :
Le traitement est opportuniste. Chaque brin de paille est saisi, plié et tordu pour servir les objectifs de l'auteur. Les preuves fragiles sont poussées au-delà des limites raisonnables ; les données contradictoires reçoivent peu d'attention ou sont omises, et le manuscrit abonde d'affirmations imprudentes. L'auteur est à la fois ingénieux et naïf, et la magie verbale est un outil récurrent. Même le lecteur qui, comme ce critique, n'est que modestement informé sur les domaines concernés peut trouver plusieurs centaines de points qu'il remettra en question ou rejettera.
Le seul anthropologue professionnel à approuver sans réserve ce livre fut probablement le Dr W. M. Krogman, qui, dans le Chicago Sunday Tribune, le qualifia d’« ouvrage érudit, bien écrit, soigneusement documenté et magnifiquement illustré… Ce livre naviguera sur les mers turbulentes de l’évaluation scientifique – je pense qu’il se révélera digne de ce nom ! » Plusieurs critiques anthropologiques reconnurent à Heyerdahl tout le mérite d’avoir rouvert et relancé le problème des contacts transpacifiques, même s’ils ne pensaient pas que son livre ait réellement contribué à sa solution. Le regretté Wendell C. Bennett de Yale écrivit dans le New York Times que Heyerdahl avait introduit un nouvel ensemble de preuves sur les origines polynésiennes qui, en raison de leur quantité et de leur qualité, ne pouvaient être ignorées, mais il estimait que Heyerdahl avait exagéré ses arguments et que la question n’était pas encore résolue, car « il existe encore de sérieuses objections à l’attribution d’origines polynésiennes totales au Nouveau Monde ». Le regretté Ralph Linton, également de l'Université Yale, a déclaré que le temps était venu d'examiner les preuves de contacts entre l'Océanie et l'Amérique pendant les temps anciens, mais il a attaqué presque tous les aspects de la méthode et de l'interprétation de Heyerdahl.
Heyerdahl n’a d’ailleurs pas été le premier à proposer un déplacement de la culture primitive du Pérou vers l’hémisphère oriental. Vers le milieu du XIXe siècle, Charles Wolcott Brooks, consul japonais à San Francisco, commença à recueillir des données sur l’histoire de l’Asie de l’Est et sur les éventuelles communications avec les Amériques. Selon Hubert Howe Bancroft, qui a examiné le manuscrit de Brooks « Origin of the Japanese Race, and Their Relation to the American Continent », le consul a reconnu des analogies frappantes entre les Chinois et les Péruviens et a conclu que les premiers étaient originaires du Pérou. Il a plaidé en faveur d’un mouvement d’est en ouest (par opposition à la direction opposée) en se basant sur la difficulté de résister aux alizés et aux courants qui passent du Pérou à la Chine ; d’un autre côté, si un grand navire était placé face au vent et partait à la dérive depuis la côte péruvienne, a déclaré Brooks, il y avait une forte probabilité qu’il se dirige directement vers la côte sud de la Chine.
En 1958, un mormon du nom de DeVere Baker et trois compagnons ont dérivé pendant soixante-neuf jours sur un radeau de la Californie à Hawaï. Baker a échoué lors de ses trois premières tentatives pour se libérer des courants côtiers nord-américains, mais son quatrième bateau, le Lehi IV de 5,5 mètres sur 5,5 mètres et neuf tonnes, équipé d’une voile de 6 mètres, a été libéré au large de Long Beach, a dérivé pendant un certain temps au large des îles Guadalupe, puis a été attiré par les alizés vers l’ouest. Le but du voyage, selon une dépêche de l’Associated Press d’Honolulu le jour où le radeau a été remorqué sur la côte, était de prouver « comment la population mondiale a migré et s’est croisée il y a des milliers d’années ». Plus particulièrement, Baker voulait étayer le récit du Livre des Mormons sur la façon dont le prophète Léhi a dérivé avec les tribus perdues d’Israël de la mer Rouge à l’Amérique centrale. Pour ce faire, Baker prévoit, au moment où j’écris ces lignes, de tenter un voyage similaire en radeau depuis le golfe Persique vers l’est jusqu’au Nouveau Monde.
La plupart des américanistes peu formés et moins inhibés se sont essayés à un moment ou à un autre, comme Thor Heyerdahl avec ses listes de mots péruviens et polynésiens, à la linguistique comparative, sans se rendre compte des pièges qu’elle comportait. Augustus Le Plongeon, qui a passé les trois dernières décennies de sa vie mouvementée à fustiger les principales autorités anthropologiques des États-Unis, a écrit depuis l’île tropicale de Cozumel, au large des côtes du Yucatan, que la langue maya contenait des mots de presque toutes les langues, anciennes et modernes. C’était une conclusion prévisible pour quelqu’un dont la confiance dans la signification historique des similitudes sonores entre les vocabulaires sélectionnés était implicite. Un de mes étudiants hongrois m’a un jour apporté fièrement une longue liste de mots finno-ougriens qui pourraient être presque dupliqués dans le maya yucatèque moderne, avec des significations identiques, très proches ou au moins vaguement comparables. Il était convaincu de l'existence d'une relation historique, même lorsque, après l'échec de mes propres arguments, je l'ai persuadé de me laisser envoyer son article (il craignait que quelqu'un ne le pirate) aux meilleurs linguistes du pays, qui l'ont tous rejeté en peu de temps. Je crois finalement avoir ébranlé son armure en établissant ma propre liste d'une cinquantaine de quasi-duplications entre l'anglais et le maya, mais si j'avais montré les deux listes au Dr Le Plongeon, il aurait sans doute accueilli les deux avec enthousiasme.
Voici quelques-unes des dérivations suggérées pour le nom Yucatan. L’historien espagnol Diego Lopez de Cogolludo a écrit qu’en 1517, l’expédition de Cordoue, qui longeait la péninsule, avait demandé le nom d’une grande ville et que les indigènes avaient répondu « Tectatan », ce qui signifie « je ne comprends pas ». Recevant la même réponse partout où ils allaient, les Espagnols ont pris ce nom pour le nom de tout le pays. On a alors dit que Yucatan était une corruption. John MacKintosh, qui en 1836 a réussi à résumer avec assurance une histoire orthodoxe du monde, y compris l’histoire de l’humanité, en dix-sept petites pages imprimées, a déclaré catégoriquement que Sem, le deuxième fils de Noé, avait eu cinq fils, dont l’un, Arphazad, était le père de Salah, qui engendra Eber, dont le fils aîné s’appelait Joktan, et c’est de lui que Jucatan, ou Yucatan, tire son nom. Le comte Jean Frédéric Waldeck, qui commença à l’âge de soixante-six ans une carrière de quarante-trois ans comme archéologue maya et qui mourut, dit-on, à Paris des suites d’un accident survenu en tournant la tête pour regarder une jolie fille, crut d’abord reconnaître dans « Yucatan » le nom de Yectatan, fils d’Heberto et père d’Ofir. Un peu plus tard, il découvrit que le révérend père Gregorio Garcia, un autre partisan de la théorie des tribus perdues d’Israël, avait proposé la même idée en 1607. On ne peut que deviner si le fait d’avoir trouvé une prétention antérieure à cette hypothèse a affaibli sa propre foi en elle, mais en tout cas Waldeck se demanda bientôt comment il était possible de confondre Tectatan avec Yucatan, une question qui se pose également à presque tout le monde, et il décida qu’il était plus raisonnable de supposer que le nom venait plutôt du maya uyukutan, « écoute ce qu’ils disent » — probablement dans le sens de « as-tu jamais entendu des propos aussi insensés ? » En 1905, Rejón Garcia, qui n’a aucun lien de parenté avec le père Gregorio à ma connaissance, écrivait que Yucatan venait de y, « son », plus u, « collier », c, « notre » et atan, « épouse ou femme » — ainsi les Indiens ne cessaient de demander aux Espagnols : « Vendez-nous des colliers pour nos épouses ». On ne sait pas comment ce nom est devenu le nom du pays, ce qui semble être un maillon faible dans cette chaîne de raisonnement déjà douteuse. Un autre chercheur encore — que j’ai pu trouver sous le seul nom de Sr Carillo — pensait que le nom signifiait « collier de la terre ».
Il s’agit d’un jeu auquel, évidemment, n’importe quel nombre peut participer, sans être gêné par des règles de manipulation des mots. Voyez ceci, tiré d’un Mémoire de M. de Paravey sur l’origine japonaise, arabe et basque de la civilisation des peuples du plateau de Bogota, publié à Paris en 1835 : Le nombre vingt, dit M. de Paravey, est egueu en basque ; or gue en muysca, une langue indienne de Colombie, signifie « maison » et, nous dit l’auteur très sérieusement, « contenant sans doute vingt personnes en commun ». Cette identité, continue-t-il, est remarquable, mais elle n’est pas unique, car « un » en japonais est fito, d’où il est facile de dériver fato, et fata, et bata, ce dernier signifiant « homme », avec ata en muysca et bat en basque signifiant la même chose.
Lucien de Rosny fut un autre manipulateur de mots du XIXe siècle qui présenta l'étonnant argument suivant dans son Étude d'archéologie américaine comparée. Le mot atl ou at, qui signifie eau en nahuatl mexicain, existe aussi en vieux scandinave ; par une transposition de lettres, les Français ont alterer, qui semble aussi être le radical de l'anglo-saxon water, le w n'étant qu'une aspiration locale. Atli était le nom d'un seigneur scandinave du Xe siècle. La montagne Atlas en Afrique, personnifiée dans la mythologie classique par le seigneur du ciel (atlao), implique aussi l'idée d'eau. En fait, l'eau soutient l'air, comme l'air soutient le feu, d'où (de Rosny parle toujours, je vous assure) la loi physique de la densité des corps et donc les trois mythes symboliques de la purification. Atlantique désigne une partie de l'océan, Atla est une ancienne ville panaméenne au bord de l'Atlantique, et Utatlan, un nom du même radical, désigne des ruines mayas qui, comme le fait remarquer triomphalement M. de Rosny, sont situées entre les deux océans ! J'ai fouillé pour l'université de Tulane à Utatlan, dans les hautes terres du Guatemala, à une altitude d'environ sept mille pieds (à deux ou trois jours de voyage par tous les moyens, sauf par avion, de l'un ou l'autre océan), situé au sommet d'une colline escarpée et fortifiée entourée de gorges presque infranchissables, avec l'eau la plus proche à plusieurs milles de distance, et un endroit moins susceptible de porter un nom ayant trait à l'eau, à moins que ce ne soit parce que les Indiens avaient toujours si soif qu'ils y pensaient continuellement.
Des preuves linguistiques ont été avancées pour étayer à peu près toutes les théories sur les origines des Indiens d’Amérique, des Égyptiens aux Carthaginois, en passant par les Polynésiens et les Gallois. En 1637, Thomas Morton entendit les Indiens dire « Pasco-pan » et en déduisit que leurs ancêtres connaissaient le dieu Pan, confirmant ainsi sa croyance selon laquelle ils étaient d’origine grecque et romaine. En 1926, le professeur Leo Wiener de Harvard publia un magnifique ouvrage contenant trois cent vingt-six planches, toutes en couleur à l’exception de quelques-unes, consacrées à la thèse selon laquelle les langues maya et nahuatl dérivent du mandingue de l’Afrique noire. Quelque trois mille mots maya-mexicains et africains furent présentés comme preuves. En 1883, le consul général et chargé d’affaires de la République française en Amérique centrale, P. Dabry de Thiersant, dans son ouvrage De l’origine des Indiens du Nouveau-Monde et de leur civilisation, dressait la liste des ressemblances sonores entre les mots du quechua du Pérou, du maya d’Amérique centrale et du sanskrit. L’une des attaques les plus amusantes et les plus dévastatrices contre ces méthodes fut lancée par Edward John Payne en 1899 ; il dressa de longues listes de similitudes frappantes entre le nahuatl mexicain et le grec, et entre le nahuatl mexicain et le latin. « Rien de moins qu’un miracle permanent, disait Payne, ne pouvait empêcher de telles coïncidences. » Soixante-trois ans plus tôt encore, J. MacKintosh, dans The Discovery of America by Christopher Columbus and the Origin of the North America Indian, lançait le même avertissement et montrait que les ressemblances radicales entre les Celtes et les Algonquins ne signifiaient pas que les Indiens étaient apparentés aux Irlandais.
Parmi toutes les acrobaties linguistiques non réprimées dans ce domaine général, je décernerais le premier prix à un ouvrage publié en 1945 à Charlottesville, en Virginie : America: The Background of Columbus, de Jennings C. Wise. On pourrait choisir presque au hasard parmi les centaines de pages, mais quelques exemples traduisent le ton de ce livre stupéfiant. La technique habituelle de Wise semble avoir été de choisir une syllabe d'un mot ou d'un nom de lieu, puis de voir où il pouvait la trouver ailleurs dans un atlas. Ainsi, il trouve significatif que les lieux suivants contiennent tous les lettres bra : « La-bra-dor, le pic sacré de Bra-zo au Nouveau-Mexique, les Bra-zos au Texas, Bra-za en Argentine à côté de Bra-zi-la, Bra-za en Autriche et Brahma-poo-t-ra en Inde. » De nouveau, Wise examine le nom America et décide qu'Amar est la clé de son histoire : . « Comme l’arche d’Amaravati était commune à toute la terre, nous trouvons les noms de lieux suivants portant le nom de lieu Naga-Maya America : A-mar-go-za en Na-va-da, « Le Serpent, le Divin, la Diva. » Amar-illo au Tejas, « la Terre de la Paix » (Texas). Amar-illas à Cuba, « Le Serpent, l’Homme Universel. » . . Amar en Syrie. S-Amer-ia en Syrie. S-amar-kand. S-amar aux Philippines. S-amoa. Amaraka-no-ta-ka en Inde. . . Un autre exemple, si vous pouvez tenir le coup : « Tout aussi évident est le lien entre C-ana-da, « Christos, Ana, l’Arche Divine », Mont-ana, . . . Gui-a-na, Gui-n-ea. . . . De toute évidence, Ta-na-sa (Tennessee) est le pendant occidental de Ta-na-se-rim qui mène de Burmah à Sin-ga-pore, une relique de l'acacia de l'oiseau.
Wise a également affirmé qu’en 66 après J.-C., une flottille de navires « de type gréco-romain indubitablement » est apparue au Yucatan. Ce contact, note-t-il sérieusement, explique les noms de lieux géorgiens tels qu’Athènes, Rome, Augusta et Atlanta !
Qu’est-ce qui, dans ce jeu de mots, est si convaincant pour le pseudo-scientifique et ses lecteurs enthousiastes ? Aucun homme d’affaires sensé ne prendrait une décision financière sur la base de preuves comme celles-ci ; aucun médecin ne songerait à diagnostiquer un cas à partir d’un ou deux symptômes aléatoires ; aucun tribunal du pays ne condamnerait un homme sur la base de preuves circonstancielles aussi maigres et aussi fragiles. Pourtant, des centaines de milliers de lecteurs avides de Kon-Tiki et d’Aku-Aku, ayant absorbé plusieurs centaines de pages de récits purement aventureux, sont irrévocablement convaincus que Thor Heyerdahl et ses compagnons, après leurs magnifiques exploits de courage et de navigation, ont démontré au-delà de tout doute qu’un dieu péruvien nommé Kon-Tiki était le même qu’un chef-dieu blanc nommé Tiki mentionné par un vieil homme sur une île des mers du Sud ! Et cela en dépit du fait que Heyerdahl déclare expressément dans une annexe de Kon-Tiki que sa théorie de la migration « n’était pas nécessairement prouvée » par le succès de son célèbre voyage.
Pourquoi ? L’individu moyen aspire peut-être inconsciemment à participer à ce qu’il perçoit comme le frisson intellectuel de la recherche scientifique et universitaire. Et la linguistique comparative est une approche parfaitement légitime et utile pour l’étude des liens historiques. Cependant, on ne s’y prend pas simplement en associant des mots qui se ressemblent. On analyse plutôt la structure de base de la langue, son type fondamental, la nature de ses idiomes et de sa grammaire, ainsi que la similitude de son et de sens non seulement de mots entiers mais aussi de parties de mots, de racines et de formes grammaticales. On doit s’attendre à un certain nombre de ressemblances sonores fortuites entre deux langues, qu’elles soient apparentées ou non. Ainsi, comme l’a souligné le Dr Alfred L. Kroeber, dans la langue indigène californienne, le yuki, le mot ko signifie « aller » et kom « venir », mais personne n’a jamais suggéré que le yuki et l’anglais étaient historiquement apparentés. Kroeber nous rappelle en outre qu’une trop grande ressemblance entre une partie du patrimoine de deux langues suggère immédiatement que l’une a emprunté à l’autre très récemment, car les langues changent continuellement, leurs sons ne cessent de se modifier, le sens des mots se déplace progressivement, et lorsque le lien historique entre deux langues est réel, « il doit être voilé par un certain degré de changement ou de distorsion ». La « loi de Grimm » des changements dans les langues indo-européennes en est un exemple : le p latin devient f anglais , et le d latin devient t anglais. Ped devient foot, pater devient father ; et, de plus, avant de pouvoir supposer un lien historique entre deux peuples dont les langues semblent similaires, il faut aussi étudier les possibilités de divers processus culturels comme la convergence, le développement parallèle, l’assimilation secondaire de la forme, et bien d’autres phénomènes que l’homme moyen n’a ni le temps, ni l’opportunité, ni l’envie de s’entraîner à évaluer par les méthodes exigeantes de la science philologique.
Il cherche plutôt à obtenir sa satisfaction par des moyens faciles et agréables. Ce n’est pas un hasard si la formule publicitaire la plus connue et la plus efficace depuis des générations est : « C’est facile ! C’est amusant ! » On observe le même phénomène dans le domaine médical : l’immense popularité des chroniqueurs médicaux dans les journaux et les magazines témoigne de l’immense désir du public de participer à la connaissance médicale. Pourtant, les lecteurs de ces articles n’osent pas risquer leur vie ou leur santé sur la connaissance superficielle des informations qu’ils absorbent ainsi. Ils ne peuvent pas non plus risquer leur propre argent sur une connaissance limitée de l’économie et des marchés ; ils s’adressent plutôt à des conseillers en investissement, des experts qui consacrent leur vie à ces questions. « Un peu de connaissances », vous dira presque tout le monde, « c’est dangereux. » Mais ce n’est pas le cas dans un domaine où il n’y a pas de risque évident, où la santé n’est pas en jeu, où l’on ne met pas d’argent en jeu. Les gens n'hésitent pas à prêter allégeance à la théorie du Kon-Tiki, dont il est à peine question dans le livre populaire lui-même et dont, à la manière typiquement américaine, ils aiment voir la preuve par une aventure physique, un sport de compétition, la vérité de la théorie décernée au vainqueur d'une lutte émouvante d'un homme contre la mer.
Outre leur penchant pour la prestidigitation linguistique, les partisans des théories non orthodoxes sur les origines des Indiens d’Amérique se préoccupent aussi beaucoup de la théologie, que la plupart des anthropologues professionnels considèrent comme sans rapport avec le sujet. Cependant, de nombreux auteurs sur l’Amérique préhistorique ont réussi d’une manière ou d’une autre à orienter leurs arguments vers des voies religieuses et théologiques et à les utiliser pour soutenir ou attaquer (selon leur orientation religieuse particulière) le catholicisme romain, le judaïsme, l’Église d’Angleterre, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et diverses confessions protestantes, pour ne pas dire la religion elle-même. Il est plutôt normal qu'un ecclésiastique de l'époque et du dévouement de Cotton Mather y trouve une signification religieuse : il écrit dans son Magnolia Christi Americana (1702) que bien que nous ne sachions pas quand ni comment les Indiens sont devenus les premiers habitants de ce continent, « nous pouvons néanmoins supposer que le Diable a probablement attiré ces misérables rescapés [ sic ] ici, dans l'espoir que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ne viendrait jamais ici pour détruire ou perturber son empire absolu sur eux. » Mais parmi les profanes, une attribution presque universelle d'une signification religieuse ou surnaturelle à la préhistoire des autochtones américains est moins attendue.
George Jones, Esquire, dont le buste drapé d'une toge orne le frontispice de son livre de 1843 décrivant une colonisation phénicienne en Amérique, était un membre profondément orthodoxe de l'Église d'Angleterre, dédiant son ouvrage à l'archevêque de Canterbury et y menant une guerre vigoureuse contre les athées et tous ceux qui ne croyaient pas à la Bible, aux prophéties d'Isaïe ou à la malédiction de Noé. Sir George gardait constamment un œil nerveux sur sa divinité, demandant fréquemment pardon s'il se trompait, et rappelant dans un passage à Dieu que si l'auteur se trompait dans sa théorie, Dieu lui-même avait mis l'idée dans sa tête et devait donc faire preuve de tolérance avant de le juger trop durement.
Jones tour à tour fouettait les incroyants et faisait appel aux errants. À la fin de son livre, il avait le sentiment d'avoir prouvé l'origine phénicienne des civilisations amérindiennes et, d'une manière ou d'une autre, d'avoir ainsi mis en déroute les forces du mal :
mais pour le sceptique, l’athée qui nie Dieu et le matérialiste perdu dans le labyrinthe, nous les avons affrontés avec une résolution intransigeante et sur le terrain exraique de leur propre choix ; et d’où ils ne peuvent reculer, ils doivent y rester confondus et vaincus ; et à la conclusion indiscutable et irréfutable suivante, ils doivent être muets, — ou s’ils parlent, que ce soit avec humilité et repentir : à savoir : « ces Visions inspirées d’un avenir non approché… ne peuvent être considérées et reçues que comme les pré-ordonnances divines du DIEU TOUT-PUISSANT, — promulguées à un monde émerveillé, des lèvres sacrées de Ses prophètes et médiateurs choisis ! — De tels messagers sacrés pour l’humanité étaient Moïse, Isaïe, Ézéchiel et Daniel ; — et le dernier prophète sur terre, — Le Messie — LE RÉDEMPTEUR OMNIPOTENT DE L’UNIVERS ! »
Menasseh ben Joseph ben Israël, qui écrivit en 1650 que l’identification des aborigènes américains aux tribus perdues était « l’espoir d’Israël », était le grand rabbin d’Amsterdam, et Sir George Jones, qui souscrivait également à la théorie des tribus perdues (pour rendre compte des tribus nord-américaines plus sauvages), était de l’Église d’Angleterre. Pourtant, John D. Baldwin, dans son ouvrage Ancient America publié à New York en 1872, imputa toute l’hypothèse israélite aux catholiques romains, la qualifiant de « théorie véritablement monacale » et de « fantaisie lunatique, possible seulement aux hommes d’une certaine classe, qui à notre époque ne se multiplie pas ».
Tandis que George Jones et, quelques années plus tard, James Kennedy brandissaient les théories de l’origine indienne pour triompher de l’athéisme et des antéchrists, le médecin acariâtre Augustus Le Plongeon fit de son livre sur ce sujet une caisse de résonance pour l’une de ses nombreuses rancœurs : « C’est sur cette histoire de la cour de la reine [Maya] Moo par le prince Aac, le meurtrier de son mari… que repose toute la structure de la religion chrétienne, qui, depuis son avènement dans le monde, a été la cause de tant de sang versé et de tant de crimes atroces. » En 1831, un professeur de Bible, Epaphras Jones, déclara que son livre sur les Dix Tribus et les aborigènes américains n’était « pas fait pour plaire à l’homme, mais pour aider la cause de Dieu ; par conséquent, chacun est libre d’approuver ou de désapprouver l’ouvrage. » Cela a dû mettre les critiques défavorables dans une certaine position désavantageuse.
L’intérêt pour les aspects religieux de ce qui semble être le sujet le plus profane est plus compréhensible aux XVIIIe et XIXe siècles, époque à laquelle un groupe de scientifiques et de personnalités publiques, dont Voltaire et Louis Agassiz, rejetèrent la théorie de l’origine unique de l’homme et opposèrent ainsi la science et la raison à la doctrine de l’Église, qu’à notre époque. Mais il semble qu’une motivation religieuse assez forte anime encore bon nombre de ces études aujourd’hui, même en dehors de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont les Articles de foi du Livre de Mormon intègrent officiellement les Israélites américains à la doctrine mormone. Par exemple, James Churchward, le grand partisan du Continent perdu de Mu, termine l’édition de 1931 de son livre par ces lignes : « Les éléments ayant libéré l’âme de ses liens, l’âme – étant gouvernée par la même Loi divine que les éléments – doit aussi retourner d’où elle est venue. Venant de la « Grande Source », la fin glorieuse et triomphante de l’âme de l’homme doit être son retour à Dieu. »
La pertinence de cette déclaration par rapport au livre qui la précède n’est pas du tout claire pour beaucoup de lecteurs, mais elle est là, comme si son auteur se sentait simplement obligé de dire quelque chose de théologique. Dans certains cas, les auteurs eux-mêmes semblent déconcertés par leurs motivations religieuses apparentes et tentent sans enthousiasme de les justifier. Par exemple, Jennings C. Wise, qui a écrit America: The Background of Columbus en 1945, semble soudainement se rendre compte que ses objectifs religieux avaient besoin d’explications : « En cherchant à mettre les fondements du christianisme en parfait accord avec les découvertes scientifiques modernes, l’objectif de l’auteur n’était cependant pas de nature religieuse partisane. Son objectif était de faire en sorte que les expériences amères des races disparues cèdent la place à des leçons réfléchies et précieuses que l’on ne trouve pas dans le type actuel de soi-disant « histoire légitime ». »
Les écrits sur ces questions des membres de l’Ancien Ordre Mystique Rosae Crucis (connu sous le nom d’AMORC), de la Rosicrucian Fellowship – une organisation apparemment distincte, voire rivale –, de la Société Théosophique et de la Lemurian Fellowship sont tous fortement teintés d’implications religieuses. L’Ordre Rosicrucien n’est pas sectaire, mais il se consacre aux lois spirituelles et naturelles et son but est de « permettre à tous de vivre en harmonie avec les forces cosmiques créatrices et constructives pour atteindre la santé, le bonheur et la paix ». Max Heindel, qui semble avoir été le chef spirituel de la Rosicrucian Fellowship – son siège est à Oceanside, en Californie, tandis que celui de l’AMORC est à San Jose – qualifie la cosmo-conception rosicrucienne de « christianisme mystique » et, bien qu’il s’écarte largement de la théologie chrétienne orthodoxe dans ses interprétations des doctrines théosophiques et apparentées, il revient constamment à la Bible, à la seigneurie de Jéhovah et à la mission de Jésus. La Société Théosophique compte parmi ses objets l'étude des religions anciennes et modernes, et dans ses écrits on trouve de fréquentes références à la Déité Unique Universelle, au TOUT inconnu et invisible , au Dieu intérieur et à des titres sacrés similaires, bien que dans l'ensemble ils semblent beaucoup plus orientés vers les croyances et les pratiques hindoues que vers les croyances et les pratiques chrétiennes ou judaïques.
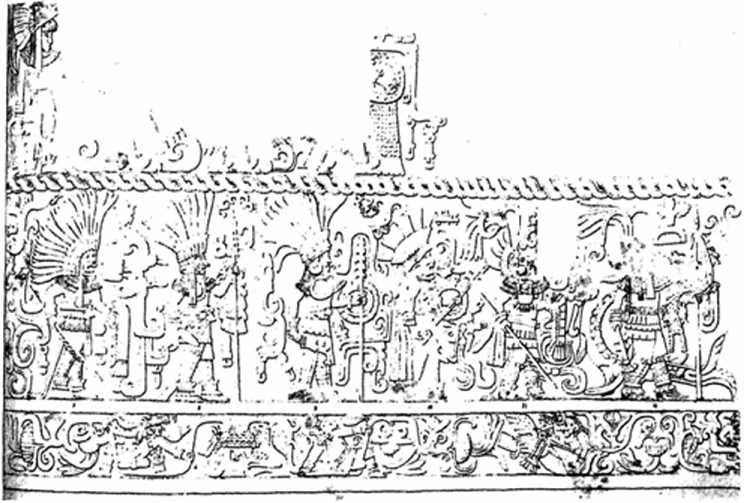
Panneau de lotus animé de figures humaines, provenant d'un mur sculpté de la chambre du Grand Jeu de Balle de Chichen Itza, Yucatan. Le même motif a été utilisé dans l'art hindou-bouddhique. D'après AP Maudslay.

Personnages tenant des sceptres ou des bâtons de lotus et assis dans des positions presque identiques, une jambe repliée en dessous, l'autre suspendue au-dessus du côté du trône.
Gauche : Khasarpana, Inde. D'après B. Bhattacharyya, illustré par CF Ekholm.
À droite : Palenque, Mexique. D'après HA Lavachery.


Personnages assis sur un trône de tigre.
À gauche : Sculpture en pierre, grottes, Inde. D'après B. Bhattacharyya, illustré par CF Ekholm.
Droite : Dalle sculptée, Maison Palatine E, Palcnque, Mexique. D'après AP Maudslay.
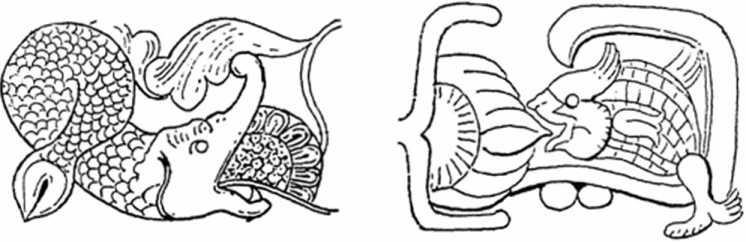


Le motif du nénuphar en Inde (colonne de gauche) et à Chichen Itza, Yucatan (colonne de droite). D'après R. Heine-Geldern et GF Ekholm, illustré par J. Imbelloni.
Les questions racistes et nationalistes se sont aussi glissées dans ce sujet. Nous reconnaissons des variations sur des thèmes familiers. Le Dr HW Magoun, dans son introduction à un long traité linguistique de TS Denisen, le philologue amateur, a décidé que les émigrants du Vieux Monde qui ont atteint les Amériques à l’époque préhistorique étaient probablement des Aryens. « Ils ne pouvaient guère être autre chose. Ils étaient blancs, guerriers et ils naviguaient sur la mer avec confiance. C’étaient donc des hommes doués. Ils étaient à la recherche de nouveaux et meilleurs foyers, et lorsqu’ils ont trouvé ce qui les satisfaisait, ils y sont restés. Or, ce sont tous des traits aryens, et ils l’ont été à travers les âges. Les Sémites migrent aussi : mais c’est généralement le résultat d’une contrainte. . . . Une nécessité qui force à l’obéissance les pousse à partir. . . Epaphras Jones, un professeur de Bible, a écrit en 1831 que quiconque « connaît les Juifs européens et les Aborigènes d’Amérique . . . « Ils percevront une grande ressemblance dans la couleur, les traits, les cheveux, l’aptitude à la ruse, les dispositions à vagabonder, etc. »
Le premier prix du racisme moderne dans ce domaine particulier revient à Lewis Spence, célèbre défenseur de la théorie de l'Atlantide perdue, qui déclara en 1924 que les premiers Atlantes à avoir apporté la civilisation en Europe étaient des Cro-Magnons ; puis :
Si l'on peut pardonner à un Écossais patriote de se vanter, je puis dire que je crois fermement que la supériorité reconnue de l'Écosse dans les domaines mental et spirituel provient presque entièrement du degré prépondérant de sang Cro-Magnon qui coule certainement dans les veines de son peuple, dont la taille et la capacité crânienne, ainsi que d'autres signes physiques, montrent qu'ils sont en grande partie de race Cro-Magnon. L'Angleterre, elle aussi, tire sans aucun doute une grande partie de sa santé mentale, de ses prouesses physiques et de sa supériorité marquée dans les choses de l'esprit de la même source, et si une grande partie de son sang est ibérique, n'est-ce pas trop atlante, et ce mélange ne l'a-t-il pas dotée de manière prééminente des plus grands poètes qui aient jamais touché à la harpe ? À un mélange de sang Cro-Magnon et ibérique nous devons le génie de Shakespeare et de Burns, de Massinger et de Ben Johnson. Milton, Scott et, pour en venir à notre époque, M. HG Wells et M. Galsworthy sont presque purement Cro-Magnon — en fait, nos types littéraires ressemblent fortement au buste soigneusement conçu d’un homme de Cro-Magnon, exécuté sous la supervision scientifique d’un éminent sculpteur belge.
L’ouvrage de Thor Heyerdahl, American Indians in the Pacific, qui soutient son hypothèse du Kon-Tiki , s’attaque à l’idée selon laquelle les migrations de peuples d’Asie et d’Indonésie auraient traversé la Mélanésie ou la Micronésie pour se rendre à Hawaï et aux îles de Polynésie. Il explique que les traits négroïdes des Polynésiens ont été transmis par des esclaves ou des ouvriers mélanésiens amenés là par des Polynésiens à prédominance caucasienne venus du Pérou et de la côte nord-ouest américaine, régions que Heyerdahl a choisies après avoir cherché dans les Amériques des peuples « intelligents » et caucasiens. Parmi les Kwakiutl de la côte nord-ouest, il a trouvé des traits de type polynésien et caucasien, notamment des « traits mentaux ». Le Dr Edward Norbeck, anthropologue, a commenté dans sa critique du livre pour une revue professionnelle : « Il sera difficile pour beaucoup de personnes d’éviter de lire du racisme dans cet ouvrage. »
La théorie des tribus perdues d’Israël sur le peuplement de l’Amérique a également servi de caisse de résonance aux voix racistes, nationalistes et antisémites. Gregorio Garcia, à la fin du XVIe siècle, a consacré la plus grande partie de son Origen de los Indios à la défense de cette théorie, au cours de laquelle, selon Bancroft, il a souligné que les Indiens étaient des lâches comme les Juifs ; que les Indiens, comme les Juifs, n’acceptaient pas facilement la foi chrétienne et étaient donc persécutés et approchaient rapidement de l’extermination ; que les Juifs étaient ingrats pour les nombreuses bénédictions que Dieu leur avait accordées, tout comme les Indiens d’Amérique n’appréciaient pas la gentillesse des Espagnols ; que les Juifs et les Indiens étaient notoirement peu charitables envers les pauvres et les malades, que tous deux étaient naturellement enclins à l’idolâtrie ; que tous deux étaient des menteurs, méprisables, incorrigibles et vicieux ; « Les deux étaient « aptes seulement au travail le plus bas, les Juifs préférant les marmites de viande d’Égypte et une vie d’esclavage à la manne céleste et à la terre promise, tandis que les Indiens choisissaient une vie de liberté et un régime de racines et d’herbes plutôt que ce que les Espagnols leur offraient. » On aurait pu penser qu’au moins cette dernière remarque aurait donné matière à réflexion au père Gregorio, mais ce n’est manifestement pas le cas.
De nombreux membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont également une attitude raciste très marquée à l’égard des personnes à la peau foncée, comme je l’ai constaté à ma grande surprise lorsque j’ai quitté le Sud profond un été pour aller enseigner à l’Université de l’Utah, qui est non sectaire et dont les étudiants sont à moitié non juifs et à moitié mormons. Ce préjugé provient du Livre de Mormon, qui déclare que lorsque les fils de Léhi, Laman et Lémuel, se sont rebellés, Dieu les a maudits, ainsi que leurs descendants amérindiens (Lamanites) à la peau foncée. Plusieurs étudiants de mes cours en Utah ont soutenu avec force que les Noirs ont un crâne plus épais que les Blancs et que, par conséquent, ils ont un cerveau inférieur ; en établissant une corrélation entre un crâne épais et une peau foncée, ils ont conclu que les Indiens aussi étaient handicapés mentalement. Cela ne signifie pas que les mormons ont maltraité les Indiens ou les Noirs, bien au contraire. Comme le montre le non-mormon Thomas F. O'Dea dans son livre le plus sympathique, The Mormons, l'Église a dès le début conçu comme faisant partie de sa tâche la reconversion des Indiens afin qu'ils puissent redevenir un « peuple blanc et agréable », et il dit qu'une attitude généralement favorable envers les Indiens a marqué la vision des choses des mormons depuis lors, une attitude qui a suscité à plusieurs reprises suspicion et hostilité parmi leurs voisins blancs non juifs.
De fortes opinions racistes apparaissent également dans le livre de Max Heindel, Le Rosicrucien. Cosmo-Conception (1929), où il fait dériver les Nègres « et les races sauvages aux cheveux bouclés » du continent perdu de la Lémurie (Mu), occupé à un stade antérieur et plus primitif du développement humain, et les Juifs d’une époque ultérieure sur l’Atlantide, où les êtres humains étaient « plus gouvernés par… la Ruse que par la Raison ». Selon Heindel, les Juifs ont perdu parce qu’ils se sont mariés avec d’autres races atlantes, « apportant ainsi du sang inférieur à leurs descendants » et par conséquent ils n’ont pas pu faire la transition raciale de la Ruse à la Raison. « Chez eux, le sentiment racial est si fort qu’ils ne distinguent que deux classes de personnes : les Juifs et les Gentils. Ils méprisent les autres nations et sont à leur tour méprisés par elles pour leur ruse, leur égoïsme et leur avarice. Il n’est pas nié qu’ils donnent à des œuvres de charité, mais c’est principalement, sinon exclusivement, entre leurs propres peuples et rarement au niveau international. . . . Le rejet du Christ par les Juifs fut la preuve suprême de leur asservissement à la Race. » Il y a bien d’autres discours de ce genre dont Heindel pense que « les peuples occidentaux » devraient tenir compte, « afin qu’ils puissent tirer une leçon de l’effroyable exemple de la race juive telle qu’elle est rapportée dans l’Ancien Testament. » Ce sont bien sûr les races aryennes chez lesquelles Heindel croit que la Raison évolue vers la perfection.
Si quelqu’un est surpris par ce raisonnement, il sera encore plus surpris lorsqu’il se plongera plus avant dans les reconstructions mystiques de l’évolution humaine et de l’histoire des races. Elles diffèrent dans les détails selon les divers ordres, mais toutes suivent le même schéma général et le même point de vue, et on peut obtenir une sorte de moyenne à partir de La Doctrine Secrète de Mme Blavatsky, du Bouddhisme Esotérique d’AP Sinnett , de la Théosophie Moderne de Claude Falls Wright et de La Cosmo-Conception Rosicrucienne de Max Heindel . Pendant quatre périodes principales, « la vague de vie » s’est déplacée d’une chaîne de mondes et d’un globe à un autre – la Période de Saturne, la Période du Soleil, la Période de la Lune et la Période actuelle ou Période de la Terre. La Lune, maintenant une « planète » froide et morte, est condamnée pendant de longs siècles à poursuivre sans cesse la Terre. « Constamment vampirisée par son enfant, elle se venge de lui en l’imprégnant de part en part de l’influence néfaste, invisible et empoisonnée qui émane du côté occulte de sa nature… . . Et comme toutes les goules ou vampires, la lune est l’amie des sorciers et l’ennemie des imprudents. » L’évolution humaine a en fait commencé dans la matière ardente du Soleil qui a plus tard formé la Terre. Les mystiques croient que d’une manière ou d’une autre « l’homme lui-même a construit son premier corps minéral, aidé par les Seigneurs de la Forme ». La Terre a traversé, d’abord, une série de « révolutions » qui ont récapitulé la séquence Saturne-Terre-Lune, suivies d’une série d’époques, dont la troisième était l’époque lémurienne, la quatrième l’époque atlante et la cinquième l’époque actuelle ou aryenne. Au cours de l’époque lémurienne, l’homme a été aidé « à faire les premiers pas chancelants de l’évolution », comme l’a exprimé le rosicrucien Max Heindel, par des êtres beaucoup plus avancés que l’homme sur le chemin de l’évolution ; ils sont venus de Vénus et de Mercure « dans le but de guider notre humanité par l’amour ».
Les mystiques reconnaissent seize « races-racines ». La première d’entre elles, comprenant les Nègres, devint la « semence » des sept races atlantes de l’époque suivante, mais les Lémuriens – ou, comme les occultistes préfèrent le dire, les formes habitées par les Lémuriens – dégénérèrent en sauvages et en anthropoïdes d’aujourd’hui. La quatrième race-racine était celle de l’Atlantide, qui s’éleva là où se trouve aujourd’hui l’océan Atlantique, après que des cataclysmes volcaniques eurent détruit le continent lémurien. Les Toltèques étaient la troisième sous-race atlante, et cet aspect de la théorie mystique l’identifie pour la première fois directement avec une tribu amérindienne, car les Toltèques étaient un groupe ethnique préhistorique du Mexique, dont la capitale se trouvait à Tula, dans ce qui est aujourd’hui Hidalgo. Selon Heindel, les Toltèques développèrent leur mémoire bien au-delà de ses capacités actuelles, faisant appel à elle pour faire l’expérience lorsqu’ils devaient prendre une décision. Les Sémites étaient la cinquième des sept sous-races atlantes, mais ils ont perdu à cause de leur avarice, bien qu'ils soient les ancêtres des Aryens de l'époque actuelle (dans la pensée occultiste, la cinquième).
Selon la théorie mystique, deux autres races vont se développer, l’une d’elles étant les Slaves, y compris le peuple russe, duquel descendra la dernière des sept races de l’époque aryenne. Du peuple des États-Unis naîtra la dernière de toutes les races de cette évolution, et elle dominera au début de la sixième époque. Après cela, il n’y aura plus rien « qui puisse être appelé à proprement parler une race ». Il n’est guère étonnant que les mystiques considèrent les développements mondiaux actuels avec un certain degré d’équanimité, pour ne pas dire de satisfaction suffisante. Étant donné que les croyances mystiques sont censées provenir en grande partie de l’Himalaya, de l’Inde et du Tibet, on se demande pourquoi davantage de peuples de cette région du monde ne se rangent pas plus résolument du côté des États-Unis que de celui de la Russie. Il n’est pas précisé dans la Cosmo-Conception rosicrucienne si les occultistes asiatiques partageront à l’avenir ces croyances avec leurs collègues américains.
Quel est en effet le lien entre la religion, le racisme, le nationalisme et l’origine des Indiens d’Amérique ? N’importe lequel des auteurs cités ici affirmerait sans doute que ses informations l’ont simplement conduit à ces questions et qu’en toute honnêteté il ne pouvait ignorer les résultats. Mais en considérant ces auteurs dans leur ensemble, nous avons noté que pour certains d’entre eux, la préhistoire des Indiens d’Amérique favorise une église, pour d’autres une autre foi, et pour d’autres encore un ensemble complètement différent de croyances religieuses, théologiques, raciales ou nationalistes. La seule chose qu’ils ont réellement en commun est un intérêt démesuré pour la religion, la race ou le patriotisme national.
Ces dernières années, les spécialistes des religions ont commencé à formuler leurs croyances religieuses ou théologiques sous forme d’hypothèses, puis à se limiter à des méthodes empiriques pour les tester. Certains mormons, en particulier, soumettent leurs croyances religieuses sur le passé des Indiens d’Amérique au test de l’archéologie, et tant qu’ils restent dans les limites des règles scientifiques, au moins quelques anthropologues non juifs se sont montrés disposés à coopérer. Les anthropologues physiques et les psychologues ont également manifesté un intérêt constant pour tester les théories sur la race – mais par des méthodes empiriques et non en citant des livres sacrés.
Quand les connaissances d'un homme ne sont pas en ordre, plus il en a, plus grande sera sa confusion.
— Hébert Spencer
Martin Gardner, dans son excellent livre Fads & Fallacies in the Name of Science, a découvert que les pseudo-scientifiques excentriques décrits dans son premier chapitre ont certains traits en commun. Tout d’abord, l’excentrique travaille presque totalement isolé de ses collègues et, deuxièmement, il a une tendance à la paranoïa qui peut se manifester de cinq façons : il se considère comme un génie ; il considère ses collègues comme des idiots ignorants ; il se croit injustement persécuté et discriminé ; il choisit les plus grands scientifiques et les théories les mieux établies pour les attaquer ; et il écrit dans un jargon complexe. La plupart des défenseurs de ce que les anthropologues professionnels considèrent comme les « théories farfelues » des origines amérindiennes sont qualifiés de pseudo-scientifiques selon tous ces critères et partagent également certaines autres caractéristiques. Les anthropologues orthodoxes se plaignent que ces gens ne font aucun effort pour organiser leurs pensées ou leurs données de manière ordonnée — à l’exception peut-être de Lewis Spence et d’Ignatius Donnelly —, qu’une chose en entraîne une autre indéfiniment, qu’ils ne recherchent pas d’autres buts que religieux et ne s’intéressent donc pas aux preuves, et par conséquent pas aux méthodes empiriques.
L'historien Hubert Howe Bancroft, par exemple, a écrit à propos de l'abbé Brasseur de Bourbourg, qu'il admirait beaucoup malgré le fait que l'abbé soit passé d'une vie d'érudition à une vieille époque de spéculations irresponsables sur l'Atlantide et le mysticisme des Indiens du Mexique :
Je n’ai pas l’intention de m’aventurer ici dans les méandres de l’argumentation de Brasseur ; une fois dans ce labyrinthe, il y aurait peu d’espoir d’en sortir. Ses Quatre Lettres sont un fouillis chaotique de faits et de spéculations sauvages qui effrayeraient l’antiquaire le plus enthousiaste ; les matériaux sont disposés sans le moindre souci d’ordre ; le lecteur est continuellement harcelé par de longues digressions décousues – des impasses littéraires en quelque sorte, dans lesquelles il est entraîné dans l’espoir d’en sortir quelque part, pour se retrouver plus désespérément perdu que jamais ; pour preuve mythologique, les panthéons de Phénicie, d’Égypte, d’Hindoustan, de Grèce et de Rome sont sondés dans leurs profondeurs les plus obscures.
Deux jours après l’annonce de l’envoi d’une expédition archéologique de l’université de Tulane au Yucatan, nous avons reçu de Boston une lettre de trois pages, dactylographiée à simple interligne, dont aucun paragraphe n’avait de sens par rapport à un autre, ni même en lui-même, mais qui, comme un double langage, en avait presque un si on le lisait assez vite. Cela m’a rappelé désagréablement une longue soirée que nous avions passée, il y a plus de vingt ans, avec un collègue de l’université de Géorgie, à écouter les commentaires sincères et ininterrompus d’un mystique sur plusieurs centaines de diapositives de symboles d’inscriptions anciennes ; lorsqu’il avait terminé, nous nous sommes rendu compte que tout cela n’avait abouti à absolument rien. Voici, mot pour mot, trois des vingt-huit paragraphes de notre correspondant de Boston :
Dans le problème global, si complètement obscurci par la destruction des archives et autres par la faction espagnole, il y a une petite quantité de matériel que même Spinden ne voulait pas (ou ne pouvait pas faire publier) et qui porte sur le problème global.
D'où la détérioration du « sacrifice humain » au Mexique ; après le « dogme » d'Anselme et le dogme de Thomas d'Aquin, rendu public après 1000 après J.-C. La faction « Donus Scotus » s'opposa à cette notion « de ce côté-ci » de l'étang ; mais eut moins d'utilité pour « l'avidité de l'Espagne » après 1492 ; d'où le célèbre exploit de John Decosa Guidio de Nina de Colomb ; et l'affaire « Piri Reis » ; qui à son tour (après le décès de son ami de La Porte) apparut en Flandre comme le marin de Sir Thomas More : cité dans A Short History of England : — par Greene ; indexé sous Sir Thomas More. La suite naturelle jusqu'à Tom Paine est évidente ; et la réaction à « L'Âge de raison » est bien connue.
En fait, une balle de peaux de vison de première qualité du nord du Canada valait plus dans les « harems » (cours d'Angleterre à la Louis VIXe, etc.) que son poids équivalent en or ; ce qui, en tant que légende familiale, nous amuse même en 1957. Aucun historien honnête n'oserait expliquer sous quel angle l'or n'avait aucune valeur (ce n'était PAS une marchandise légale dans les régions mayas, aztèques et incas), mais la suite de « L'Alchimiste » de Ben Johnson, Londres, Angleterre, 1610 (j'ai la réimpression de l'époque de 1880) en est la preuve.
Bien que ce charabia dépasse clairement la frange lunatique, il illustre très bien certaines caractéristiques des mystiques qui se plongent dans les traditions amérindiennes. Il est rédigé dans ce que son auteur considère comme du jargon scientifique ou, plus probablement, historique ; il parle sciemment des idées fausses et ineptes d'autres personnes ; il laisse entendre de manière obscure que certains éminents érudits suppriment des informations ; bien que complètement désorganisé, il reflète néanmoins une certaine quantité de lectures sérieuses de la part de l'auteur ; pour autant que je sache, il ne dit absolument rien.
Même Thor Heyerdahl, dont le best-seller Kon-Tiki et Aku-Aku lui a valu une réputation bien méritée de maître du récit d’aventure, a tenté d’expliquer ses théories dans un autre ouvrage universitaire, American Indians in the Pacific, en utilisant 763 pages de texte pour présenter une hypothèse assez simple et une quantité de preuves pas écrasante en sa faveur. Son critique dans American Antiquity, le Dr Edward Norbeck, s’est plaint : « … on peut dire que cet ouvrage est mal organisé et extrêmement répétitif. On a l’impression qu’une masse de notes ou le brouillon d’un manuscrit a été publié d’une manière ou d’une autre. »
Les professionnels, qui ont tendance à écrire dans un style qui semble souvent inutilement terne, ne sont pas aidés par le fait que leurs rivaux moins inhibés embellissent des reconstitutions historiques non documentées dans la prose la plus entêtante. Selon la version de George Jones, les marins phéniciens débarquant dans l'Amérique préhistorique « sont arrivés dans une joie joyeuse » et
« ... les étoiles toujours tracées sur le mur d'azur du dôme extérieur, et leur Apollon s'enfonçant chaque jour sur sa couche occidentale, et leur faisant signe, avec son dernier regard, de continuer son chemin, - cette connaissance et leur adoration religieuse les conduisirent en sécurité vers cette terre vierge où le soleil glorieux de l'aube de la création n'avait jamais brillé sur une empreinte de pied humaine, jusqu'à ce que la leur ait embrassé le rivage intact de la Floride ! Là, Flora et ses nymphes, dans toute leur beauté incomparable et les vêtements de la nature elle-même, étaient groupées sur chaque colline ; de leurs lèvres colorées, la Bienvenue souriante exhalait son encens incessant de chaque monticule et de chaque vallée, qui, sur les ailes du Zéphyr, enivraient de santé et de joie les Fils et les Filles d'une mer lointaine qui approchaient, dont les chants sauvages de louange au magnifique Apollon étaient portés par leur Orient et fidèle envoyé vers le rivage vêtu de vagues. . . .
Dix ans après que Sir George eut composé ces lignes exaltantes, sa théorie phénicienne fut reprise par Pablo Felix de Cabrera, du Guatemala, qui souscrivit à une longue histoire sur un improbable voyageur du monde nommé Votan, qui descendrait d'Hercule, un voyageur de taille non négligeable lui-même. Lorsque Don Pablo décida que Votan avait été assassiné par son frère Typhon, il se mit en colère :
Impie et inhumain Typhon, que ta mémoire soit maudite d'une haine interminable, pour avoir osé souiller tes mains meurtrières du sang de ton frère et de ton roi, laissant ainsi à la postérité l'exemple exécrable d'un double crime si horrible : ton ambition a porté un peuple poli à rompre les liens les plus sacrés, à se précipiter dans les plus grandes atrocités, à ternir la gloire de ses ancêtres et à déshonorer sa nation !
Pour James Churchward, les colibris du continent perdu de Mu s’élançaient « çà et là, de fleur en fleur » et « les chanteurs à plumes dans les buissons et les arbres rivalisaient entre eux de leurs doux chants », et pour presque tous les chroniqueurs de l’Atlantide ou de Mu, les entrailles de la terre grondaient et rugissaient tandis que des feux souterrains faisaient exploser le continent tout entier et que la mer s’y ruait pour faire taire à jamais une ancienne civilisation, ou des mots dans ce sens. Il semble presque impossible de résister à cette façon d’écrire sur l’Atlantide. Même le capitaine Gilbert Rude, dans un article de 1940 de l’US Naval Institute consacré à des sujets aussi prosaïques que les échosondeurs, les méthodes de fil tendu, les lignes de boîte et les angles d’inclinaison, pouvait rapidement passer à l’idiome du continent perdu : Les ports maritimes atlantes autrefois florissants sont maintenant des villes de silence, leurs constructeurs oubliés. Là où battait le pouls d'une puissante civilisation, les habitants des profondeurs nagent désormais paresseusement. Les palais, autrefois théâtres de la jeunesse et des rires, ne sont plus que des tombeaux creux ; les temples ne résonnent plus des paroles de sagesse des prêtres. La magnificence et la richesse de l'Atlantide ont disparu en une seule nuit lors de la grande catastrophe finale. L'île-continent a été secouée par des tremblements de terre, les volcans ont vomi la destruction et les vagues sismiques de la mer ont prêté leur puissance martelante. La terre s'est lentement affaissée sous les eaux bouillonnantes pour devenir le continent du mystère.
Pour les historiens et les spécialistes des sciences sociales, qui tentent d’éliminer de leurs écrits ce qu’ils appellent des « jugements de valeur », cette phraséologie luxuriante est répugnante et suspecte. Quant aux auteurs occultistes sérieux, qui laissent à leurs disciples le style léger et fantaisiste, leur idiome est si spécialisé que même lorsque l’anthropologue professionnel moderne fait un effort consciencieux pour lire et digérer ce qu’ils ont à dire, il abandonne souvent et admet sa défaite. Les lecteurs du Rosicrucian Digest et du Theosophical Quarterly ne semblent pas éprouver cette difficulté. Les articles de ces revues couvrent une large gamme de styles et de complexité, mais les plus simples n’hésitent pas à citer les grands maîtres mystiques – comme H. Spencer Lewis ou Mme HP Blavatsky (connue des initiés sous le nom de HPB) – écrivant à leur plus haut degré ésotérique. Voici un extrait de HPB tiré du Quarterly :
Parabrahman, la Réalité Unique, l'Absolu, est le champ de la Conscience Absolue, c'est-à-dire cette Essence qui est hors de toute relation avec l'existence conditionnée et dont l'existence consciente est un symbole conditionné. Mais une fois que nous passons en pensée de cette Négation Absolue (pour nous), la dualité survient dans le contraste de l'Esprit (ou Conscience) et de la Matière, du Sujet et de l'Objet. L'Esprit (ou Conscience) et la Matière doivent cependant être considérés, non comme des réalités indépendantes, mais comme les deux symboles ou aspects de l'Absolu, Parabrahman, qui constituent la base de l'Être conditionné, qu'il soit subjectif ou objectif. L'Univers Manifesté est donc pénétré de dualité, qui est, pour ainsi dire, l'essence même de son Existence en tant que Manifestation. Mais de même que les pôles opposés du Sujet et de l'Objet, l'Esprit et la Matière, ne sont que des aspects de l'Unité Une dans laquelle ils sont synthétisés, de même, dans l'Univers Manifesté, il y a « cela » qui relie l'Esprit à la Matière, le Sujet à l'Objet. Ce quelque chose, jusqu'à présent inconnu de la spéculation occidentale, est appelé par les occultistes Fohat. C'est le « pont » par lequel les Idées existant dans la Pensée Divine sont imprimées sur la Substance Cosmique en tant que Lois de la Nature... l'énergie dynamique de l'Idéation Cosmique.
Le théosophe défenseur de l'Atlantide, Eugen Georg, conclut ainsi L'Aventure de l'humanité, un livre de 1931 consacré en grande partie à l'étude de l'Amérique atlante :
Le chemin est terminé.
L'ère cosmique est terminée. Le rythme éternel est passé à l'équilibre : le Démiurge omnipotent est devenu relatif-absolu, transitoire-intemporel, imparfait-parfait. Le désir d'équilibre est comblé. Le statique a remplacé le dynamique. Le royaume de la paix et du repos est maintenant revenu. La conscience du monde s'est immergée dans la nuit sacrée de Brahma.
Telle est l’essence du grand mystère !
Tel est le sens de l’équilibre !
Voici la phrase de l'entropie magique :
L'ÉVOLUTION DU MONDE S'EFFORCE D'UN MAXIMUM D'AMOUR !
LA FIN
Le volume XII de la Bibliothèque Rosicrucienne est présenté par la Rosicrucian Press dans ces termes :
Sous les vagues agitées de la mer se cachent les mystères de civilisations oubliées. Balayés par les marées, à moitié enfouis dans le sable, érodés par une pression terrible, se trouvent les vestiges d'une culture peu connue de notre époque. Là où le puissant Pacifique s'étend aujourd'hui sur des milliers de kilomètres, il y avait autrefois un vaste continent. Cette terre était connue sous le nom de Lémurie, et ses habitants sous le nom de Lémuriens. ... Si vous aimez le mystère, l'inconnu, l'étrange, lisez ce livre. N'oubliez pas, cependant, que ce livre n'est pas une fiction, mais qu'il est basé sur des faits, le résultat de recherches approfondies.
Mme Blavatsky, défunte chef spirituelle des théosophes, soutenait avec force que la « Doctrine Secrète enseigne l’histoire – qui, bien qu’ésotérique et traditionnelle, n’en est pas moins plus fiable que l’histoire profane… »
Lewis Spence écrit sur la première page du Problème de l’Atlantide : « Une hypothèse doit, dans tous les cas, être confirmée ou rejetée par la nature des preuves apportées à son appui, et j’ai cherché à rendre celle-ci aussi irréprochable que les circonstances très difficiles le permettent. » Mais sur la dernière page du même livre, il écrit :
Mais si pauvre que soit mon témoignage, l’intuition qui l’a inspiré reste puissante et irréfutable, indestructible, en vérité, comme la mémoire universelle de cette ancienne et originale culture que j’ai tenté de dévoiler. Oui, il y a bien plus que de simples preuves matérielles à prendre en considération en relation avec des questions telles que celle dont nous avons discuté. L’Atlantide dort sous les mers. Mais ni la raison seule, ni l’appareil de l’érudition ne suffiront, en fin de compte, à sonder ses anciens mystères. Des hommes perspicaces ont écrit sur d’étranges visions et sur des communications surnaturelles encore plus étranges qui leur ont été accordées au sujet de sa vie primitive.
De quelle science-fiction s’agit-il ? demandent les professionnels exaspérés. Comment peut-on d’un côté professer la méthode scientifique et de l’autre attribuer l’autorité ultime à la mémoire du monde et à la communication surnaturelle ? Ils ne comprennent pas pourquoi le mormon Lewis Edward Hills, écrivant sur l’archéologie américaine en 1924, a consacré tant d’efforts à la localisation « scientifique » des noms de lieux néphites au Mexique alors qu’il a finalement écouté une voix surnaturelle qui lui a parlé et lui a indiqué où chercher sur sa carte de Rand McNally. Ils sont impuissants devant la solution simple du professeur de Bible Epaphras Jones pour sortir de la difficulté d’amener les Israélites dans le Nouveau Monde : « Les dix tribus devaient être dispersées dans le monde entier. Dieu pouvait accomplir cela à sa manière – Ésaïe 11. » Ils ne peuvent pas comprendre ce qui a poussé Robert B. Stacy-Judd à attacher une signification surnaturelle au simple événement qu’il a décrit dans son livre sur les anciens Mayas. En visitant un camp archéologique à Uxmal, après une fête joyeuse au cours de laquelle des quantités considérables de rhum furent consommées par tous les présents, Stacy-Judd et l’archéologue responsable passèrent la majeure partie de la nuit à discuter « comme seuls deux hommes le font dans des endroits silencieux ». Plus tard, dans l’éclat du clair de lune argenté, « spontanément, sans préméditation, chacun se tourna instantanément et se fit face. Puis chacun, la main droite sur l’épaule gauche, s’inclina devant l’autre, en se penchant en avant à partir des hanches ». Stacy-Judd expliqua à bout de souffle qu’il s’agissait d’une ancienne salutation maya, une coutume vieille de plusieurs milliers d’années, rapportée dans les ouvrages mayas de la région sud, mais pas encore découverte là où ils se trouvaient dans le nord du Yucatan. Pour son hôte archéologue, la coutume était connue, mais Stacy-Judd l’ignorait. « Qu’est-ce qui a motivé ce simple geste ? Les âmes inspirées de cette race disparue étaient-elles présentes et en sympathie avec notre quête ? En réalisant la vie charmante que j'ai menée face aux nombreuses aventures et expériences qui m'ont frappé, surtout après avoir quitté Uxmal, je ne peux m'empêcher de sentir que leur influence protectrice était toujours à mes côtés.
L’ouvrage Aku-Aku de Thor Heyerdahl parvient toujours à donner l’impression que des forces étranges et secrètes rôdent autour de l’île de Pâques, de ses habitants et des scientifiques qui y étudient. Le magazine Time a déclaré que le livre « a des connotations de récit de voyage, de mystère et de menace qui semblent rarement justifiées par les événements décrits ». Nigel Nicolson a écrit dans le New Statesman : « Ce qui est déconcertant dans sa méthode, c’est son habitude d’accepter l’explication romantique de faits encore déroutants ».
L’ancien dirigeant suprême et empereur de l’Ordre rosicrucien, H. Spencer Lewis, annonçait au lecteur ce à quoi il devait s’attendre dans l’un de ses livres : « Les rosicruciens… ne dépendent pas des règles de la science pour la découverte et la vérification des lois et des principes naturels. Ils ont leur propre méthode pour prouver la vérité ou la valeur d’un principe, et cette méthode leur permet de parvenir rapidement à la bonne conclusion et avec moins de risques d’erreur de jugement que par la méthode scientifique. »
Les anthropologues professionnels admettent qu’ils envient une méthode de recherche qui permet à la théorie de s’adapter si facilement à l’hypothèse. Stacy-Judd, lorsqu’il a dû rendre compte de cinq populations différentes en Eurasie et dans les Amériques, l’a fait simplement en affirmant que l’Atlantide avait subi cinq effondrements et bouleversements différents avant de disparaître définitivement. Pourtant, bien que déconcertés par ce qui leur semble être une incapacité à distinguer l’empirisme de l’intuition, offensés par l’idiome luxuriant, provoqués par les accusations souvent acerbes portées contre eux dans les journaux par des amateurs et rebutés par les motivations nationalistes, racistes et religieuses si souvent apparentes dans ces écrits, les anthropologues d’aujourd’hui ne croient pas que les « théoriciens sauvages » soient tous délibérément malhonnêtes – seulement ceux qui prétendent avoir découvert des tablettes anciennes ou avoir vu des cités perdues qui ont disparu à nouveau avant que le public ait pu les examiner. Ils considèrent les mystiques plutôt comme des accros au signe, à l’image, à la forme et au mot, et aux sujets enivrants des cités en ruines, des tribus perdues et des continents engloutis.
L’amie intime de Mme Alice Le Plongeon, à qui elle confia ses notes archéologiques secrètes alors qu’elle était en train de mourir, interrompt de volumineuses lettres racontant ce qu’elle savait de ces documents par ces mots presque totalement hors de propos : « Vous intéressez-vous aux symboles ? Ou aux récits de l’Atlantide perdue ? Je crois fermement que les Mayas sont originaires de l’île d’Atlantide, les îles des Açores étant les sommets de la chaîne de montagnes aujourd’hui submergées. » Jennings C. Wise pense que même la forme des continents peut être d’une certaine manière symbolique. En 1945, il écrivait : « Aujourd’hui, nous constatons qu’une glaciation s’est produite au Secondaire lorsque l’ancien continent en forme d’oiseau a pris la forme jurassique. Connaissant l’implication du Phénix et de l’œuf représenté dans la bouche du Cénubis gréco-égyptien, nous ne pouvons manquer de noter la forme symbolique du continent en forme d’oiseau du Primaire. »
Les professionnels considèrent ces gens comme dangereux uniquement dans la mesure où leurs écrits extrêmement populaires persuadent tant de personnes intellectuellement imprudentes que la recherche n’est qu’un processus de manipulation des faits, de l’intuition et de l’imagination à parts à peu près égales. Ils sont troublés de constater que, comme l’a déclaré Lewis Spence lui-même, aucune protestation scientifique ne semble capable d’ébranler la conviction mondiale de l’existence antérieure de l’Atlantide. Personne, a déclaré un éditeur critique des Dialogues, ne savait mieux que Platon comment inventer « un noble mensonge ». Pourtant, le monde, « comme un enfant, a accepté facilement et pour la plupart sans hésitation l’histoire de l’île d’Atlantide ». Un autre aspect de toute cette situation que déplorent les anthropologues professionnels est la tendance qu’ont des hommes qui semblent par ailleurs tout à fait sains et respectés dans une autre profession à se lancer dans des théories « sauvages » sur les origines des Indiens d’Amérique. Neuman, Brinton, McCulloh, Le Plongeon et Elliot Smith étaient docteurs en médecine, James Kennedy était avocat, Harold S. Gladwin un homme d'affaires, Thor Heyerdahl un zoologiste amateur, Brasseur de Bourbourg un prêtre, TS Denisen un imprimeur, Thomas A. Willard un fabricant de piles, Rufus Dawes un homme politique.
WH Dall écrivait en 1885 :
Des volumes ont été remplis des plus enthousiastes âneries par des hommes dont les capacités et la santé mentale dans d’autres domaines n’ont jamais fait de doute. Heureusement, l’ère de telles spéculations est révolue. . . . Les « dix tribus perdues » subsistent encore parmi nous, et continueront sans doute de le faire pendant un certain temps, devenant probablement à leur tour l’objet d’investigations de psychologues intéressés par les phénomènes mentaux aberrants. . . [mais] le jour n’est pas loin où les hommes possédés par des passe-temps anthropologiques absurdes ne seront plus autorisés à les exposer patiemment devant des organismes scientifiques, mais seront placés sur la même liste que les quadrateurs de cercles et les découvreurs du mouvement perpétuel.
De plus, le scientifique professionnel grince des dents parce qu'il se rend compte que le public versera un soutien financier aux projets les plus fantastiques lorsque ceux-ci sont présentés dans le langage richement passionnant des Continents perdus et des Tribus perdues, et ennoblis par des expositions pseudo-scientifiques de symbolisme et de mysticisme qui sont tellement plus acceptables que les plats fades qu'il propose habituellement. ED Merrill écrivait dans l'American Scholar en 1936 :
Le sujet constitue une source permanente de contenu pour les écrivains populaires, qui insistent constamment sur les similitudes et les similitudes supposées entre les premières civilisations des deux hémisphères. « Lien entre les Aztèques et les Chinois », « Les momies péruviennes pointent vers un continent perdu » et d’autres titres du même genre trahissent trop souvent le fait qu’un explorateur entreprenant du Mexique, du Yucatan, de l’Amérique centrale, de la Bolivie ou du Pérou, ou son attaché de presse, se prépare à inciter le public à fournir des fonds supplémentaires pour soutenir de futurs raids dans les régions sauvages de la nature et de la fiction.
Il est regrettable pour les universitaires professionnels, dont les livres sont généralement subventionnés parce qu'ils ne trouvent pas de public, que les éditeurs et les auteurs de non-sens mystiques s'enrichissent de petites fortunes. La dernière carte postale annonçant l'une de ces absurdités vient de me parvenir :
LES CHAÎNONS MANQUANTS DE L'HISTOIRE
2e livre élargi par BJ Harrington
Rapprocher davantage l’histoire, la science et la religion
Couvrant la période du Dieu Créateur 200 000 av. J.-C., apportant un éclairage considérable sur une civilisation antérieure rivalisant avec la nôtre.
Expliquer de nombreux mystères.
Histoire maçonnique depuis le premier avènement de l'homme jusqu'à nos jours.
Première colonie amérindienne 148 000 av. J.-C.
L'Empire Akkadien aurait existé en 114 000 av. J.-C. Les Phéniciens commerçaient avec les Mayas en 3104 av. J.-C.
L'Amérique est plus vieille de plusieurs milliers d'années que l'Égypte. Enterrements égyptiens au Mexique.
300 pages 65 illustrations
3,50 $ post-payés
Votre Librairie ou
RAINBOW PUBLISHING CO. 3819 Walnut Street Kansas City 11, Mo.
Ceux qui ont lu un grand nombre de ces livres à succès attestent qu’ils manquent de valeur littéraire et que, dans de nombreux cas, même le sujet sordide est présenté de manière terne. C’est donc le sujet lui-même qui doit attirer les mystiques par milliers : les mots Histoire, Science et Religion, Mystères, Franc-maçonnerie, Empire akkadien, Phéniciens et Mayas, Égypte et 200 000 av. J.-C. Pourtant, pour l’anthropologue, l’hypothèse du détroit de Béring et ses implications englobent l’une des plus grandes sagas de toute l’histoire humaine. Il souligne que l’homme était un animal essentiellement tropical et qu’il a dû se libérer de son habitat et de son économie méridionaux ; par la persévérance, l’invention et le courage, il s’est adapté aux plaines, steppes et toundras d’Asie centrale et de Sibérie du Nord, si différentes les unes des autres, devenant un chasseur de gros gibier des prairies avec ses lances à pointe de pierre et ses bâtons de jet.
Cette révolution fut l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité, disent les scientifiques, et la recherche des puissants motifs qui ont poussé l'homme, créature essentiellement conservatrice, à se déplacer, quelques kilomètres ici, quelques autres là, une génération ici, un siècle là, jusqu'à ce qu'il découvre et peuple une paire de continents entièrement nouveaux qui n'avaient pas été redécouverts pendant des milliers d'années, et y construise certaines des plus grandes civilisations antiques du monde, devrait être pour les professionnels comme pour les amateurs un roman policier palpitant basé sur une intrigue imaginative, avec des acteurs aussi dramatiques que convaincants. Cependant, le scientifique n'a pas vraiment concouru pour le public lecteur ; l'anthropologue professionnel moyen ne peut pas ou ne veut pas écrire le genre de livre que les gens en grand nombre voudront lire. Pour la plupart, il a cédé cette fonction, généralement avec une certaine condescendance, au journaliste, à l'écrivain de livres de voyage, au sensationnaliste et au mystique dévoué, qui tous préféreront, n'importe quand, un continent perdu, une tribu perdue ou une cité perdue, à Lo le pauvre Indien pataugeant dans la neige et les siècles vers son destin culturel.
GÉNÉRAL
Baldwin, John D. L'Amérique ancienne. New York : Harper & Brothers, 1872.
Bancroft, Hubert Howe. Les races indigènes, vol. V : Histoire primitive. San Francisco : The History Co., 1886.
Bradford, Alexander W. Antiquités américaines et recherches sur l'origine et l'histoire de la race rouge. New York : Dayton & Saxton, 1841.
Brunswick, Johann Dan. depuis. À propos des vieux monuments américains. Berlin : G. Reimer, 1840.
Brine, Lindesay. Voyages parmi les Indiens d'Amérique : leurs anciens ouvrages en terre et leurs temples. Londres : Sampson Low, Marston & Co., 1894.
Brinton, Daniel G. American Hero-Myths. Philadelphie : II. C. Watts & Co., 1882.
Dixon, Roland B. La construction des cultures. New York : Charles Scribner's Sons, 1928.
Drake, Samuel G. Le Livre des Indiens ; ou, Biographie et histoire des Indiens d'Amérique du Nord, depuis sa première découverte jusqu'à l'année 1841. 9e cd. Boston : Benjamin B. Mussey, 1845.
Gardner, Martin. Modes et erreurs au nom de la science. New York : Dover Publications, Inc., 1957.
Imbelloni, J. Le deuxième sphinx de l'Indiana. Buenos Aires : Librairie Hachette, 1956.
Johnson, Willis Fletcher. « Les pionniers de la recherche maya », The Outlook, CXXXIV (25 juillet 1923), 474-75.
Kennedy, James. Origine probable des Indiens d'Amérique. Londres : E. Lumley, 1854.
McCulloh, James H. Recherches sur l'Amérique, tentative de régler certains points relatifs aux aborigènes d'Amérique, etc. Baltimore : Jos. Robinson, 1817.
Mackintosh, John. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et l'origine des Indiens d'Amérique du Nord. Toronto : W.J. Coates, 1836 (Le même livre est paru plus tard sous le titre : John McIntosh. L'origine des Indiens d'Amérique du Nord. New York : Nafis & Cornish, 1843.)
Payne, Edward John. Histoire du Nouveau Monde appelé Amérique. Oxford : Clarendon Press, 1899.
Prêtre, Josiah. Antiquités américaines. Albany : Hoffman & White, 1883.
Shipp, Barnard. Les Indiens et les antiquités d'Amérique. Philadelphie : Sherman & Co., 1897.
Short, John T. Les Nord-Américains de l'Antiquité. New York : Harper & Bros., 1880.
Stacy-Judd, Robert B. Les anciens Mayas : Aventures dans les jungles du Yucatan. Los Angeles : Haskell-Travers, Inc., 1934.
Thiersant, P. Dabry de. De I'Origine des Indiens du Nouveau-Monde el de leur Civilisation. Paris: Ernest Lcrous, 1883.
PHÉNICIENS
Cabrera, Pablo Félix de. (Voir Rio ci-dessous.)
Caffarel, Paul. “Les Pheniciens en Am6rique,” / Congres International des Americanistes, I, 93-131. Nancy: G. Crepin-Leblond; and Paris: Maisonneuve et Cie, 1875.
Jones, George. Une histoire originale de l'Amérique aborigène. New York : Harper & Bros., 1843.
Newman, John B. Origine de l'Homme Rouge. New York : John C. Wells, 1852.
Rio, Antonio del et Paul Felix de Cabrera. Description des ruines d'une ancienne ville découverte près de Palenque. Londres, 1822.
Vasquez, Pedro. Mémoires d'une expédition mouvementée en Amérique centrale aboutissant à la découverte de la cité idolâtre d'Iximaya. .. New York : JW Bell, 1850.
L'ÉCYPTE EN AMÉRIQUE
Brasseur de Bourbourc, Charles Stephen. Quatre Lettres sur Le Mexique. Paris: F. Brachet, 1868.
Campbell, John. « Les traditions des races anciennes du Pérou et du Mexique identifiées à celles des peuples historiques de l’Ancien Monde », I Congrès international des américanistes, I, 348-67. Nancy : G. Crépin-Leblond ; et Paris : Maisonneuve et Cie, 1875.
Coon, Carleton S. Critique du livre « I Looked for Adam » de Herbert Wendt, Man, mars 1957.
Le Plonceon, Alice. Le talisman de la reine Moo : la chute de l'empire maya. New York : Peter Eckler, 1902.
Le Plonceon, Augustus L. Communication archéologique sur le Yucatan. Worcester : C. Hamilton, 1879.
------. Inscriptions Mayapan et Maya. Worcester : C. Hamilton, 1881.
------. La reine Moo et le sphinx égyptien. New York : l'auteur, 1900.
Salisbury, Stephen, Jr. Les Mayas, les sources de leur histoire. Dr. LcPlongeon au Yucatan. Worcester : Charles Hamilton, 1877.
Smith Alumnae Quarterly, août 1958, p. 239.
Smith, G. Elliot. Éléphants et ethnologues. Londres : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. ; et New York : EP Dutton & Co., 1924.
------. Histoire de l'humanité New York : WW Norton & Co., 1929.
Verrill, A. Hyatt. Anciennes civilisations du nouveau IF ou Id. Indianapolis : The Bobbs-Merrill Co., 1929.
Verrill, A. Hyatt et Ruth Verrill. Les civilisations anciennes de l'Amérique. New York : GP Putnam's Sons, 1953.
ATLANTIS ET MU
Adams, Herbert B. « Vie et œuvres de Brasseur de Bourbourg », Proceedings of the American Antiquarian Society, VII, 274-90. Worcester, 1891.
Blacket, WS Recherches sur les histoires perdues de l'Amérique. Londres : Trubner & Co., 1883.
Brasseur de Bourbourc, Charles Stephen. (Voir ci-dessus L'Egypte en Amérique .)
Buelna, Eustaquio. L'Atlantide et le dernier Tule Mexique : Secrétaire au Développement, 1895.
Cerve, WS Lcmuria — Le continent perdu du Pacifique. San Jose, Californie : Rosicrucian Press, sd
Chil y Naranjo. “L’Atlantide,” I Congres International des Americanistes, I, 163-66. Nancy: G. Crepin-Leblond; and Paris: Maisonneuve et Cie, 1875.
Churchward. James. Les forces cosmiques de Mu. New York : Ives Washburn, Inc., 1934.
------. Le continent perdu de Mu. New York : Ives Washburn, Inc., 1932.
Donnelly, Ignace. Atlantis : le monde antédiluvien. New York : Harper & Bros., 1880.
Hoskins, William Walton. Atlantis et autres poèmes. Philadelphie : Sherman & Co., 1881.
Howard, George. « À la recherche du continent perdu sous l’Atlantique », Rosicrucian Digest, XXVIII (août 1950), 248-51.
Merrill, ED « Sabordage d'Atlantis et de Mu », American Scholar, III (1936), 142-48.
Rude, Gilbert. « A Survey of Atlantis », US Naval Institute Proceedings, vol. LXVI, n° 8, n° 450 (août 1940), pp. 1105-23. Annapolis.
Spence, Lewis. L'Atlantide en Amérique. Londres : Ernest Benn, Ltd., 1925.
------. Le problème de l'Atlantide. Réd. rév. New York : Brentano's, 1925.
Willard, RA (Théodore). La Cité du Puits Sacré. Londres : Willaim Heinemann, Ltd., 1926.
Wilson, Sir Daniel. L'Atlantide perdue et autres études ethnographiques. New York : Macmillan & Co., 1892.
Les Israélites en Amérique
Adair, James. Histoire des Indiens d'Amérique. Londres : E. et C. Dilly, 1775.
Bertrand, LA Mémoires d'un Mormon. Paris : E. Jung-Treuttel, et Blumenthal, Walter Hart. Dans la vieille Amérique. New York : Walton Book Co., 1931.
Boudinot, Élias. Une étoile à l'ouest ; ou, une humble tentative pour découvrir les dix tribus d'Israël depuis longtemps perdues, en vue du retour à leur ville bien-aimée, Jérusalem. Trenton, NJ : D. Fenton, S. Hutchinson et J. Dunham, 1816.
Drake, Samuel G. (Voir Général ci-dessus.)
Fercuson, Thomas Stuart. Un troupeau et un berger. San Francisco : Books of California, 1958.
Garcia, Grégorio. Origine des Indiens du Nouveau Monde et des Antilles. Madrid : FM Abad, 1729.
Godbey, Allen H. Les tribus perdues, un mythe : suggestions pour réécrire l'histoire hébraïque. Durham, Caroline du Nord : Duke University Press, 1930.
Hills, Lewis Edward. Nouvel éclairage sur l'archéologie américaine. Independence, Mo. : Lambert Moon Printing Co., 1924.
Hunter, Milton R. et Thomas Stuart Ferguson. L'Amérique ancienne et le Livre de Mormon. Oakland, Californie : Kolob Book Co., 1950.
Israël, Menassé ben Joseph ben. Origine des Américains, c'est l'espoir d'Israël. Madrid : S. Pérez Junquera, 1881.
Jakeman, M. Wells. « Une sculpture inhabituelle représentant un arbre de vie de l’Amérique centrale ancienne », Bulletin de la University Archaeological Society, n° 4 (mars 1953), pp. 26-49. Provo, Utah.
Jijon et Caamano, Jacinto. « Edward King — Vicomte de Kings-borough (1795-1837) », Bulletin de la Société équatorienne d'études historiques américaines, Vol. I (juin 1918 [c.-à-d. 1919]).
Jones, Epaphras. Sur les dix tribus d'Israël et les aborigènes d'Amérique, etc. New Albany, Indiana : Collins & Green, 1831.
Kennedy, James. (Voir Général ci-dessus.)
Kincsborouch, Edward King, Lord. Antiquités du Mexique. 9 vol. Londres : Robert Havel! et Colnaghi, Son, & Co., 1831-48.
Mather, Cotton. Magnolia Christi Americana. 1702.
O'Dea, Thomas F. Les Mormons. Chicago : University of Chicago Press, 1957.
Rivero, Mariano Edward et John James von Tschudi. Antiquités péruviennes. New York : George P. Putnam & Co., 1853.
Roo, P. de. Histoire de l'Amérique avant Colomb. 2 vol. Philadelphie et Londres : JB Lippincott Co., 1900.
Woodford, Irene Briccs. « L'arbre de vie dans l'Amérique ancienne : sa représentation et sa signification », Bulletin de la University Archaeological Society, n° 4 (mars 1953), pp. 1-18. Provo, Utah.
LES THÉOSOPHES ET LES ROSICRUCIENS
Albersheim, Walter J. « Science et mysticisme », Rosicrucian Digest, XXXI, n° 4 (avril 1953), 140^43, 147-48. San Jose, Californie.
Blavatsky, HP La Doctrine Secrète. Édition de 1883, vol. I, pp. 43-44. Cité dans Theosophical Quarterly, XXXII (janvier 1935), 196.
Georc, Eugen. L'aventure de l'humanité. New York : EP Dutton, 1931.
Heindel, Max. La cosmo-conception rosicrucienne ou le christianisme mystique. Oceanside, Californie : The Rosicrucian Fellowship, 1929.
Leader, Herman. « Popol Vuh, un livre sacré », Rosicrucian Digest, XXXII, n° 2 (février 1954), 69-73. San José, Californie.
Lewis, H. Spencer. Questions et réponses rosicruciennes avec l'histoire complète de l'Ordre rosicrucien. San Jose, Californie : Rosicrucian Press, 1932.
Preeche, Harold. « Culdee Sages of the Caves », Rosicrucian Digest, XXVIII, n° 7 (août 1950), 259-65. San Jose, Californie.
Preeche, Harold. « Quand l’Amérique a-t-elle été colonisée ? » Rosicrucian Digest, XXXII, n° 2 (février 1954), 64-68. San Jose, Californie.
Wright, Claude Falls. Un aperçu des principes de la théosophie moderne. Boston et New York, 1894.
LINGUISTIQUE EN ROUE LIBRE
Denisf.n, TS Linguistique mexicaine. Chicago : TS Denisen & Co., 1913.
Paravey, M. de. M emoire de M. de Paravey sur I'Origine Japonaise, Arabe, et Basque de la Civilisation des Peoples du Plateau de Bogota. Paris, 1835.
Rosny, Lucien de. Etude de' Archeologie Americain Comparee. (n.d., no place.)
Thiersant, Dabry P. de. (voir Général ci-dessus.)
Wiener, Leo. Origines mayas et mexicaines. Cambridge : Édition privée, 1926.
Wise, Jennings C. L'homme rouge dans le drame du Nouveau Monde. Washington, DC : WF Roberts Co., 1931.
------. L'Amérique : le contexte de Colomb. Charlottesville, Virginie : Monticello Publishers, 1945.
CONTACT TRANSPACIFIQUE
Adam, Lucien. “Du Fou-Sang,” / Congres International des Ameri-canistes, I, 144-61. Nancy: G. Crepin-Leblond; and Paris: Maison* neuve et Cie, 1875.
Anonyme. Critique du livre Aku-Aku de Thor Heyerdahl, Time, LXXII (8 septembre 1958), 100.
Arnold, Channing et Frederick J. Tabor Frost. L'Égypte américaine. New York : Doubleday, Page & Co., 1909.
Bennett, Wendell C. Critique du livre American Indians in the Pacific de Thor Heyerdahl, New York Times, 9 août 1953, p. 1.
Ekholm, Gordon F. « Un possible foyer d’influence asiatique dans les cultures classiques tardives de Mésoamérique », Society for American Archaeology, Mémoires 9, pp. 72-89. Salt Lake City, 1953.
Estrada, Emilio et Betty J. Meggers. « Un ensemble de traits d’origine transpacifique probable sur la côte de l’Équateur », American Anthropologist, LXIII, n° 5 (octobre 1961), 913-39. Menasha, Wisconsin.
Estrada, Emilio, Betty J. Meggers et Clifford Evans. « Possible contact transpacifique sur la côte de l’Équateur », Science, CXXXV, n° 3501 (2 février 1962), 371-72.
Gladwin, Harold Sterling. Des hommes venus d'Asie. New York : McGraw-Hill Book Co., Inc., 1947.
Heinf.-Geldern, Robert et Gordon F. Ekholm. « Parallèles significatifs dans les arts symboliques de l’Asie du Sud et de l’Amérique centrale », dans Sol Tax (dir.), The Civilizations of Ancient America, pp. 299-309. Chicago : University of Chicago Press, 1951.
Heyerdahl, Thor. Kon-Tiki. Chicago : Rand McNally & Co., 1950.
------. Les Indiens d'Amérique dans le Pacifique : la théorie derrière l'expédition Kon-Tiki. Londres, Oslo et Stockholm : George Allen & Unwin, 1952.
------. Aku-Aku : Le secret de l'île de Pâques. Chicago : Rand McNally & Co., 1958.
Kroeber, Alfred L. Anthropologie. New York : Harcourt, Brace & Co., 1948.
Krocman, WM Critique du livre American Indians in the Pacific de Thor Heyerdahl, Chicago Sunday Tribune, 26 juillet 1953, p. 6.
Linton, Ralph. Compte rendu du livre Men Out of Asia de Harold S. Gladwin, American Antiquity, XIII, n° 4, Pt. 1, 331-332. Menasha, Wisconsin.
------. Compte rendu du livre American Indians in the Pacific de Thor Heyerdahl, anthropologue américain, LVI (février 1954), 122-24. Menasha, Wisconsin.
Lothrop, Samuel K. « Pensées aléatoires sur les hommes venus d'Asie », American Anthropologist, L, n° 3, Pt. 1, 568-71. Menasha, Wisconsin.
Nicolson, Nicel. Critique du livre Aku-Aku de Thor Heyerdahl, New Statesman, LV (15 avril 1958), 442.
Norbeck, Edward. Critique de livre sur les Indiens d'Amérique du Pacifique par Thor Heyerdahl, American Antiquity, XIX, n° 1, 92-94. Salt Lake City.
Mackintosh, J. (Voir Généralités ci-dessus.)
Plischke, Hans. « La colonisation de la Polynésie — Réponse à Thor Heyerdahl », Universitas, I, n° 4, 397-404. Nancy : G. Crépin-Leblond ; et Paris : Maisonncuve et Cie, 1875.
Spoehr, Alexander. « Un regard juste sur le Kon-Tiki », Chicago Natural History Museum Bulletin, XXII (juillet 1951), 6.
DÉTROIT DE BÉRING
Byers, Douglas S. « Le pont de Béring — Quelques spéculations », Ethnos, n° 1-2, pp. 20-26. Stockholm, 1957.
Carter, George F. L'homme du Pléistocène à San Diego. Baltimore : Johns Hopkins Press, 1957.
Flint, Richard Foster. Géologie glaciaire et pléistocène. New York : John Wiley & Sons, Inc. 1957.
Griffin, James B. « Quelques liens préhistoriques entre la Sibérie et l’Amérique », Science, CXXXI, n° 3403 (18 mars 1960). Washington, DC
Aac : roi d'Uxmal, 12-13
Abyssins, 54 ans
Acapulco, 15
Acosta, Joseph de, 31 ans
Adair, James, 5,57
Adam, Lucien, 92 101
Adam et Eve, 12 ans ; voir aussi Jardin d'Eden
Afghans, 54
Africains, 3, 74 ; voir aussi Comme ;
Égypte; Mandingues; Zoulous
Agassiz, Louis, 117
Agriculture, 87-88
Genre, 105
je je; voir Heyerdahl, Thor
Alaska, 21 n.; voir aussi Béring
Détroit
Albersheim, Walter J., 80
Alexandre le Grand, 2 ; voir aussi Gladwin, Harold S.
Alphabet, 32
American Antiquarian Society, 19 Andes ; voir Inca ; Pérou Anglo-Saxons, 54
Antilia, 30, 31 ans
Arche, 55,63
Arnold, Channing et Frederick J. Tabor Frost, 26, 90-91, 93, 95, 96
Asie, 4, 69, 93-96, 96-97
Assyriens, 3,18
Athéniens, 30
Figures atlantes, 26
Atlantis : appels aux mystiques, 28 ; une théorie continue, 4, 27 ; description de Heindel, 43-44 ; histoire de la théorie, 30-32 ; patrie de la quatrième race-racine des mystiques, 123 ; continent perdu de, 28-49 ; la reine Moo s'enfuit vers, 12 ; théorie comparée à l'hypothèse du détroit de Béring, 85-86
Atlas, 32-33, 62
Avalon, 30
Aztèques, 3,5
Bacon, Francis, 32
Boulanger, De Vcre, 107–8
Balboa, Vasco Nunez de, 1 Baldwin, John D., 56 117 Bananes, 105
Bancroft, Hubert Howe : sur Brasseur de Bourbourg, 48-49, 126 ; sur la théorie Pérou-Chine de Brooks, 107 ; critique de la théorie Ku-blai Khan de Ranking, 89 ; sur Lord Kingsborough, 52-53
Basques, 3, 110
Belshatsar, 20 ans
Bennett, Wendell C., 76-77, 107 Détroit de Béring, 4, 51, 83-84,85, 86 Bertrand, LA, 61
Oiseau, Junius, 76
Blacket, WS, 33
Blavatsky, HP : scientifiques critiqués, 80-81 ; écrits ésotériques, 130 ; cosmologie mystique, 42 ; a déclaré que la théosophie enseigne l'histoire ésotérique, 131 ; points de vue sur l'évolution et la race, 122-24
Livre de Mormon, Le : Articles de foi pour, 59 ; comparé aux Annales d'Ixtlilxochitl, 62, 63 ; décrit les pérégrinations israélites en Amérique, 4, 5 ; ne concerne pas les Tribus perdues, 59 ; embarcation à voile décrite dans, 59 ; voir aussi Mormons
Borbolla, Daniel Rubin de la, 76 Brasseur de Bourbourg, Charles
Stephen, 44-49 ; critique de Bancroft sur, 126 ; comparée à G. Elliot Smith, 21 ; théorie égyptienne sur, 25 ; Le Plongeon ne voulait pas que son nom soit lié à, 20-
21; réputation professionnelle perdue, 5; à Rome
Brésil, 44
Arbre à pain, 105
Université Brigham Young, 64-65
Bronze, 88
Brooks, Charles Wolcott, 107
Bryan, William Jennings, 2
Bouddhistes : bouddhisme lié aux religions américaines, 92 ; identifié aux Indiens d'Amérique, 3 ; article sur, à Nancy, 99 ; route vers l'Amérique, 95 ; voyage de Ceylan à Java, 95
Buffon, Georges Louis Leclerc de, 31
Birman, 54 ans
Byers, Douglas S., 86
Cabrera, Pablo Félix de, 128
Caicedo, Torres, 100
Cambodge, 24, 65
Cananéens, 3, 55, 57
Îles Canaries, 21 n., 33, 98
Carter, George F., 84 n.
Carthaginois ; voir Phéniciens
Cataclysmes, 35
Catherwood, Frédéric, 14; 15
Cay, Prince du Yucatan, 12-13
Cénote du Sacrifice, Chichen Itza, Yucatan ; voir Cénote Sacré
Céréales, 87
Chac Mool, 8-9, 11,16-17
Charlevoix, Pierre de, 85
Chichen Itza, Yucatan, Mexique : influences asiatiques à, 93 ; figures atlantes à, 26 ; figures barbues en sculpture, 9,18 ; Chac Mool découvert là-bas, 17 ; roi de, 11 ; Le Plongeon à, 8 ;
Cénote sacré de, 33
Chil et Narango, Dr., 29, 98 ans
Amérique colonisée, 74 ; dolmens, 24 ; Fo lié aux religions américaines, 92 ; identifié aux Indiens d'Amérique, 3 ; relations avec le Pérou, 107 ;
reliques au Pérou, 92 ; route des tribus perdues d'Israël, 51
Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; voir Mormons
Churchward, James, 36 ; tendances religieuses, 117-118 ; sur les tablettes de Mu, 39-40 ; style d'écriture de, 129
Churchward, William, 37-38
Circoncision, 55
Coh, prince du Yucatan, 12-13, 16
Noix de coco, 87, 105
Cogolludo, Diego López de, 109
Colombie, 110
Colomb, Christophe, 1; regardé
pour Antilia, 30
Confession chez les Indiens d'Amérique, 55
Ruines de Copan, Honduras, 25
Arc en encorbellement, 88
Cortez, Hernán, 10
Coton, 87
Île de Cozumel, Yucatan, Mexique ;
17 108
Critiques de Platon, 29-30
La race Cro-Magnon, 119-20
Cultures ; voir Agriculture
Cumorah, Colline de, 61
Dall, WH, 134-35
D'Aristarchi, Stephen, 98 ans
Darrow, Clarence, 2
Del Rfo, Antonio, 45-46
Denisen, TS, 71, 81
Dieux plongeurs, en Asie et en Amérique, 93-94
Dixon, Roland B., 22-25; 64
D'Oliver, Fabre, 44
Animaux domestiques, 87-88
Donnelly, Ignatius : sur l'Atlantide, 4 ; sur les cataclysmes, 35 ; carte de l'Atlantide, 34 ; a encouragé la recherche de l'Atlantide, 36 n.
Drake, Samuel G., 81
Dravidien ; voir India Duran, Father, 53 n.
Tremblements de terre, 16
Île de Pâques, 2, 62
Équateur, 96-97
Eden, jardin d'; voir Jardin d'Eden
Égypte : colonisée depuis l'Atlantide, 48 ; berceau de la civilisation, 3 ; influence dans l'Amérique antique, 7-27 passim ; colonisée par des colons venus de Mu, 39 ; culte du soleil dérivé de l'Atlantide, 32
Inscriptions égyptiennes, 27 Égyptiens, 3
Ekholm, Gordon F. et Robert Heine-Geldern, 93-94
Éléphants représentés sur une sculpture maya, 25
Eliot, John, a favorisé la théorie des tribus perdues, 53 n.
Champs Elysées, 32
Estrada, Emilio, Betty J. Meggers et Clifford Evans, 96-97
Étrusques, 3
Evans, Clifford ; voir Estrada, Emilio, Betty J. Meggers et Clifford Evans
Ève ; voir Adam et Ève Evolution, 2, 122-24
Ferguson, Thomas Stuart, 62, 66, 74
Fès, Maroc, 35 ans
Champ, Stephen J., 15
Finno-ougrien, 108
Flint, Richard Foster, 83
Mythes du déluge : chez les Indiens d'Amérique, 55 ; dans les Annales d'Ixtlilx-ochitl, 63 ; étude de Dixon sur, 64 ; dans les livres indiens autochtones, 64
Alimentation; voir Agriculture
Îles Fortunées, 30
Foster, John W., 17
Fracastoro, Giralamo, 31 n.
Français,3
Frost, Frederick J. Tabor ; voir Arnold, Channing et Frederick J. Tabor Frost
Arbres fruitiers ; voir Agriculture
Théorie de Fu-Sang : attaquée par de Hellwald, 101-2 ; les Chinois ont atteint l'Amérique, 90 ; définie, 29 ; revue par Adam, 101
Gaffarel, Paul, 98
Jeux de hasard, 88
Garcia, Gregorio, 53 n., 109,120-2
García, District, 109
Jardin d'Eden, 12, 32 ; voir aussi Adam et Eve
Jardins des Hespérides, 32
Gardner, Martin, 125
Genèse, auteur de, 12
Georg, Eugène, 130 ans
Gerland, George, 106
Gladwin, Harold S. : la théorie de la flotte d'Alexander, 89 ; a demandé à Hooton d'écrire la préface, 82 ; a attaqué les anthropologues professionnels, 71-72, 75-76 ; sur la régression culturelle, 41 ; revu par Linton, 2
Godbcy, Allen H., 53 n., 56-57
Gourde, 87, 104, 105
Grèce : Amérique colonisée, 3, 74 ; divinités identifiées aux dieux atlantes, 32 ; éléments de mythologie dans les sculptures de l'Arbre de vie, 65 ; flottille dans les eaux du Yucatan, 112 ; affiliations linguistiques avec les Mayas, 18 ; armes macédoniennes trouvées dans
Brésil, 44
Griffin, James B., 84 n.
Haeckel, Ernst ; voir Jaekel, Ernst Hébreux ; voir Israélites
Heindel, Max, 42, 121-22, 122-24 Heine-Geldern, Robert ; voir Ek-holm, Gordon F. et Robert Heine-Geldern
Hellwald, Frédéric de, 100-101, 102
Hérodote, 18
Hespérides; voir Jardins des Hespérides
Heyerdahl, Thor : et l'attrait pour les mystiques, 5, 132-133 ; sur la régression culturelle, 41 ; et un large public, 4 ; opposé à New York, 70 ; présentation de la théorie, 127-28 ; théories acceptées sur la base de preuves minces, 112-13 ; théorie concernant la population péruvienne de Polynésie, 103-107 ; points de vue sur la race, 120 ; voyage pour soutenir la théorie, 5
Écriture hiéroglyphique, 7,11, 79
Hills, Lewis Edward, méthode utilisée par, 131-32; révélation à, 68; écrits de, 67
Hindous : astrologie comparée à l'astrologie mexicaine, 91 ; divinités comparées aux dieux mexicains, 91 ; divinités identifiées aux dieux atlantes, 32 ; identifiées aux Indiens d'Amérique, 3 ; orientation des théosophes vers, 118-19
Hooton, Ernest Albert, 33, 77, 82 ans
Chevaux, 25-26
Horus, dieu égyptien, 48
Types de maisons, 96
Huipil, tunique pour femme maya, 18
Humboldt, Alexander von, 36 ans, 91 ans, 3 ans
Hunter, Milton R., 61-62, 74
Hwui Shan et la fable de Fu-Sang, 91
Imbblloni, J., 31 n.
Pourtant, 3, 5
Inde : temples dravidiens, 24 ; momification en, 21 ; colonisation par les colons de Mu, 39 ; Sam-mono-Cadom lié aux religions américaines, 92
Congrès international des américanistes, 97-102
Substances intoxicantes, 88
Irlandais, 3
Fer, 88
Isis, 13
L'île des Sept Cités, 30
Israélites : identifiés aux Indiens d'Amérique, 3 ; hypothèse des tribus perdues privilégiée par les premiers auteurs, 3 ; théorie des tribus perdues, SO-58 ; les mormons nient les tribus perdues dans leur doctrine, 59 ; doctrine mormone sur, 59-68 ; la théorie persiste, 27 ; voyage de la mer Rouge à l'Amérique centrale, 108 ; voir aussi les mormons
Ixtlilxochitl, Fernando de Alva, 62 ans
Jaekel, Ernst, 38 ans
Japon : bouddhisme lié aux religions américaines, 92 ; ressemblances avec la céramique en Équateur, 96 ; Japonais descendants des tribus perdues d'Israël, 54 ; affiliation linguistique avec Muysca de Colombie, 110
Jarédites, 58-59
Java, 65
Jefferson, Thomas, 4
Jésus, 19, 20,61
Jijon et Caamano, Jacinthe,
Johnson, Willis Fletcher, 78-80
Jones, Épaphras, 117, 119,132.
Jones, Georges, 116
Josselyn, John, 85
Cafres, 54
Karen, 54 ans
Kennedy, James, 56 ans, 117 ans
Khmers, 96
Kingsborough, Edward King, vicomte, 5,51-52
Klaproth, HJ von, 91
Kon-Tiki; voir Heyerdahl, Thor
Coréens, 90
Kroeber, Alfred L., 113.
Krogman, WM, 106-7
Kubilai Khan, 89 ans
Indiens Kwakiutl, 103
Lamaïsme, 92
Lamanites, 59-60
Landa, Mgr Diego de, 57 ans
Langue : recherche amateur, 108-13 ; attrait pour les mystiques, 6 ; distribution polynésienne, 105 ; soutient la théorie des migrations de la Polynésie vers le Pacifique, 106
Las Casas, Bartolomé de, 53 n.
Léhi, 59, 107
Lcmurie; voir Mu
Communauté Lémurienne, 118
Le Plongeon, Alice : ses révélations sur son lit de mort, 19-20 ; l'intérêt de son amie pour l'Atlantide, 133-34 ; sa nécrologie de son mari, 15, 16, 20
Le Plongeon, Augustus, 7-21 ; amer du manque de reconnaissance, 78-79 ; sur les reliques chinoises au Pérou, 92 ; anthropologues professionnels critiqués, 73 ; théorie égyptienne de, 25 ; ses tendances anti-chrétiennes, 117 ; ses théories rejetées, 5 ; sur les affiliations linguistiques mayas, 108 ; et voyages, 15
L'Estrangé, Sir Hamon, 55
Lewis, H. Spencer, 31, 133
Lewis, Ralph M., 70
Linguistique; sec Langue
Linton, Ralph, 2, 107
Lisbonne, Portugal, 35
Li Yen, 90-91
López de Gomara, Francisco, 31 n., 53 n.
Continent perdu de l'Atlantide ; sec Atlantis
Continent perdu de Mu ; voir Mu
Tribus perdues d'Israël ; voir Israélites
Lothrop, Samuel Kirkland, 41-42, 89-90
Motif lotus, 93-94
Aras : les stylisations mayas ressemblent à des éléphants, 24, 25
McCulloh, James H., 41 Macédoine ; voir Grèce MacKintosh, John : attaqué Perdu
Théorie des tribus, 56 ; théorie coréenne privilégiée, 90 ; sur l'origine du nom Yucatan, 109 ; mise en garde contre la confiance dans les similitudes linguistiques, 111
Malgaches, 3
Magellan, Fernando, 1
Magoun, HW, 119
Malais, 54, 106
Mandingues, 3
Mangue-Capac, 92
Restrictions au mariage, 55
Masaï, 54 ans
Franc-maçonnerie, libre, 11
Mather, Cotton, 53 n., 85,115
Mather, Augmentation, 53 n.
Maudslay, Alfred Percival, 26
Maury, Matthew Fontaine, 92
Maya : traits carthaginois-phéniciens parmi, 3 ; dieux comparés aux hindous, 91 ; étude de Le Plongeon sur, 5 ; affiliations linguistiques avec le sanskrit, 111 ; pyramides, 24 ; système vigésimal, 90 ; Voir aussi Chichen Itza, Yucatan ; Copan, Honduras ; écriture hiéroglyphique ; Huipil ; Cénote sacré ; Uxmal
Meggers, Betty J.; avec Estrada. Emilio, Betty J. Meggers et Clifford Evans
Mcnnassch ben Israël, ben Joseph, 53 116
Merrill, ED, 135
Métallurgie, 32 ; sec aussi Fer ;
Bronze
Mexique : Brasseur de Bourbourg in, 46-47 ; traversé par Le Plon-géon, 15 ans ; pyramides de, 24 ; voir aussi Acapulco ; Aztèques ; Chichén Itzá ; l'île de Cozumel ; Maya; Oaxaca; Toltèques ; Toula ; Uxmal; Yucatán
Mitchell, J. Leslie, 25
Mohawks, 85
Montaigne, Michel Eyquem de, 31 Moo, reine de Chichen Itza, 12-13 Mormons (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours) : et origines amérindiennes, 3 ; croyances décrites par Bertrand, 61 ; doctrine sur les Hébreux en Amérique, 4, 117 ; opinions racistes sur, 121 ; voir aussi Livre de Mormon, Le ; Université Brigham Young ; Baker, De Vicre ; Ferguson, Thomas Stuart ; Hills, Louis Edward ; Hunter, Milton R. ; Léhi ; Lamanites ; Néphites ; Arbre de vie
Morse, E., 91.
Morse, Samuel FB, 19
Morton, Thomas, 85 ans, 111 ans
Moïse, 39, 64 ans
Mu, continent perdu de, 36-43 ; atmosphère de, 44 ; description de Heindel de, 42-43 ; voir aussi Churchward, James ; Churchward, William ; tablettes Naacal de Mu ; Niven, William
Momification : au Mexique et en Atlantide, 32 ; au Pérou et en Égypte, 7 ; propagation depuis l'Égypte, 21 n., 23
Comprimés Naacal de Mu, 39,
Néarque, 89
Appuie-têtes, 96
Nemo, Capitaine, 36 ans
Néphites, 59-60
Neuman, Friedrich de, 91 ans
Fondation archéologique du Nouveau Monde, 66
Nicte, sœur de la reine Moo, 12 ans
Niven, William, 39
Norbeck, Edward, 41, 106, 120, 127-28
Hommes du Nord, 3
Serments, 88
Oaxaca, Mexique, 27 ans
Épreuves, 88
Oviedo et Valdés, Gonzalo Fernández de, 30, 53 n.
Bœuf, 87
Pacifique ; voir Trans-Pacific contacts ; Heyerdahl, Thor ; Estrada, Emilio, Betty J. Meggers et Clifford Evans ; Ekholm, Gordon F. et Robert Heine-Geldern
Pagodes, 91
Flûte de Pan, 88, 96
Jeu de Parchecsi, 88
Jeu Patolli, 88
Payne, Edward John, 53 ans, malade
Fondation Peabody, Robert S., 86 Musée Peabody de l'Université de Harvard, 22
Penn, William, 53 n.
Perry, William J., 21 n.
Perse, 51
Pérou : et similitudes artistiques avec la Polynésie, 103 ; reliques chinoises dans, 92 ; système décimal, 90 ; dieux comparés aux hindous, 91 ; Israélites dans, 59 ; Le Plongeon dans, 15 ; affiliations linguistiques avec le sanskrit, 111 ; lamas et alpagas dans, 88 ; et théorie des tribus perdues, 56 ; période Mochica, 41 ; momification dans, 21 n. ; relations avec la Chine, 107 ; voir aussi Inca ; Mango-Capac ; Heyerdahl, Thor
Petitot, Révérend Père, 100
Cultes phalliques, 93
Phéniciens, 3, 32,128
Phuddy Duddy, docteur, 72-73
Cochons, 26
Platon : sur l'Atlantide, 29-30 ; appelé « inventeur du noble mensonge », 134 ; Critias, 29-30 ; Timée, 29 ; première autorité sur l'Atlantide, 3 ; palais décrit par, 33
Plischke, Hans, 106
Charrue, 87, 91
Polynésie, 4 ; voir aussi Arbre à pain ; Noix de coco ; Heyerdahl, Thor ; Langue
Popol Vuh, 63 ans
Portugais, 3
Prescott, William H., 46
Prêtre, Josias, 55 ans
Pyramides : théorie de Brasseur sur, 47-48 ; théorie égyptienne explosée, 24-25 ; Maya comparée aux pagodes, 91 ; propagation depuis l'Égypte, 21
Quetzalcoatl : identifié à Horus, 48 ; identifié à Jésus, 61 ; identifié à de nombreux personnages, 62 ; un missionnaire du culte de Brahma ou de Bouddha, 92 ; réincarné à Cortez, 10
Course, 32, 42
Racisme, 119-24
Classement, John, 88-89
Rejon Garcia, Manuel, 25-26 Religion ; voir Théologie
Richmond Brown, dame, 41 ans
Rio, Antonio del; voir Del Rio, Antonio
Rivero, Mariano Edward, 56, 92
Inscriptions romaines, 27
Romains : flottille dans les eaux du Yucatan, 112 ; fort à Marietta sur la rivière Ohio, 55 ; identifiés aux Indiens d'Amérique, 3
Rosicruciens : scientifiques professionnels accusés, 80 ; croyances sur l'Atlantide, 31 ; intéressés par les origines amérindiennes, 3 ; intéressés par l'Atlantide et Mu, 4 ; méthodes utilisées par, 133 ; et intérêts religieux, 118 ; style d'écriture de, 131 ; voir aussi Heindel, Max
Rosny, Leon de, 99-100, 101
Rosny, Lucien de, 63,110
Rude, Gilbert, 129
Carte de Ruysch de 1508, 30
Cénote sacré, Chichen Itza, Yucatan, 33
Sacrifices : parmi les Indiens d'Amérique, 55 ; aux îles Canaries, 33 ;
à Chichen Itza, Yucatan, 33 ;
Cérémonie de l'Étoile du Matin, 62
Île Saint-Brendan, 30
Sanskrit, 18
Scandinaves, 32
Écosse, 119-20
Sculpture, Maya, 9, 18
Scythes, 3, 85
Sewal), Samuel, 53 n.
Short, John T., 13-14
Sinnett, AP, 42,122-24
Smith, G. Elliot, 21-25 ans
Smith, Joseph, 61
Salomon, roi, 25
Sommono-Cadom, 92
Espagnols, 3
Spence, Lewis : ne voulait pas que son nom soit associé à Brasseur ou Le Plongeon, 21 ; sur la durabilité de la théorie de l'Atlantide, 131 ; assimilait Quetzalcoatl à Atlas, 32 ; prévoyait une désapprobation, 81 ; vues racistes sur, 119 — 20 ; sur la méthode scientifique et mystique, 131 ; écrivain sur l'Atlantide, 4, 31
Spencer, Herbert, 125
Spinden, Herbert J., 77 ans
Spochr, Alexander, 104-5 Stacy-Judd, Robert B., 132, 133 Stanley, Henry Morton, 105 Stephens, John Lloyd, 14, 15 Stonehenge, 2
Dimanche, Billy, 67 ans
Adoration du soleil, 7
Patate douce, 87, 104,105
Conférence, 105
Tartares, 3, 85
Homme de Tepexpan, Mexique, 40 ans
Théologie, 6,115-19
Théosophes : croyances sur l'Atlantide, 31-32 ; intérêts religieux, 118-119 ; intéressés par
Origines amérindiennes, 3 ; s'intéresse à Atlantis et à Mu, 4 Thiersant, P. Dabry de. 111 ; voir aussi Blavatsky, HP ; Georg, Eugen
Trônes, 93
Tibet, 92
Teinture par nœuds, 88
Carrelage, 91
Timée de Platon, 29
Toltèques, 31, 47, 123
Torquemada, Tomas de, 53 n.
Carte de Toscanelli, 30
Tozzer, Alfred Marston, 22, 25
Les contacts transpacifiques : preuves pour et contre, 88-102 ; soutien croissant en faveur, 5 ; voir également Ek-holm, Gordon F. et Robert Heine-Geldern ; Estrada, Emilio, Betty J. Meggers et Clifford Evans ; Arnold, Channing et Frederick J. Tabor Frost
L'Arbre de Vie, 64-65
Codex de Troana, 48
Tschudi, John James von : s'opposait à la théorie des tribus perdues, 56 ; voyait une origine commune des religions d'Extrême-Orient et d'Amérique, 92
Tula, Mexique, 93
Université de Tulane, 33, 59, 110 — 111
Dindes, 88
Turc, 85
Tyriens ; voir Phéniciens
Utatlan, Guatemala, 33; 110 — 11
Uxmal, Yucatán, 12
Veracruz, Mexique, 15, 46 ans
Verne, Jules, 36
Verrill, M. et Mme A. Hyatt : ont accusé des anthropologues professionnels, 74 ; ont revendiqué l'approbation des anthropologues professionnels, 76, 82 ; ont prévu la désapprobation, 81
Viollet-le-Duc, 91
Voltaire, 31, 117
Waldeck, Jean Frédéric, 109.
Eh bien, sacré ; voir Cénote sacré, Chichen Itza, Yucatan
Gallois, 3
Roue : accusations de Gladwin, 75-76 ; absentes du Nouveau Monde, 87, 91 ;
Les accusations de Verrill, 74-77 passim
Wiener, Léo, 77, 111
Willard, Théodore A., 57 ans
Williams, Roger, 53 n.
Winthrop, Robert C., 98
Wise, Jennings C. : théories linguistiques, 111-12 ; sur le Mu de d'Olivet, 44 ; sur l'origine du nom Lémurie, 38-39 ; tendances religieuses, 118 ; forme de pensée des continents symbolique, 134
Bois, William, 55 ans
Wright, Claude Falls, 122-24; 44
Fièvre jaune, 16
Yemon, Ogivia, 98
Yucatan, Mexique : sculptures de type égyptien, 26 ; origine du nom, 109-10
Zarito, Augustin de : défendu la théorie de l'Atlantide, 31 n. 2
Zelinski, Luis de, 98 ans
Zéro, 88
Signes du zodiaque : Hindou comparé au Mexicain, 91
Zoulous : descendants des tribus perdues d'Israël, 54
IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS